|
|
|
|
 |
|
NEUTRON |
|
|
| |
|
| |
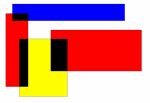
LE NEUTRON
Le neutron est une particule subatomique de charge électrique nulle.
Les neutrons sont présents dans le noyau des atomes, liés avec des protons par l'interaction forte. Alors que le nombre de protons d'un noyau détermine son élément chimique, le nombre de neutrons détermine son isotope. Les neutrons liés dans un noyau atomique sont en général stables mais les neutrons libres sont instables : ils se désintègrent en un peu moins de 15 minutes (880,3 secondes). Les neutrons libres sont produits dans les opérations de fission et de fusion nucléaires.
Le neutron n'est pas une particule élémentaire mais une particule composite composée de l'assemblage de trois composants : un quark up et deux quarks down, liés par des gluons.
Caractéristiques Description
Le neutron est un fermion de spin ½. Il est composé de trois quarks (deux down et un up), ce qui en fait un baryon de charge électrique nulle. Ses quarks sont liés par l'interaction forte, transmise par des gluons.
La masse du neutron est égale à 1,008 664 916 06 u, soit 939,565 421 94 MeV/c2[2] ou 1,674 927 500 56 ×?10−27 kg[4]. Le neutron est 1,001 378 fois plus massif que le proton. Sa charge électrique est nulle. Tout comme le proton, le neutron est un nucléon, et peut être lié à d'autres nucléons par la force nucléaire à l'intérieur d'un noyau atomique. Le nombre de protons d'un noyau (son numéro atomique, noté Z) détermine les propriétés chimiques de l'atome et donc quel élément chimique il représente ; le nombre de neutrons (usuellement noté N) détermine en revanche l'isotope de cet élément. Le nombre de masse (noté A) est le nombre total de nucléons du noyau : A = Z + N.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT wikipédia LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Qu’est-ce que le hasard quantique? |
|
|
| |
|
| |
Qu’est-ce que le hasard quantique?
02.11.2017, par Alexia Auffèves
Le hasard « classique » est d’une tout autre nature que celui qui se manifeste à l’échelle quantique, nous explique la spécialiste Alexia Auffèves. Derrière ces recherches, la promesse d’applications susceptibles de révolutionner les technologies de l’information.
Ce texte fait l’objet d’une publication commune avec The Conversation
(link is external)
, partenaire du Forum du CNRS 2017, auquel participe Alexia Auffèves.
?
Le hasard en physique classique surgit lorsque le résultat d’une expérience ne peut être prédit avec certitude : sur quelle face tombera le dé ? Quel temps fera-t-il à Paris l’année prochaine ? Le hasard rend compte de façon effective du fait que nous ne disposons pas de toute l’information sur une situation physique complexe. Il nous permet de conserver une capacité prédictive, portant sur des statistiques (ainsi, ce dé a une chance sur six de tomber sur le « 1 »).
Pour lire la suite , consulter le LIEN.
DOCUMENT cnrs LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le démantèlement nucléaire |
|
|
| |
|
| |

Le démantèlement nucléaire
Publié le 5 février 2015
Lorsqu’une installation nucléaire arrive en fin de vie, on procède à son démantèlement et à son assainissement. Le démantèlement consiste à démonter les équipements et les auxiliaires. La phase d’assainissement consiste à enlever l’essentiel de la radioactivité résiduelle contenue dans les installations.
LA FIN DE VIE D
’UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE (INB)
Le démantèlement nucléaire correspond à une étape technique et administrative de la vie d’une installation nucléaire de base (INB).
Qu’il s’agisse d’un réacteur, d’une usine de retraitement ou d’un laboratoire de recherche, la décision d’arrêter l’exploitation d’une installation constitue un engagement de l’exploitant. Cette décision conduit à terme à la mise à l’arrêt définitif (MAD) de l’installation sur la base d’un décret de MAD/DEM et ouvre une période dite d’opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif, durant laquelle l’exploitant évacue une part significative des substances dangereuses (par exemple le combustible nucléaire d’un réacteur) et prépare les futures opérations de démantèlement encadrées par le décret de MAD/DEM. Les opérations préparatoires à la mise à l’arrêt définitif sont assurées dans le référentiel d’exploitation courante de l’installation car elles obéissent aux règles de sûreté prévues pour le fonctionnement de l’installation.
A la publication du décret de MAD/DEM, commencent les opérations de démantèlement et d’assainissement proprement dites, chaque étape peut faire l’objet d’une instruction administrative et technique par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), et donner lieu à une autorisation préalable.
Lorsque les opérations de démantèlement nucléaire sont achevées, souvent plusieurs années après, l’installation peut alors être « déclassée ». L’ASN contrôle que l’état final visé a été atteint, puis procède à l’acte administratif de déclassement. Cela signifie que l’installation ne figure plus sur la liste des INB. Selon les cas, la réutilisation de l’installation, ou du terrain si l’installation a été entièrement déconstruite, est soumise à des servitudes particulières. Le réemploi de l’installation / du terrain se fait généralement dans le cadre d’activités industrielles.
ORGANISATION D’UN CHANTIER
DE DÉMANTÈLEMENT NUCLÉAIRE
On privilégie le démantèlement immédiat des installations, chaque fois que c’est réalisable, afin de diminuer les risques liés à la radioactivité et de bénéficier des connaissances du personnel d’exploitation. Cela permet aussi d’éviter des coûts liés à la surveillance prolongée de l’installation. Cette stratégie de démantèlement immédiat est recommandée par l’ASN et par l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique).
Pour autant, les chantiers de démantèlement peuvent durer plusieurs années, selon la taille et la complexité des structures à démanteler, et selon leur niveau de radioactivité.
La présence de matières radioactives diffère suivant le type d’installation :
* Dans un réacteur nucléaire, la radioactivité est majoritairement contenue dans les structures proches du cœur soumises à l’activation neutronique ;
*
* Dans une usine de retraitement de combustible nucléaire ou dans une station de traitement des effluents et des déchets, la radioactivité se situe dans différentes zones de l’installation, par exemple les tuyauteries, les cuves.
*
* Dans un laboratoire de recherche, la radioactivité est confinée dans des structures étanches, appelées « cellules blindées » ou « boîtes à gants », qu’il faut également démonter et assainir.
*
Les installations peuvent être de type industriel ou de recherche :
* Pour des installations industrielles (un réacteur EDF par exemple), le démantèlement bénéficie d’un effet de série, d’une certaine homogénéité et donc d’un retour d’expérience.
*
* Pour des installations de recherche comme au CEA (laboratoires, réacteurs de recherche), chaque installation est unique : on traite au cas par cas mais le retour d’expérience dans sa globalité est important.
Les opérations sont réalisées selon différents procédés chimiques, mécaniques, thermiques.
Pour les équipements ou les bâtiments contenant de la radioactivité (assainissement), ces techniques sont adaptées à l’environnement nucléaire et le chantier fait l’objet d’une organisation spécifique : travail en tenue de protection, périmètre d’intervention, sas de confinement…. Il s’agit d’éviter toute contamination radioactive des personnels et toute dissémination de matières radioactives dans l’environnement (poussières, effluents contaminés…). Si les opérations présentent un risque d‘irradiation pour les opérateurs, elles sont alors effectuées à distance au moyen d’engins robotisés.
Les déchets radioactifs générés sont acheminés vers les filières prévues à cet effet, gérées en France par l’Andra (Agence nationale de gestion des déchets radioactifs). Dans le cas de réacteurs, comme les matières les plus radiotoxiques ont été évacuées durant les opérations de « mise à l’arrêt définitif » de l’INB, les déchets radioactifs générés pendant le démantèlement sont en grande partie des déchets classés FA (faible activité) et TFA (très faible activité).
UNE GESTION SUR LE LONG TERME
La bonne gestion des opérations de démantèlement nucléaire permet de limiter l’impact des activités nucléaires passées pour les générations futures. Il s’agit donc d’un enjeu important pour la filière nucléaire.
Ainsi, d’un point de vue réglementaire, les exploitants nucléaires ont, en France, plusieurs obligations, édictées dans la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :
* Chaque exploitant a l’obligation d’établir un plan de démantèlement de ses installations à l’attention de l’ASN ;
*
* Chaque exploitant est également tenu d’évaluer les coûts relatifs au démantèlement futur de ses installations nucléaires et de constituer des provisions pour sécuriser le financement de ces travaux.
*
D’un point de vue technique, des actions de R&D sont réalisées afin de développer les technologies les plus adaptées : robotique, réalité virtuelle, nouveaux procédés chimiques ou mécaniques de décontamination... Au CEA, plusieurs innovations ont été mises au point ces dernières années pour faciliter les opérations de démantèlement nucléaire. Elles font souvent l’objet de transferts industriels.
Ces innovations constituent un enjeu de long terme pour les industriels. En effet, du fait de la mise en service d’un grand nombre d’installations nucléaires dans le monde durant les 50 dernières années, le démantèlement nucléaire devient peu à peu un secteur d’activités à part entière (en France, 9 réacteurs EDF et 21 installations civiles de recherche du CEA sont en cours de démantèlement ou de déclassement administratif et trois sont déjà déclassées).
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LASERS |
|
|
| |
|
| |
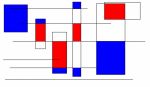
Indispensables, mais attention !
Les rayonnements laser présentent des risques plus ou moins importants pour l’oeil et la peau en fonction de leur puissance, du temps d'exposition, de la dimension du faisceau et de la longuer d'onde.
Publié le 30 juin 2015
Les rayonnements laser présentent des risques plus ou moins importants pour l’oeil et la peau en fonction de leur puissance (dès 1 mW), du temps d’exposition, de la dimension du faisceau et de la longueur d’onde (ultraviolet, infrarouge, voire visible). En fonction de ces paramètres, les effets biologiques ne sont pas les mêmes.
Les mécanismes d’interaction sur les tissus peuvent être thermiques, photochimiques, électromécaniques ou photo-ablatifs. Pour éviter cela, les laseristes isolent le plus possible les faisceaux laser (on parle de capotage de faisceau) et portent des lunettes spéciales.
LE DOMAINE ULTRAVIOLET (100-400 NANOMÈTRES)
Les effets photochimiques néfastes des rayonnements ultraviolets naturels (UV) sont bien connus. Ainsi, sur la peau, les lasers UV peuvent engendrer des brûlures photochimiques, un vieillissement prématuré voire des cancers. Certains lasers sont susceptibles de provoquer des coupures (ablations) dans le tissu cutané.
Pour ce qui concerne les yeux, et notamment la conjonctive et la cornée, des surexpositions au faisceau laser peuvent entraîner des brûlures. Grâce à des expérimentations cellulaires, les chercheurs ont montré que l’irradiation laser (193 nm) était considérée comme un stress par les cellules et que ce rayonnement pouvait déclencher un mécanisme de mort programmée (apoptose) dans des cellules de cornée en culture. L’activation d’une protéine régulatrice du devenir des cellules (la p53, « gardienne du génome ») a été également démontrée. Dans les cellules survivantes, l’induction d’un processus de photo-vieillissement est suggérée par les résultats obtenus.
LE DOMAINE VISIBLE ET PROCHE INFRAROUGE (400-1 400 NM)
Ce domaine de rayonnement laser peut être extrêmement dangereux en raison de sa pénétration à travers les milieux oculaires. Les rayons sont focalisés par la cornée et le cristallin sur la rétine, entraînant des diminutions de l’acuité visuelle, voire des risques de cécité. Les lésions peuvent être révélées lors d’examens angiographiques. Sur la peau, une surexposition aux rayonnements occasionnera des brûlures.
LE DOMAINE INFRAROUGE (1 400 NM-1 MM)
Ces rayons n’atteignent pas la rétine, mais entraînent des lésions thermiques de la cornée, ainsi que des pertes de transparence du cristallin. Des brûlures cutanées ont également été observées.
Les recherches réalisées au CEA permettent de mieux connaître les effets des rayonnements laser sur l’organisme, d’en apprécier les mécanismes moléculaires et de trouver des marqueurs biologiques des lésions de la cornée. Ces travaux sont nécessaires pour définir ou améliorer les limites d’exposition du fait de l’évolution technologique des lasers. Ils contribuent également à une meilleure utilisation du rayonnement laser dans le génie biomédical.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ] - Suivante |
|
|
|
|
|
|
