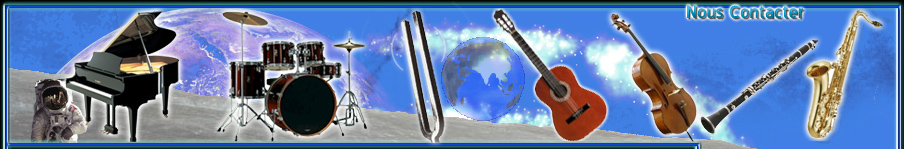|
|
|
|
 |
|
IANNIS XENAKIS |
|
|
| |
|
| |
Iannis Xenakis
Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la musique ».
Iannis Xenakis
Compositeur français d'origine grecque (Brăila, Roumanie, 1922 – Paris 2001).
Son père était agent d'import-export en Roumanie, et sa mère, qui aimait jouer du piano, mourut quand il avait cinq ans. Il s'inscrit à l'École polytechnique d'Athènes pour devenir ingénieur, tout en commençant des études musicales avec Aristote Kondourov. Quand les pays de l'Axe envahissent la Grèce, il entre dans la résistance communiste à laquelle il prend une part active et héroïque. En décembre 1944, au cours de combats, il est gravement blessé par un éclat d'obus de mortier : il en gardera une partie du visage endommagée, et un œil gauche aveugle. Il a parfois évoqué le rôle que cet accident a joué dans sa sensibilité : « Comme mes sens sont réduits de moitié, c'est comme si je me trouvais dans un puits, et qu'il me fallait appréhender l'extérieur à travers un trou (…) J'ai été obligé de réfléchir plus que de sentir. Donc je suis arrivé à des notions beaucoup plus abstraites. »
Mais son courage s'exerce encore une fois quand il reprend ses études et ses activités de résistance. Il entre dans la clandestinité, et, condamné à mort par contumace, s'enfuit de Grèce en 1947 avec une fausse carte (il n'y retournera que vingt-cinq ans plus tard environ, quand aura été mis en échec le régime fasciste).
Arrivant à Paris, il y trouve du travail comme ingénieur au cabinet de l'architecte Le Corbusier, avec lequel il travaillera, d'abord comme exécutant, puis en prenant une part de plus en plus active à ses travaux, jusqu'en 1959. Il n'obtiendra la nationalité française qu'en 1965. Et c'est en 1952 qu'il épouse une ancienne héroïne de la résistance française, la future romancière Françoise Xenakis.
Toujours désireux de composer, mais encore dans l'attente et dans la recherche de son style particulier, il suit divers enseignements musicaux : auprès d'Arthur Honegger (à l'École normale) et de Darius Milhaud. Mais c'est avec Olivier Messiaen, qui le prend en 1951 dans sa classe du Conservatoire de Paris, qu'il trouve un milieu d'enseignement accueillant, et une grande ouverture à sa propre pensée : l'auteur des Petites Liturgies l'encourage en effet à suivre sa voie et sa « naïveté ». Les premières œuvres de Xenakis sont déjà basées sur des spéculations abstraites, la recherche de proportions cosmiques, le projet de trouver une « expression mathématique de la musique ».
En même temps, il se met à collaborer de plus près aux projets architecturaux de Le Corbusier, concevant les plans du couvent de La Tourette et cherchant une voie d'unification entre l'architecture et la musique (cet esprit « unificateur » est un des traits qui le définissent le mieux, esthétiquement).
Mais l'œuvre qui devait le rendre célèbre, et où pour la première fois il livre au grand public sa recherche d'un nouveau type de discours musical, massique et statistique, c'est Metastasis pour 61 instruments jouant 61 parties différentes (1953-54). Cette œuvre est fondée sur les mêmes calculs et les mêmes configurations que ceux qui lui ont servi pour une de ses réalisations architecturales. C'est en quelque sorte un graphique, un ensemble de courbes au dessin très net, que le compositeur a projeté dans l'espace des sons, avec un sens très efficace de la durée : beaucoup d'œuvres de Xenakis sont ainsi comme un dépliement dans le temps d'une conception globale que l'on peut apprécier d'un coup d'œil, comme totalité, par sa représentation visuelle.
Metastasis est créé en 1955 au Festival de Donaueschingen, sans suite immédiate pour le compositeur ; et ce n'est que plus tard que son caractère révolutionnaire, par rapport au pointillisme sériel alors en pleine vogue, deviendra évident. Peu à peu sa théorie musicale se développe sous le nom de musique stochastique. Il prend contact avec des musiciens : d'abord avec le chef d'orchestre Hermann Scherchen, grand « découvreur » de nouveaux talents, animateur d'un studio de musique électroacoustique en Suisse, et qui publiera Xenakis dans sa revue et le soutiendra généreusement ; ensuite avec Pierre Schaeffer, qui, bien que ne partageant pas ses conceptions, l'accueille également très libéralement, en 1957, au Groupe de musique concrète, qui va devenir le Groupe de recherches musicales de la R.T.F.
Dans un article publié en 1955, la Crise de la musique sérielle, Xenakis précise sa découverte d'un principe de composition des sons comme masse, par moyennes statistiques, et s'opposant ainsi à la musique dodécaphonique. Comme le dit très bien Nouritza Matossian, dans son ouvrage sur Xenakis, « ces moyennes militaient contre les valeurs chères à la plupart des musiciens (…). Xenakis recherchait une vue panoramique afin de se distancier de la perspective étriquée du gros plan imposé par le sérialisme ». Pithoprakta, pour quarante-six cordes, deux trombones, xylophone et wook-block (1955-56), en est une première application, complètement dégagée de l'emprise sérielle et pointilliste encore sensible dans quelques passages de Metastasis.
Vers 1957, Xenakis entre en conflit avec Le Corbusier dans la revendication de la paternité du pavillon Philips de l'exposition de Bruxelles 1958. Le grand architecte se l'attribuait, mais finit par concéder que Xenakis en était le coauteur. Le spectacle lumineux donné à l'intérieur du pavillon (Poème électronique, avec la musique de Varèse, et une sorte d'interlude de musique concrète de Xenakis, Concret PH, 1958) est une première occasion pour lui de roder la conception de ses futurs spectacles de musique et de lumière.
Quant aux autres œuvres de musique concrète qu'il réalise au Groupe de recherches musicales (Diamorphoses, 1957 ; Orient-Occident, 1960), leur style très personnel est dû non seulement à son grand sens de la sonorité (qui, curieusement, sera moins efficace dans la plupart de ses œuvres électroacoustiques ultérieures), mais aussi à ce qu'elles sont pensées selon les mêmes modèles esthétiques que ses œuvres instrumentales : là encore, son esprit unificateur se manifeste.
Mais c'est l'époque où, dans le domaine instrumental, sa conception abstraite se durcit et s'affirme avec des œuvres comme Achorripsis, pour vingt et un instruments (1956-57), Duel pour deux orchestres (1959, œuvre de « musique stratégique », utilisant la théorie des jeux), Syrmos pour orchestre à cordes (1959), Analogiques A et B pour neuf cordes et bande magnétique, Herma pour piano (1960-61), ST/4 (1956), ST/10 (1956) et ST/48 (1956-1962), respectivement pour quatuor à cordes, dix instruments et grand orchestre. Ces pièces sont relativement arides par rapport à sa production plus « expressionniste » de la fin des années 60. Xenakis fut aussi, à travers certaines de ces pièces, un des premiers à s'intéresser à l'utilisation de l'ordinateur dans la composition.
La fin des années 50 voit le début d'un certain succès et d'une certaine reconnaissance par le public. L'ouvrage Musiques formelles, paru en 1963, marque une date en regroupant certains de ses articles théoriques et en divulguant ses hypothèses. Il est invité pour donner des cours aux États-Unis, à Tanglewood, puis à Berlin-Ouest. C'est alors qu'il compose, avec Polla tha Dina pour chœurs d'enfants et orchestre (1962), et Eonta (1963-64), des œuvres dont la simple et lumineuse robustesse, par rapport à l'esprit plus « corpusculaire » des œuvres qui précèdent, contribuera à intéresser à sa musique un public plus large. Cette musique apparaît de plus en plus comme une alternative, une autre voie plus excitante, dans une musique contemporaine jusqu'alors assez confinée, à quelques exceptions près.
Sa réputation grandit avec sa première expérience de musique orchestrale « spatialisée », faisant entrer l'auditeur au milieu des musiciens, comme si « chacun individuellement se trouvait perché au sommet d'une montagne au milieu d'un orage (…) soit dans une barque frêle que ballotte la pleine mer, soit encore au sein d'un univers parsemé de petites étoiles sonores » : c'est Terretektorh, pour 88 musiciens éparpillés dans le public (1965-66). Là, l'auteur manifeste son lyrisme cosmique, mais aussi son sens de l'efficacité et de l'essentiel, construisant une œuvre à la fois fidèle à sa conception mathématique, et produisant un « effet » puissant sur le public, qui reçoit l'œuvre (dirigée en 1966 par Hermann Scherchen au Festival de Royan) avec enthousiasme.
Désormais Xenakis a atteint la place de premier plan qu'il occupe toujours : des œuvres comme Nuits pour douze voix solistes (1968), Nomos Gamma pour 98 musiciens répartis dans le public (1969, prolongement de l'expérience de Terretektorh), Anaktoria pour octuor (1969), Synaphai pour piano et orchestre (1970), Persephassa pour six percussionnistes répartis autour du public (1969), confirment cette popularité par leur vitalité, leur chaleur, et leur solidité de conception. Leur succès coïncide avec l'ouverture d'un plus large public, en France, à la musique contemporaine. Xenakis devient alors un des compositeurs les plus sollicités par de nombreuses commandes, dont il s'acquitte avec la même continuité de style et la même vigueur, témoignant d'une belle stabilité alors même que d'autres compositeurs sont en crise et passent de l'abstraction sérielle au néoromantisme.
Ce succès lui permet de se voir confier des moyens plus importants pour réaliser ses projets de « spectacle total », compositions abstraites de sons et de formes visuelles (flashes, rayons lasers) dont il conçoit simultanément la « partition ». Les spectacles Hibiki-Hanama (1969-70) où, pour la seule fois, la « partition visuelle » n'est pas de lui, mais d'un artiste japonais, Persepolis (1971), Polytope de Cluny (1972), Diatope (1977), représentent différentes étapes de sa progression dans cette recherche d'une « musique audiovisuelle ». On peut malgré tout estimer qu'il n'a pas autant marqué ce domaine que le domaine proprement musical, le jeu avec le visuel restant chez lui assez théorique, et un peu pâle.
Il y reste cependant fidèle à lui-même, c'est-à-dire proche des phénomènes naturels élémentaires, dont ses œuvres réalisent la transposition de la sublimation abstraite, par l'intermédiaire de formulations mathématiques : une fois pour toutes, sa technique de composition, lentement mûrie et méditée, lui a permis de dépasser cette antinomie que beaucoup d'autres compositeurs instaurent entre l'abstrait et le concret. C'est l'emploi de modèles mathématiques et physiques qui lui permet de réaliser de véritables « tableaux vivants » de phénomènes naturels, orages, manifestations, bruits nocturnes, tout en conservant l'abstraction et la pensée pure.
En même temps, il poursuit ses recherches fondamentales au sein d'un groupe qu'il a rassemblé autour de lui, le C. E. M. A. M. U., et dont l'objectif est de réaliser la jonction art-science-technologie. L'existence et les réalisations de ce groupe ne seront connues du grand public que vers 1980, avec la mise au point de cet outil de réalisation pédagogique et musical qu'est la « machine à composer » appelée l'U. P. I. C. Parallèlement, sa production reste abondante et homogène, avec Aroura pour douze instruments (1971), Antikhton pour orchestre (1971), Linaia-Agon pour trois cuivres (1972), Eridanos pour six cuivres et cordes (1973), Evryali pour piano (1973), Cendrées pour chœur mixte et orchestre (1973), Erikhton pour piano et orchestre (1974), Gmeeorh pour orgue (1974), Noomena pour orchestre (1974), Empreintes pour orchestre (1975), Phlegra pour onze instrumentistes (1975), Psappha pour un percussionniste (1975), Khoaï pour clavecin (1976), Windungen pour douze violoncelles (1976), Akanthos pour flûte, clarinette, soprano, deux violons, alto, violoncelle, contrebasse et piano (1977), la Légende d'Er, bande magnétique pour le Diatope (1977), Jonchaies pour très grand orchestre (1977), Ikhoor pour trio à cordes (1978), Mycenae A pour bande magnétique (1978), Pléiades pour six percussions (1978), Palimpsest pour cinq instruments (1979), Anemoessa pour orchestre et chœur (1979), Mists pour piano (1980), Aïs pour baryton, percussion et orchestre (1980), Embellie pour alto (1980), Nekuïa pour chœurs et orchestre (1980), Shaar pour cordes (1982), Akea (1986), le concerto pour piano Keqrops (1986), Tracées (Paris 1987), Ata (Lisbonne 1988) pour orchestre, Okho pour percussions (1989), Kyania pour orchestre (1990), Roaï pour orchestre (1991), Dox Orkh pour violon et orchestre (1991), les Bacchantes d'Euripide pour chœur de femmes et instruments (1993). Certaines de ces œuvres évoluent vers un lyrisme plus direct, toujours tellurique, mais plus humain.
Reconnu plus tard que d'autres compositeurs, ayant mis plus de temps à se trouver, Xenakis s'est acquis en même temps une position plus forte, plus solide, qu'il maintient sans dévier, et sans se laisser porter par les courants divers qui agitent la musique contemporaine autour de lui. On ne développera pas ici sa théorie de la composition (→ STOCHASTIQUE), mais on évoquera sa musique telle qu'elle se donne à ses auditeurs. Indiscutablement méditerranéenne, vigoureuse, ignorant jusqu'à une date récente le clair-obscur et les états d'âme, elle a une manière bien à elle de sonner : les instruments y sont parfois poussés à leurs limites, mais toujours pour donner au son de la vie, de l'éclat. Dans son écriture, le hautbois, la flûte, le violon, la percussion, retrouvent la verdeur de son des instruments populaires dont ils sont les lointains cousins. Xenakis fuit les mélanges de sonorités à la Debussy ou à la Dutilleux, et il hait aussi le vibrato, préférant le son droit, un peu dur et acide.
Naturellement, ses procédés orchestraux tels que l'emploi de réseaux de glissandi entrecroisés aux cordes, ou bien les « nuages », c'est-à-dire les pluies de petites particules sonores, et les glissements en tiers de ton ont été souvent imités et reproduits dans une esthétique impressionniste et moins abstraite, moins structurée que la sienne. Mais surtout, Xenakis possède un don bien rare dans la musique d'aujourd'hui : il a le sens de l'essentiel et de la franchise, il sait ne pas charger le détail, simplifier sans appauvrir, au service de son propos, et affirmer la forme globale dans ses grands contours, sans se perdre dans les maniérismes ou l'enchevêtrement. Il n'est pas étonnant non plus qu'avec son indiscutable sens dramatique, ses diverses musiques de scène Hiketides, les Suppliantes (1964), Oresteia (1965-66), Médée (1967), Hélène (1977) soient bien conçues pour leur fonction.
Il y a évidemment chez Xenakis, au-delà du musicien, un architecte, et surtout un utopiste, d'esprit platonicien, rêvant de bâtir des villes cosmiques et de gagner l'auditeur à une nouvelle conscience du monde et de l'espace-temps. Les côtés un peu dogmatiques, inaccessibles au doute et messianiques de ce programme, tel que Xenakis lui-même le présente, seraient plutôt gênants si ce dernier n'était pas l'homme qu'il est : une personnalité dont l'indépendance, la responsabilité et l'esprit de suite qualités que l'on retrouve dans la facture de sa musique forcent le respect.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
CHINE : LA GRANDE FAMINE |
|
|
| |
|
| |
Chine : famine cachée, famine oubliée
MANON DURET
24 Juillet 2013
Entre 1958 et 1961, 36 millions de Chinois sont morts de faim. La famine a décimé les campagnes dans le silence et l’indifférence des cadres du régime communiste, pour une grande part responsables de la catastrophe. Plus de 50 ans après, cette famine si bien cachée est presque oubliée.
Crédit Photo -- MacMurray Photograph Additions, Volume VI, #22
Crédit Photo -- MacMurray Photograph Additions, Volume VI, #22
La Grande famine en Chine a duré trois ans, de l’été 1958 à 1961. Les chiffres officiels de la catastrophe depuis les années 1980 donnent une estimation de 15 millions de morts. Aujourd’hui les historiens pensent que la famine est responsable de la mort de 30 à 60 millions de personnes. Les écarts de chiffres et la fourchette approximative montrent à quel point on a voulu occulter le passé et pointent du doigt la méconnaissance des faits de la part des historiens encore actuellement.
Un journaliste chinois, Yang Jisheng, a enquêté pendant quinze ans pour rassembler les faits et tenter d’expliquer ce qui a conduit à un désastre d’une telle ampleur. Lorsqu’il avait 19 ans, son père est mort de faim. Il a alors pensé que son village natal était un cas isolé. Devenu journaliste quelques années plus tard, il a réalisé que la famine avait touché les campagnes de toute la Chine, et principalement quatre provinces centrales sans que l’on n’en sache rien au niveau national. Il a alors rassemblé témoignages et archives officielles, dénombrant au moins 36 millions de victimes, mettant en lumière des villages rayés de la carte, des charniers et des histoires atroces. L’œuvre monumentale qu’il a rédigée à la suite de son enquête est désormais traduite, et abrégée, sous le titre Stèles, la grande famine en Chine, 1958-1961. Son ouvrage constitue désormais l’un des livres de référence, encore rares sur la question. L’auteur dit avoir voulu élever des « stèles de papier » à son père et à toutes les victimes de la famine pour qu’on ne les oublie pas et que l’on comprenne les mécanismes de la Chine communiste qui ont mené à la famine.
La question centrale du livre de Yang Jisheng est de savoir comment une famine si importante a pu avoir lieu. Pour lui, « c’est une tragédie sans précédent dans l’histoire de l’humanité que, dans des conditions climatiques normales, en l’absence de guerre et d’épidémie, des dizaines de millions d’hommes soient morts de faim et qu’il y ait eu du cannibalisme à grande échelle ». Car bien que le régime ait longtemps proclamé que la famine avait été une catastrophe naturelle, due à des problèmes climatiques, on sait désormais que le facteur humain est la principale cause de cette famine.
LE « GRAND BOND EN AVANT » ET LE SYSTÈME TOTALITAIRE
À l’origine de la période de famine, il y a une décision politique. Le PCC (Parti Communiste Chinois) au pouvoir depuis 1949 en Chine, dirigé par Mao, décide entre 1956 et 1957 d’accélérer l’évolution de la société vers le modèle communiste. Confiant dans la marche vers l’idéal, et rassuré par les bons chiffres des plans quinquennaux précédents, il décide d’accélérer la collectivisation des terres pour passer d’une économie dite « socialiste », après la réforme agraire juste aboutie, à une économie dite « communiste ». Mao prône une accélération de la production industrielle afin de rattraper au plus vite les grandes puissances occidentales, avec des slogans comme « l’Angleterre en dix ans ! ». Certains membres du parti tentent de s’opposer à cette politique qu’ils jugent « aventuriste » et dangereuse pour la société. On les fait taire en préférant au terme d’« aventurisme » le terme de « grand bond en avant » qui définit une politique sociétale et économique ambitieuse, mais nécessaire selon le Président Mao.
Concrètement cette politique s’est traduite dans les campagnes par une suppression de la propriété privée et la mise en place de ce qu’on a appelé les « communes populaires ». Les communes populaires sont des regroupements de villages à l’échelle du canton voire au-delà qui vont constituer l’unité de base de la production agricole et industrielle et régir la vie des habitants. Toutes les récoltes sont rassemblées, tous les habitants travaillent pour le compte de l’État qui redistribue une partie des produits aux paysans et envoie l’autre dans les villes. On réquisitionne le matériel agricole, les meubles, et même les casseroles pour la production d’acier. La cellule familiale est abolie et on crée des cantines populaires où toute la population doit manger. On veut créer une société nouvelle, moderne, industrielle et communiste.
Ce système aurait pu fonctionner sans un climat de surenchère intimé par le PCC et répercuté par les pouvoirs locaux. L’État en demandait toujours plus et ceux qui avouaient ne pas pouvoir suivre la cadence étaient taxés d’anti-régime, de « droitiers ». Un système totalitaire se caractérise par une organisation hiérarchique ou chacun veut plaire, craint et obéit à son supérieur et fait peser une forte pression sur son subalterne. La toute-puissance du Parti Communiste, organe du pouvoir présent à tous les échelons, de Mao jusqu’aux chefs de districts, a mené à cette situation incontrôlable : les cadres locaux recevaient l’ordre d’augmenter les rendements de blé et de riz. Ils demandaient aux paysans d’en faire plus pour plaire au parti. La récolte ne suivant pas, les cadres locaux donnaient à leurs supérieurs des chiffres faux pour maintenir leur rang. Les dirigeants du Parti avaient donc la sensation que leurs directives étaient suivies et fonctionnaient.
Lorsque la faim a commencé à se faire sentir, rien n’a pu l’endiguer. La population était épuisée par les efforts industriels qu’elle fournissait pour suivre la cadence imposée par le régime. Les paysans devaient quitter leurs champs pour faire de l’acier. Les familles n’avaient plus la possibilité d’être autosuffisantes, la propriété d’un lopin de terre ayant été bannie. Par peur du parti, les cadres empêchèrent toute communication entre les villages affamés et les villes, rendant tout ravitaillement d’urgence impossible. Les directives du Grand Bond en Avant et l’organisation hiérarchique fondée sur l’obéissance et la peur ont donc mené les campagnes à cette catastrophe.
« AVEC AUTANT DE MORTS DE FAIM, L’HISTOIRE RETIENDRA NOS DEUX NOMS, ET LE CANNIBALISME AUSSI SERA DANS LES LIVRES ».
C’est ce que Liu Shaoqi dit à Mao Zedung en 1962, effrayé des conséquences qu’il entrevoyait déjà de la politique dite du « Grand Bond en Avant ». Ainsi les dirigeants connaissaient la tragédie en cours malgré les chiffres erronés qu’ils recevaient. Zhou Xun, universitaire de Hong Kong rapporte même que dès mars 1959 Mao a proclamé : « Répartir les ressources de manière égale ne peut que faire échouer le Grand Bond en Avant. Lorsqu'il n'y a pas assez à manger, les gens meurent de faim. Mieux vaut laisser mourir la moitié des gens, de façon à ce que l'autre moitié puisse manger à sa faim ». L’idéal communiste et industriel valait donc bien que l’on sacrifie la moitié de la population qui comprenait alors 700 millions de Chinois. Malgré les tournées d’inspection de Liu Shaoqi et bien d’autres, Mao et les partisans de la « ligne » ont longtemps refusé de revoir le plan à la baisse. En 1962 seulement, Mao finit par déclarer sous la pression de certains cadres que le Grand Bond en Avant a réussi et peut donc être arrêté.
Force est de constater que la peur de Liu Shaoqi ne s’est pas encore accomplie et si l’Histoire retient Mao, elle a oublié la famine. Cinquante ans après on connaît mal les faits, à peine les causes. En France, on ne sais rien de Liu Shaoqi, l’un des plus hauts dirigeants du PPC qui dirigea officiellement le pays de 1959 à 1968. Le déni des faits est resté longtemps la règle, ce n’est qu’avec l’ouverture de Deng Xiaoping dans les années 1980 que le Parti a reconnu la famine comme une catastrophe « à 70% naturelle ». Laissant aux populations le soin de comprendre ce qu’il en était des 30% restants. L’ampleur de la famine, ses conséquences sur l’économie, la démographie ont été occultées. Les rares travaux des Occidentaux sur le sujet n’ont pu se baser sur aucune preuve solide. Les archives ouvertes un temps sur cette période sombre ont été refermées récemment après plusieurs recherches. Le gouvernement chinois n’est pas encore prêt à dévoiler ce pan de l’Histoire qui met en lumière les dérives du communisme et fragilise le régime. Les facteurs terrifiants de la grande famine font réfléchir sur les dérives totalitaires, au-delà du manque de liberté d’expression, c’est ici la soumission d’un peuple à une idéologie, qui entraine la mort de la population sans remettre en cause le régime. Il est nécessaire et urgent de faire ressortir ces événements de l’oubli, au même titre que l’Holocauste et d’autres tragédies humaines, pour en démonter les mécanismes. Les livres d’Histoire se taisent encore sur l’un des plus grands drames du XXe siècle.
DOCUMENT lejournalinternational.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LE CHAR ÉGYPTIEN |
|
|
| |
|
| |
SUJET: LE CHAR ÉGYPTIEN
Le char égyptien le 09 décembre 2014 à 10:30 #144047
kymiou
Hoquets des roues sur les cailloux, martèlements de sabots, grands hue et dia des charriers, bruit mou des corps percutés par les caisses, gémissements des premiers tombés, et par dessus-tout, le claquement des arcs et le sifflement des flèches... surtout le sifflement des flèches ! Gageons que votre dernière vision en ce bas-monde ressemblera à celle-ci :
Arrivés sur le tard
L'Egypte fut la dernière civilisation d'orient classique à adopter le char, bien après la Mésopotamie où on le pratiquait depuis le début du IIIème millénaire. Il est vrai que la traction d'alors était assurée par des onagres, de grands ânes à la puissance insuffisante et peu portés aux actions militaires du fait de la placidité de leur tempérament.
Pendant ce temps-là, les armées égyptiennes ne combattaient que du nomade ou de la tribu pastorale, des gens dont l'armement procédait du néolithique amélioré. Aucune course aux armements n'étant nécessaire, le troupier de Pharaon traînait la même panoplie de cuivre depuis un bon millénaire, hache, poignard, bouclier, et surtout l'arc parce qu'il combine la guerre et la chasse et qu'il est toujours bon de pouvoir améliorer l'ordinaire. Du reste, les Nouhou, ces guerriers patrouillant à la frontière libyque, étaient qualifiés de chasseurs du désert.
Mais tout change vers 1750 av. J.-C., quand des nomades un peu mieux organisés que les autres, les Hyksôs, crèvent les frontières du Sinaï avec des chars attelés de chevaux et des armes en bronze. Il faudra deux siècles aux Pharaons, confinés en zone libre dans le Sud, pour s'en remettre et assimiler à leur tour les bases de la charrerie de combat. Il n'y parvinrent pas trop mal puisque vers -1540, Ahmès Ier libère enfin ses territoires et, dans la foulée, prolonge son offensive jusqu'à l'Euphrate, notamment pour accéder au trafic chevalin entre le Caucase et la Mésopotamie.
Les chevaux en question n'étaient guère plus grand que des poneys et devaient être proche, tout au moins au début, du Tarpan, une race dont la disparition en tant qu'espèce sauvage se situerait au début du XXème siècle.
Mais il ne suffit pas d'atteler une paire de chevaux pour vous la jouer façon « charge héroïque ». Ce qu'on attend d'eux est anti-naturel. Aussi fallait-il les entraîner longuement à la manière d’athlètes de haut niveau selon des méthodes rapidement codifiées. Elles donnèrent lieu à une sorte de best-seller : L'art d'entraîner et de soigner les chevaux, du mitannien Kikkuli, écrit vers 1400 av. J.-C.
Le royaume du Mitanni, mi-hourrite mi-indo-européen, campé sur la Haute-Mésopotamie, fut le premier adversaire oriental de taille pour l'empire égyptien renaissant. Les deux puissances finirent par conclure un traité s'ouvrant sur une alliance et une paix stable. C'est sans doute à cette époque que l'ouvrage de Kikkuli – jusque-là secret défense – commença à circuler. On n'en a pas retrouvé en Égypte mais comme ses tablettes en ont été mises au jour à Hattusa, la capitale des Hittites, les Égyptiens en ont sûrement eu connaissance.
Kikkuli préconise une entraînement s'étalant sur 214 jours et, pour l'essentiel, axé sur l'endurance... et le confort des chevaux. Il s'agit de sorties, non attelées, faisant alterner de longs trots et de brefs galops suivis de courts repos, un peu comme un jogging entrecoupé de sprint.
Une fois rentré dans son box individuel, l'animal est massé, rincé à l'eau tiède et régalé d'épeautre, d'orge et de foin trois fois par jour.
Sous Ahmès, le char ne paraît pas avoir été utilisé en groupes massifs, faute de chevaux en nombre suffisant. Les artisans capables de construire des chars devaient, eux aussi, être encore fort rares. Ainsi voit-on un officier du pharaon, Ahmès fils d'Abana, raconter dans sa biographie qu'il « suivait le pharaon à pied quand il se déplaçait sur son char ». On peut imaginer quelques combattants assez riches pour pouvoir s'acheter un char et deux chevaux, marchant en tête d'une escouade de fantassins chargés d'exploiter les succès ou couvrir les retraites à la manière des panzergrenadiers !
Il faut dire aussi que ces chars égyptiens de la première heure laissaient beaucoup à désirer. D'abord, leur essieu se trouvait au milieu de la caisse, juste sous le conducteur qui pouvait sentir le moindre caillou ou la moindre bosse de la piste. Ensuite, les roues à quatre rayons manquaient de rigidité et imprimaient des vibrations aussi préjudiciables à la cohésion de la caisse qu'aux ménisques du charrier !
Mais le char connaîtra des décennies de progrès techniques qui induiront des unités de plus en plus nombreuses, avec, en apothéose, les milliers d'attelages présents à la bataille de Kadesh (-1274?). Cette date marque un sommet mais aussi le commencement de la fin. Par la suite, le char perdra progressivement sa prééminence au profit du cavalier, pas tellement parce que les chevaux devenaient plus forts, comme on l'a souvent dit, mais plutôt à la suite des progrès intervenus dans l'art de l'équitation.
Cet atelier exhibe ces roues à huit rayons qui furent sans lendemain. On aperçoit par ailleurs des éléments d'attelage comme les fourches de collier.
Le souci constant des artisans fut d'augmenter la solidité, la stabilité et le confort de l'ensemble sans l'alourdir. Il devait être démonté et remonté rapidement et chaque élément devait pouvoir être porté par un seul homme, l'ensemble ne pouvant pas peser plus de 50 kgs. C'était un sacré cahier des charges !
Transport d'un char démonté. Le premier personnage porte le raidisseur, le second le timon, le troisième la caisse et un carquois. Le suivant guide le cheval et le dernier suit avec du petit matériel.
Les roues.
La confection d'un char, c'est avant tout une histoire de biceps et de pliage à chaud, par vapeur ou eau bouillante. Alors que leurs homologues asiatiques, plus massifs, utilisent essentiellement le cèdre, les Egyptiens ont opté pour le frêne et l'orme. Sont ainsi formés à chaud le timon, le garde-fou et même les rayons.
Les rayons, justement, montrent toute l'ingéniosité de l'époque. Il ne s'agit pas de barres fixées entre le moyeu et la jante, mais des éléments pliés en « V », chaque branche étant un demi-rayon collé à son voisin.
Des essais avaient été réalisés avec des roues à huit rayons mais les « V » devaient être pliés à 45°, ce que le bois ne pouvait sans doute pas supporter sans déchirures. Dès lors, les roues à six rayons (ne nécessitant qu'un pliage à seulement 60°) devinrent la règle. Cette « rosace » était alors collée à un centre sculpté sur mesures, la jante venant couronner le tout par tenons et mortaises.
Le moyeu est emmanché sur un tube pour mieux répartir les forces de levier sur l'essieu dans les virages et aussi augmenter la surface lubrifiée entre ces deux éléments. Ces tubes augmentaient d'autant la voie, c'est à dire la distance entre les deux roues et c'était tout bénéfice pour la tenue de route et la stabilité du char. Nos formules 1 ne sont pas conçues autrement.
Une fois la roue en place, une clavette vient l'y bloquer, maintenue par un simple lacet.
La caisse.
Il n'y ni plus simple ni plus léger. Une simple cadre en demi-cercle tendu d'un clayonnage de lanières de cuir et surmonté d'un garde-fou enveloppant en bois façonné à chaud. Seule la partie centrale de ce garde-fou est tendue d'une pièce de cuir ; sur les chars les plus riches, ce cuir est recouvert de lin enduit de gypse sculpté en plat-relief ou même, grand luxe réservé aux rois et aux plus grands seigneurs, orné d'un plaquage d'or, d'argent ou d'électrum.
Mais les côtés du garde-fou restent ouverts, et nous en verrons la raison plus loin.
Le coup de génie de la suspension.
Mais comment assurer un minimum de confort en cette époque ignorant tout du caoutchouc sans parler du reste ? Considérez ce char, célèbre entre tous puisqu'il s'agit de celui de Toutânkhamon.
A l'avant-plan, le joug auquel est fixé le timon qui plonge sous le char pour s'ancrer par une mortaise dans l'essieu, lequel est tout à l'arrière de la caisse. Le raidisseur disposé entre le timon et le garde-fou n'est là que pour empêcher la caisse de tourner autour de son essieu. L'essentiel est que ce timon n'est réellement fixé qu'à ses deux extrémités, à l'avant au niveau du garrot des chevaux, à l'arrière à l'extrémité du char.
Le timon ploie donc comme un arc, disons plutôt comme un ressort à lame, sous le poids des occupants de la caisse. Ces derniers bénéficient donc d'une suspension Hi-tech pour l'époque, à laquelle il convient encore d'ajouter le tressage de cuir qu'ils foulent de leurs pieds. Qui dit mieux ?
L'attelage.
Les chevaux sollicités sont toujours des étalons « complets ». Etant donné leur fougue naturelle, il importe que leur harnachement leur soit supportable, sous peine de les voir s'énerver et réduire le char en petit bois à coups de ruades !
Notez que pour la tenue des charriers, l'illustrateur mélange les époques. Au Nouvel Empire, la cuirasse (ou le corselet à bretelles) en écailles de cuir ou de bronze est généralisée.
Le timon est fixé en son sommet à un joug, rappelant les cornes d'un buffle, reposant sur le garrot des deux chevaux par l'intermédiaire d'une fourche complétée d'un coussinet destiné à les protéger des blessures par frottement.
L'ensemble est maintenu en place par une sous-ventrière et une bricole passant sur le poitrail. Comme c'est là que pèse tout l'effort de traction de l'animal et qu'il peut en ressentir de l'étranglement, cette bricole est très large afin de répartir la pression sur un maximum de surface.
Un système classique de mors et de muserolle, avec ou sans œillères, assure la conduite.
A noter que ce char marque une étape intermédiaire pour ce qui concerne la place de l'essieu, qui est encore trop près du milieu. Ce sera le cas jusqu'au années -1400, règne de Thoutmès IV. Par la suite, l'essieu sera rejeté en arrière le plus loin possible, comme ceci. A noter que cette disposition, destinée à l'excellence de la suspension, offre l'avantage supplémentaire de supprimer tout porte-à-faux, ce qui devait éliminer le survirage. Encore une technique de formule 1. Ces chars pouvaient littéralement tourner sur place, même à grande vitesse (+/-40 kms/h).
Auriez-vous le permis ?
Pour parfait qu'il soit, ce char n'accepte pas l'improvisation. Les chevaux doivent être longuement entraînés, autant à tirer le char et obéir aux sollicitations des rênes qu'à se supporter mutuellement – ce sont des étalons : en général, ils ne s'aiment pas.
Pour les deux occupants du char, en principe un archer et un aurige, il y a intérêt à répéter les bons mouvements. Dans les évolutions les plus rapides, il fallait sans doute compenser les forces en se déportant à la manière du « singe » dans les courses de motos side-car. Un coup à gauche, un coup à droite ! A l'heure du combat, l'archer avait besoin de ses deux mains. Il ne pouvait se caler qu'en engageant un genou dans l'ouverture ménagée de chaque côté de la plaque de cuir avant.
Si l'on passait aux armes de choc, piques et khopesh, la secousse du coup pouvait vous arracher du char ; on prévenait ce danger en adoptant une position plus acrobatique. Comme ceci.
Le pied du roi s'appuie sur le timon hors de la caisse ! A-t-il carrément enjambé le garde-fou ou simplement passé le pied par l'ouverture à côté du fronton ? L'art égyptien obéissant à certaines règles d'esthétisme, il est difficile de trancher. Mais ce pied avancé apparaît toujours quand Sa Majesté manie la lance ou l'épée, jamais quand elle tire à l'arc. Cela doit bien signifier quelque chose.
Les tactiques
On en sait peu de choses et le débat reste largement ouvert. L'arme normale du char égyptien, c'est l'arc. Les reliefs des temples en témoignent. Ils ne sont clairement pas bâtis pour le choc frontal.
Le souci quasi obsessionnel de légèreté, de maniabilité et de stabilité induit une tactique probablement proche de celle des archers montés : une succession d'attaques et de retraites. On pense aux Parthes, aux Turcs, aux Mongols et même à la caracole de la Renaissance (avec des pistolets). L'archer égyptien a à sa disposition quatre carquois, deux de chaque côté. Avec un arc basique, il tire à 70 mètres ; le double s'il utilise un arc composite avec bois, tendons et fibres de corne. Cadence : une dizaine de flèches à la minute.
Une possibilité est que les chars longeaient la ligne de front ennemie en la lardant de flèches tirées de côté, un peu à la manière des archers montés japonais pratiquant le yabousame sur des cibles. Mais une aussi longue exposition à la riposte semble incompatible avec l'absence de boucliers chez les charriers égyptiens.
Plusieurs mouvements en noria – je m'approche, je m'éloigne, je reviens, etc... - pratiqués simultanément par plusieurs groupes de chars se suivant en files, me paraît plus probable. Ce système permet un temps d'arrêt éventuel pour ceux qui reviennent et auraient, par exemple, à se réassortir en flèches ou remplacer un cheval blessé ou boiteux (pas de fers à cette époque). Tôt ou tard, les bataillons à pied les plus tenaces devait se disloquer devant ce type d'attaque.
Bien sûr, il en allait tout autrement lorsque l'adversaire opposait, lui aussi, des escadrons de chars. Dans ce cas, la charge s'opérait en ligne et tournait très vite en grand désordre :
Il s'agit de Ramsès II. Pas question de mettre un quidam en valeur aux côtés de Sa Majesté mais... regardez bien : il y a deux coudes droits en arrière, deux bras gauches tendus et surtout deux arcs. De là à imaginer qu'à l'heure de l'attaque, l'aurige faisait lui aussi le coup de flèche, il n'y a qu'un pas. Et qui dirige l'attelage ? direz-vous. Eh bien, tout cheval a tendance à suivre celui qui le précède. Il suffit d'encourager cette habitude par l'entraînement. Les chars de la « caracole » se placent en file puis s'élancent. Seul le premier aurige doit conserver ses rênes. C'est en quelque sorte la locomotive que tous les autres suivent comme des wagons.
Puissance de feu doublée. C'est l'enfer qui devait tomber du ciel sur les clients d'en-face !
Et contre les chars hittites ?
Ceux-ci pratiquent tout autre chose. La tradition nord-mésopotamienne et environs, c'est du costaud, du lourd et du blindé. Le char hittite, comme plus tard son pareil assyrien, transporte trois hommes équipés avec du pesant, dont le bouclier.
Ils pratiquaient certainement le choc direct et cherchaient à éparpiller leurs adversaires avant de les réduire, quitte à combattre à pied. Après tout, si mille chars hittites défoncent une de vos divisions, c'est trois mille combattants ennemis parachutés au milieu de votre dispositif ! C'est ce qui se passa dans la première phase de la bataille de Kadesh.
Toute l'opposition des conceptions hittites et égyptienne est là : transport de troupes blindés contre Ferrari-mitrailleuses . Ils ne pouvaient pas vraiment se rencontrer sur un terrain commun. Fort logiquement, cela se termina par un traité de paix.
Et au quotidien.
On a quand même quelques indications sur la vie de ces charriers quand ne sonnaient pas les trompes de bataille. Dans le couloir syro-palestinien, les Egyptiens furent longtemps une force d'occupation avec ce que cela implique comme vie de garnison, patrouilles, missions en solitaires et revues de détail.
Au début, le coût élevé d'un attelage le destinait à des aristocrates, genre grands féodaux, à la bourse bien remplie. Avec la généralisation du char comme moyen de combat principal, on passa au recrutement en masse, ouvert à des recrues équipées par Pharaon et dès lors soumises à une discipline de fer. Sous les Ramsès, un certain Pibès évoque le « rude métier de militaire servant dans les troupes de chars ». Et il parle d'un adolescent engagé comme palefrenier dans les écuries royales et qui, une fois adulte et pris par l'ambiance, vend son héritage et s'achète un char : le timon pour 3 deben, le char lui-même pour 5 deben. Il s'expose alors à diverses mésaventures avant de tout perdre, ce qui lui vaut 100 coups de bâton.
Un autre haut-fonctionnaire militaire, Hori, évoqua lui aussi les malheurs des charriers :
« Tu fais halte le soir, ton corps est moulu. Tu t'éveilles et il est temps de décamper dans la nuit lugubre... Mais des voleurs sont passés. Tes chevaux ont été détachés. Ton aurige s'en est aperçu dans le noir et décide de voler ce qui reste pour rejoindre les méchants... » Plus loin :
« Le défilé est occupé par des Bédouins cachés dans les buissons. Certains sont hauts de quatre coudées avec des figures sauvages. Leur cœur n'est pas bienveillant... Tu es seul. Nulle troupe ne te suit et personne pour te guider. Tes chevaux s'effarouchent et rompent leurs liens. L'angoisse te saisit, tes cheveux se hérissent et ton cœur est dans ta main. La route est encombrée d'éboulis et partout des épines et des ronces. D'un côté le précipice, de l'autre la montagne abrupte. »
Comme quoi les grandeurs et misères de la vie militaire sont de tous les temps.
Une longue, longue, décadence.
Le char égyptien connu le sort de ses homologues asiatiques : une interminable fin. Comme véhicule de parade, ou parce qu'il présentait bien sur les fresques et reliefs, on en conserva longtemps l'image mais la cavalerie montée le supplanta très rapidement après le sommet que constitua Kadesh. Au grand étonnement des contemporains, peut-être.
En pleine ère du char, un sculpteur égyptien grava ce... cavalier et on sent qu'il y mit beaucoup de malice. On voit l'homme en équilibre instable sur la croupe du cheval comme il le serait sur un âne. Il crispe une main sur ses rênes, l'autre sur un bâton, mais on voit bien qu'il ne sait qu'en faire. Cette pratique semble décidément n'avoir aucun avenir !
Un dernier point. Le concept de légèreté, stabilité et souplesse du char égyptien n'a pas entièrement disparu. Son ultime avatar existe toujours et on le voit régulièrement sans que nul ne s'en étonne. C'est le sulky des courses de trot attelé.
DOCUMENT strategietotale.com LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
ECRITURE |
|
|
| |
|
| |
écriture
(latin scriptura)
Cet article fait partie du dossier consacré à la Mésopotamie.
Système de signes graphiques servant à noter un message oral afin de pouvoir le conserver et/ou le transmettre.
HISTOIRE
Toutes les civilisations qui ont donné naissance à une forme d'écriture ont forgé une version mythique de ses origines ; elles en ont attribué l'invention aux rois ou aux dieux. Mais les premières manifestations de chaque écriture témoignent d'une émergence lente et de longs tâtonnements. Dans ces documents, les hommes ont enregistré : des listes d'impôts et des recensements ; des traités et des lois, des correspondances entre souverains ou États ; des biographies de personnages importants ; des textes religieux et divinatoires. Ainsi l'écriture a-t-elle d'abord servi à noter les textes du pouvoir, économique, politique ou religieux. Par ailleurs, les premiers systèmes d'écriture étaient compliqués. Leur apprentissage était long et réservé à une élite sociale voulant naturellement défendre ce statut privilégié et qui ne pouvait guère être favorable à des simplifications tendant à faciliter l'accès à l'écriture, instrument de leur pouvoir.
À partir du IIIe millénaire avant J.-C., toutes les grandes cultures du Proche-Orient ont inventé ou emprunté un système d'écriture. Les systèmes les plus connus, et qui ont bénéficié de la plus grande extension dans le monde antique, demeurent ceux de l'écriture hiéroglyphique égyptienne et de l'écriture cunéiforme, propre à la Mésopotamie. L'écriture égyptienne est utilisée dans la vallée du Nil, jusqu'au Soudan, sur la côte cananéenne et dans le Sinaï. Mais, pendant près d'un millénaire, l'écriture cunéiforme est, avec la langue sémitique (l'assyro-babylonien) qu'elle sert à noter, le premier moyen de communication international de l'histoire. L'Élam (au sud-ouest de l'Iran), les mondes hittite (en Anatolie) et hourrite (en Syrie du Nord), le monde cananéen (en Phénicie et en Palestine) ont utilisé la langue et l'écriture mésopotamienne pour leurs échanges diplomatiques et commerciaux, mais aussi pour rédiger et diffuser leurs propres œuvres littéraires et religieuses. Pour leur correspondance diplomatique, les pharaons du Nouvel Empire avaient eux-mêmes des scribes experts dans la lecture des textes cunéiformes.
À la même époque, d'autres systèmes d'écriture sont apparus, mais leur extension est limitée : en Anatolie, le monde hittite utilise une écriture hiéroglyphique qui ne doit rien à l'Égypte. Dans le monde égéen, les scribes crétois inventent une écriture hiéroglyphique, puis linéaire, de 80 signes environ, reprise par les Mycéniens.
Au Ier millénaire, l'apparition de l'alphabet marque une histoire décisive dans l'histoire de l'écriture. Depuis des siècles, l'Égypte dispose, au sein de son écriture nationale, du moyen de noter les consonnes. Au xive siècle avant J.-C., les scribes d'Ougarit gravent sur des tablettes d'argile des signes cunéiformes simplifiés et peu nombreux, puisqu'ils ne sont que 30, correspondant à la notation de 27 consonnes et de 3 valeurs vocaliques. Mais les uns et les autres ne font pas école. Ce n'est qu'après le xie siècle que le système d'écriture alphabétique se généralise à partir de la côte phénicienne. Une révolution sociale accompagne cette innovation radicale : les scribes, longuement formés dans les écoles du palais et des temples, voient leur rôle et leur importance diminuer.
Le système cunéiforme
Le premier système d'écriture connu apparaît dans la seconde moitié du IVe millénaire avant notre ère, en basse Mésopotamie, pour transcrire le sumérien. Dans l'ancienne Mésopotamie, les premiers signes d'écriture sont apparus pour répondre à des besoins très concrets : dénombrer des biens, distribuer des rations, etc. Comme tous les systèmes d'écriture, celui-ci apparaît donc d'abord sous forme de caractères pictographiques, dessins schématisés représentant un objet ou une action. Le génie de la civilisation sumérienne a été, en quelques siècles, de passer du simple pictogramme à la représentation d'une idée ou d'un son : le signe qui reproduit à l'origine l'apparence de la flèche (ti en sumérien) prend la valeur phonétique ti et la signification abstraite de « la vie », en même temps que sa graphie se stylise et, en s'amplifiant, ne garde plus rien du dessin primitif.
Les pictogrammes de l'écriture cunéiforme
Trouvées sur le site d'Ourouk IV, de petites tablettes d'argile portent, tracés avec la pointe d'un roseau, des pictogrammes à lignes courbes, au nombre d'un millier, chaque caractère représentant, avec une schématisation plus ou moins grande et sans référence à une forme linguistique, un objet ou un être vivant. L'ensemble de ces signes, qui dépasse le millier, évolue ensuite sur deux plans. Sur le plan technique, les pictogrammes connaissent d'abord une rotation de 90° vers la gauche (sans doute parce que la commodité de la manipulation a entraîné une modification dans l'orientation de la tablette tenue en main par le scribe) ; ultérieurement, ces signes ne sont plus tracés à la pointe sur l'argile, mais imprimés, dans la même matière, à l'aide d'un roseau biseauté, ce qui produit une empreinte triangulaire en forme de « clou » ou de « coin », cuneus en latin, d'où le nom de cunéiforme donné à cette écriture.
Le sens des pictogrammes cunéiformes
Sur le plan logique, l'évolution est plus difficile à cerner. On observe cependant, dès l'époque primitive, un certain nombre de procédés notables. Ainsi, beaucoup de ces signes couvrent une somme variable d'acceptions : l'étoile peut tour à tour évoquer, outre un astre, « ce qui est en haut », le « ciel » et même un « être divin ». Par ailleurs, les sumériens ne se sont pas contenté de représenter un objet ou un être par un dessin figuratif : ils ont également noté des notions abstraites au moyen de symboles. C'est ainsi que deux traits sont parallèles ou croisés selon qu'ils désignent un ami ou un ennemi.
Le sens peut aussi procéder de la combinaison de deux éléments graphiques. Par exemple, en combinant le signe de la femme et celui du massif montagneux, on obtient le sens d'« étrangère », « esclave ».
Tous ces signes, appelés pictogrammes par référence à leur tracé, sont donc aussi des idéogrammes, terme qui insiste sur leur rôle sémantique (leur sens) et indique de surcroît leur insertion dans un système. L'écriture cunéiforme dépasse ensuite ce stade purement idéographique. Un signe dessiné peut aussi évoquer le nom d'une chose, et non plus seulement la chose elle-même. On recourt alors au procédé du rébus, fondé sur le principe de l'homophonie (qui ont le même son). Ce procédé permet de noter tous les mots et ainsi des messages plus élaborés.
L'écriture des Akkadiens
Cependant, les Sumériens considèrent les capacités phonétiques des signes, nouvellement découvertes, comme de simples appoints à l'idéographie originelle, et font alterner arbitrairement les deux registres, idéographique et phonographique. Lorsque les Akkadiens empruntent ce système vers − 2300, ils l'adaptent à leur propre langue, qui est sémitique, et font un plus grand usage du phonétisme, car, à la différence du sumérien, dont les vocables peuvent se figurer par des idéogrammes toujours identiques, flanqués d'affixes qui déterminent leur rôle grammatical, l'akkadien renferme déclinaisons et conjugaisons.
L'évolution du suméro-akkadien
L'écriture suméro-akkadienne ne cesse d'évoluer et connaît notamment une expansion importante au IIe millénaire. Le cunéiforme est adopté par des peuples de l'Orient qui l’adaptent à la phonétique de leur langue : Éblaïtes, Susiens, Élamites, etc. Vers − 1500, les Hittites adoptent les cunéiformes babyloniens pour noter leur langue, qui est indo-européenne, associant leurs idéogrammes à ceux venus de Mésopotamie, qu'ils prononcent en hittite. L'ougaritique, connu grâce aux fouilles de Ras Shamra (l'antique Ougarit), dans l'actuelle Syrie, est un alphabet à technique cunéiforme ; il note plusieurs langues et révèle que, à partir de − 1400 environ, l'écriture en cunéiformes est devenue une sorte de forme « véhiculaire », simplifiée, servant aux échanges internationaux. Au Ier millénaire encore, le royaume d'Ourartou (situé à l'est de l'Anatolie) emprunte les caractères cunéiformes (vers − 800) et ne les modifie que légèrement. Enfin, pendant une période assez brève (vie-ive s. avant notre ère), on utilise un alphabet à technique cunéiforme pour noter le vieux perse. Au Ier millénaire, devant les progrès de l'alphabet et de la langue des Araméens (araméen), l'akkadien devient une langue morte ; le cunéiforme ne se maintient que dans un petit nombre de villes saintes de basse Mésopotamie, où il est utilisé par des Chaldéens, prêtres et devins, jusqu'au ier s. après J.-C., avant de sombrer dans l'oubli.
Du hiéroglyphe au démotique
HiéroglyphesHiéroglyphes
Tout d'abord hiéroglyphique, l'écriture égyptienne évolue en se simplifiant vers une écriture plus maniable, et d'un usage quotidien. Le hiéroglyphe est une unité graphique utilisée dans certaines écritures de l'Antiquité, comme l'égyptien. Les premiers témoignages « hiéroglyphiques » suivent de quelques siècles les plus anciennes tablettes sumériennes écrites en caractères cunéiformes. Le mot « hiéroglyphe », créé par les anciens Grecs, fait état du caractère « sacré » (hieros) et « gravé » (gluphein) de l'écriture égyptienne monumentale, mais n'est réservé à aucun système d'écriture particulier. On désigne par le même terme les écritures crétoises du minoen moyen (entre 2100 et 1580 avant J.-C.), que l'on rapproche ainsi des signes égyptiens, mais qui demeurent indéchiffrées.
Les hiéroglyphes égyptiens
La langue égyptienne est une langue chamito-sémitique dont la forme écrite n'est pas vocalisée. Vers 3000 avant J.-C., l'Égypte possède l'essentiel du système d'écriture qu'elle va utiliser pendant trois millénaires et dont les signes hiéroglyphiques offrent la manifestation la plus spectaculaire. Quelque 700 signes sont ainsi créés, beaucoup identifiables parce que ce sont des dessins représentant des animaux, un œil, le soleil, un outil, etc.
Cette écriture est d'abord pictographique (un signe, dessiné, représente une chose ou une action). Mais dès l'origine, l'écriture égyptienne eut recours, à côté des signes-mots (idéogrammes), à des signes ayant une valeur phonétique (phonogrammes), où un signe représente un son. Le dessin du canard représente l'animal lui-même, mais canard se disant sa, le même signe peut évoquer le son sa, qui sert aussi à désigner le mot « fils ». Pour éviter au lecteur confusions ou hésitations, le scribe a soin de jalonner son texte de repères : signalisation pour désigner l'emploi du signe comme idéogramme (signe-chose, représentant plus ou moins le sens du mot) ou phonogramme, et compléments phonétiques qui indiquent la valeur syllabique. Il existe également des idéogrammes déterminatifs, qui ne se lisent pas, mais qui indiquent à quelle catégorie appartient le mot. Les signes peuvent être écrits de gauche à droite ou de droite à gauche.
On distingue trois types d'écriture égyptienne : l'écriture cursive ou hiératique, tracée sur papyrus, l'écriture démotique, plus simplifiée que l'écriture hiératique, et l'écriture hiéroglyphique proprement dite, c'est-à-dire celle des monuments, antérieure à 2500 avant J.-C. Ces hiéroglyphes, gravés à l'origine dans la pierre, en relief ou en creux, peuvent être disposés verticalement ou horizontalement, comme ils peuvent se lire de droite à gauche ou de gauche à droite, le sens de la lecture étant indiqué par la direction du regard des êtres humains et des animaux, toujours tourné vers le début du texte.
L'écriture hiéroglyphique apparaît toute constituée dès les débuts de l'histoire (vers 3200 avant J.-C.) ; la dernière inscription en hiéroglyphes, trouvée à Philae, date de 394 après J.-C.
Le système de l'écriture égyptienne
Les idéogrammes peuvent être des représentations directes ou indirectes, grâce à divers procédés logiques :
– la représentation directe de l'objet que l'ont veut noter ;
– la représentation par synecdoque ou métonymie, c'est-à-dire en notant la partie pour le tout, l'effet pour la cause, ou inversement : ainsi, la tête de bœuf représente cet animal ; deux yeux humains, l'action de voir ;
– la représentation par métaphore : on note, par exemple, la « sublimité » par un épervier, car son vol est élevé ; la « contemplation » ou la « vision », par l'œil de l'épervier, parce qu'on attribuait à cet oiseau la faculté de fixer ses regards sur le disque du Soleil ;
– représentation par « énigme » – le terme est de Champollion – ; on emploie, pour exprimer une idée, l'image d'un objet physique n'ayant qu'un rapport lointain avec l'objet même de l'idée à noter : ainsi, une plume d'autruche signifie la « justice », parce que, disait-on, toutes les plumes des ailes de cet oiseau sont parfaitement égales ; un rameau de palmier représente l'« année », parce que cet arbre était supposé avoir autant de rameaux par an que l'année compte de mois, etc.
L'évolution de l'écriture égyptienne
L'évolution des hiéroglyphes vers le phonétisme
À partir des idéogrammes originels, l'écriture égyptienne a évolué vers un phonétisme plus marqué que celui du cunéiforme. Selon le principe du rébus là aussi, on a utilisé, pour noter telle notion abstraite difficile à figurer, l'idéogramme d'un objet dont le nom a une prononciation identique ou très proche. Par exemple, le scarabée, khéper, a servi à noter la notion qui se disait également khéper, le « devenir ».
Poussé plus loin, le recours au phonétisme mène à l'acronymie. Un acronyme est en l'occurrence une sorte de sigle formé de toute consonne initiale de syllabe. Apparaissent ainsi des acronymes trilitères et bilitères (nfr, « cœur » ; gm, « ibis »), ainsi que des acronymes unilitères (r, « bouche »), qui constituent une espèce d'alphabet consonantique de plus de vingt éléments.
Mais le fait de noter exclusivement les consonnes entraîne beaucoup trop d'homonymies. Pour y remédier, on utilise certains hiéroglyphes comme déterminatifs sémantiques destinés à guider l'interprétation sémantique des mots écrits phonétiquement. Par exemple, le signe du « Soleil », associé à la « massue », hd, et au « cobra », dj, qui jouent un rôle phonétique, mène à la lecture hedj, « briller ».C'est dans la catégorie des déterminatifs qu'entre le cartouche, encadrement ovale signalant un nom de souverain. Quelle que soit sa logique, cette écriture est d'un apprentissage et d'une lecture difficiles, et se prête peu à une graphie rapide.
L'écriture hiératique
Sur le plan technique, si la gravure dans la pierre s'accommode de ces formes précises, l'utilisation du roseau ou du pinceau sur du papyrus ou de la peau entraîne une écriture plus souple. Les hiéroglyphes sont simplifiés pour aboutir à deux formes cursives : l'écriture hiératique (usitée par les prêtres) et l'écriture démotique (servant à la rédaction de lettres et de textes courants). Tracée sur papyrus à l'aide d'un roseau à la pointe écrasée, trempée dans l'encre noire ou rouge, l'écriture hiératique est établie par simplification et stylisation des signes hiéroglyphiques. Avec ses ligatures, ses abréviations, elle sert aux besoins de la vie quotidienne : justice, administration, correspondance privée, inventaires mais aussi littérature, textes religieux, scientifiques, etc.
Le démotique
Vers 700 avant J.-C., une nouvelle cursive, plus simplifiée, remplace l'écriture hiératique. Les Grecs lui donnent le nom de « démotique », c'est-à-dire « (écriture) populaire », car elle est d'un usage courant et permet de noter les nouvelles formes de la langue parlée. Utilisée elle aussi sur papyrus ou sur ostraca (tessons de poterie), cette écriture démotique suffit à tous les usages pendant plus de 1000 ans, exception faite des textes gravés sur les monuments, qui demeurent l'affaire de l'hiéroglyphe, et des textes religieux sur papyrus pour lesquels on garde l'emploi de l'écriture hiératique.
Sur le plan fonctionnel, les Égyptiens, tout comme les Sumériens, n'ont pas exploité pleinement leurs acquis et se sont arrêtés sur le chemin qui aurait pu les mener à une écriture alphabétique. Demeuré longtemps indéchiffrable, le système d’écriture égyptien fut décomposé et analysé par Champollion (1822) grâce à la découverte de la pierre de Rosette, qui portait le même texte en hiéroglyphe, en démotique et en grec.
Les écritures anciennes déchiffrées
Alliant érudition, passion et intuition, les chercheurs du xixe s. déchiffrent les écritures des civilisations mésopotamiennes et égyptiennes.
Dans leurs travaux, ils durent résoudre deux problèmes : celui de l'écriture proprement dite, d'une part ; celui de la langue pour laquelle un système d'écriture était employé, d'autre part. Le document indispensable fut donc celui qui utilisait au moins deux systèmes d'écriture (ou davantage) dont l'un était déjà connu : la pierre de Rosette, rédigé en 2 langues et trois systèmes d’écritures (hiéroglyphe, démotique et grec) permit de déchiffrer les hiéroglyphes, grâce à la connaissance du grec ancien. Les savants durent ensuite faire l'hypothèse que telle ou telle langue avait été utilisée pour rédiger un texte donné ; Jean-François Champollion postula ainsi que la langue égyptienne antique a survécu dans la langue copte, elle-même conservée dans la liturgie de l'église chrétienne d'Égypte. De même le déchiffreur de l’écriture cunéiforme, sir Henry Creswicke Rawlinson, une fois les textes en élamite et vieux-perse de Béhistoun mis au point, fit l'hypothèse, avec d'autres chercheurs, que le texte restant était du babylonien, et qu'il s'agissait d'une langue sémitique dont les structures pouvaient être retrouvées à partir de l'arabe et de l'hébreu.
Les déchiffreurs
1754 : l'abbé Barthélemy propose une lecture définitive des textes phéniciens et palmyriens.
1799 (2 août) : mise au jour de la pierre de Rosette, dans le delta du Nil, portant copie d'un décret de Ptolémée V Épiphane (196 avant J.-C.) rédigé en trois écritures, hiéroglyphique, hiératique et grecque.
1822 : Lettre à Monsieur Dacier, de J.-F. Champollion, où ce dernier expose le principe de l'écriture égyptienne.
1824 : parution du Précis du système hiéroglyphique rédigé par Champollion.
À partir de 1835 : l'Anglais H. C. Rawlinson copie, à Béhistoun, en Iran, une inscription célébrant les exploits de Darius Ier (516 avant J.-C.) rédigée selon trois systèmes d'écriture cunéiforme, en vieux-perse, en élamite et en babylonien (akkadien), langues jusqu'alors inconnues.
1845 : le texte en vieux-perse est déchiffré par Rawlinson.
1853 : le texte en élamite est déchiffré par E. Norris.
1857 : un même texte babylonien est confié à quatre savants qui en proposent des traductions identiques.
1858 : Jules Oppert publie son Expédition scientifique en Mésopotamie, qui contribue au déchiffrement du cunéiforme.
1905 : F. Thureau-Dangin établit l'originalité de l'écriture et du système linguistique des Sumériens.
1917 : le Tchèque Hrozny établit que les textes hittites, écrits en caractères cunéiformes, servent à noter une langue indo-européenne, désormais déchiffrée.
1945 : découverte d'une stèle bilingue à Karatépé, en Cilicie ; la version phénicienne du texte permet de déchiffrer un texte louwite (proche du hittite) noté en écriture hiéroglyphique.
1953 : les Anglais M. Ventris et J. Chadwick établissent que les textes rédigés en écriture dite « linéaire B » sont du grec archaïque (mycénien) ; le linéaire B est une écriture syllabique comprenant environ 90 signes.
La « langue graphique » des Chinois
Après les écritures sumérienne et égyptienne, l'écriture chinoise est la troisième écriture importante à avoir découpé les messages en mots. Mais elle n'a pas évolué comme les deux autres, car, à la différence de tous les systèmes d'écriture, qui sont parvenus, à des degrés divers, à exprimer la pensée par la transcription du langage oral, l'écriture chinoise note une langue conçue en vue de l'expression écrite exclusivement, et appelée pour cette raison « langue graphique ».
L'évolution des idéogrammes chinois
Les premiers témoignages de l’écriture chonoise datent du milieu du IIe millénaire avant J.-C. : ce sont des inscriptions divinatoires, gravées sur des carapaces de tortues ou des omoplates de bœufs. Les devins y gravaient les questions de leurs « clients » puis portaient contre ce support un fer chauffé à blanc et interprétaient les craquelures ainsi produites. Ce type d’écriture a évolué à travers le temps et les différents supports : inscriptions sur des vases de bronze rituels aux alentours du ixe s. ; écriture sigillaire, gravée dans la pierre ou l'ivoire, au milieu du Ier millénaire ; caractères « classiques », peints au pinceau, à partir du iie s. avant J.-C. Ces derniers signes ont traversé deux millénaires ; en 1957, une réforme en a simplifié un certain nombre.
Le fonctionnement de l'écriture chinoise
Écriture chinoiseÉcriture chinoise
Sur le plan fonctionnel, les pictogrammes originels ont évolué vers un système d'écriture où les éléments sont dérivés les uns des autres. Soit le caractère de l'arbre (mu) : on peut en cocher la partie basse pour noter « racine » (ben), ou la partie haute pour « bout, extrémité » (mo) ; on peut aussi lui adjoindre un deuxième arbre pour noter « forêt » (lin), un troisième pour noter « grande forêt », et ultérieurement « nombreux », « sombre » (sen).
Un dérivé peut servir à son tour de base de dérivation. Ainsi, le pictogramme de la « servante », de l'« esclave », figurant une femme et une main droite (symbole du mari et du maître), est associé au signe du cœur, siège des sentiments, pour signifier la « rage », la « fureur », éprouvée par l'esclave.
Cette langue graphique use également d'indicateurs phonétiques. Ainsi, le caractère de la femme, flanqué de l'indicateur « cheval » (mâ), note « la femme qui se prononce comme le cheval » (au ton près), c'est-à-dire la « mère » (m"a) ; si l'on associe « cheval » avec « bouche », on note la particule interrogative (ma) ; avec deux « bouches », le verbe « injurier ».
Inversement, le caractère chinois peut être lu grâce au déterminatif sémantique. Ces déterminatifs, ou clés (au nombre de 540 au iie s. après J.-C., réduits à 214 au xviie s., et portés à 227, avec des modifications diverses, en 1976), sont des concepts destinés à orienter l'esprit du lecteur vers telle ou telle catégorie sémantique. Le même signe signifiera « rivière » s'il est précédé de la clé « eau », et « interroger » s'il est précédé de la clé « parole ».
Le système chinois repose donc sur le découpage de l'énoncé en mots. Il semble que, de l'autre côté du Pacifique, et au xvie s. de notre ère seulement, à la veille de la conquête espagnole, les glyphes précolombiens (que nous déchiffrons très partiellement à ce jour, malgré des progrès dans la lecture des glyphes mayas) présentent des similitudes avec cette écriture. Mais ils ne se sont pas entièrement dégagés de la simple pictographie.
L'aventure durable de l'alphabet
La naissance de l'alphabet
L'invention de l'alphabet (dont le nom est forgé par les Grecs sur leurs deux premières lettres alpha et bêta) se situe au IIe millénaire avant notre ère en Phénicie. Deux peuples y jouent un rôle important, les Cananéens et, à partir du xiie s. avant J.-C., les Araméens ; ils parlent chacun une langue sémitique propre et utilisent l'akkadien, écrit en cunéiformes, comme langue véhiculaire. Dans les langues sémitiques, chacun des « mots » est formé d'une racine consonantique qui « porte » le sens, tandis que les voyelles et certaines modifications consonantiques précisent le sens et indiquent la fonction grammaticale. Cette structure n'est sans doute pas étrangère à l'évolution de ces langues vers le principe alphabétique, et plus précisément vers l'alphabet consonantique, à partir du système cunéiforme.
L'alphabet ougaritique
Le premier alphabet dont on ait pu donner une interprétation précise est l'alphabet ougaritique, apparu au moins quatorze siècles avant notre ère. Différent du cunéiforme mésopotamien, qui notait des idées (cunéiformes idéographiques), puis des syllabes (cunéiformes syllabiques), il note des sons isolés, en l'occurrence des consonnes, au nombre de vingt-huit. Il a probablement emprunté la technique des cunéiformes aux Akkadiens, en pratiquant l'acrophonie (phénomène par lequel les idéogrammes d'une écriture ancienne deviennent des signes phonétiques correspondant à l'initiale du nom de l'objet qu'ils désignaient. Ainsi, en sumérien, le caractère cunéiforme signifiant étoile, et qui se lisait ana, finit par devenir le signe de la syllabe an) et en simplifiant certains caractères. La véritable innovation est celle des scribes d'Ougarit : gravés dans l'argile, comme les signes mésopotamiens, les caractères d'apparence cunéiforme sont en fait des lettres, déjà rangées dans l'ordre des futurs alphabets. C'est en cette écriture que les trésors de la littérature religieuse d'Ougarit, c'est-à-dire la littérature religieuse du monde cananéen lui-même, nous sont parvenus.
L'alphabet de Byblos
Alors que l'« alphabet » ougaritique demeure réservé à cette cité, l'alphabet sémitique dit « ancien » est l'ancêtre direct de notre alphabet. Sa première manifestation en est, au xie s., le texte gravé sur le sarcophage d'Ahiram, roi de Byblos : 22 signes à valeur uniquement de consonnes. Cet alphabet apparaît donc à Byblos (aujourd'hui Djebaïl, au Liban), lieu d'échanges entre l'Égypte et le monde cananéen. Ce système est utilisé successivement par les Araméens, les Hébreux et les Phéniciens. Commerçants et navigateurs, ces derniers le diffusent au cours de leurs voyages, notamment vers l'Occident, vers Chypre et l'Égée, où les Grecs s'en inspirent pour la création de leur propre alphabet. Car ce sont les Grecs qui, au xie s. avant J.-C., emploient, pour la première fois au monde, un système qui note aussi bien les voyelles que les consonnes, constituant ainsi le premier véritable alphabet.
Pour les deux alphabets d'Ougarit et de Byblos, entre lesquels il ne devrait pas y avoir de continuité globale, il est frappant que l'ordre des lettres soit le même et corresponde à peu près à celui des alphabets ultérieurs. Cet ordre, dont l'origine reste mystérieuse, serait très ancien.
La forme et le nom des lettres
Mais quel critère a déterminé le choix de tel graphisme pour noter tel son ? D'où viennent les noms des lettres ? L'hypothèse retenue répond à ces deux questions à la fois : une lettre devait fonctionner à l'origine comme un pictogramme (A figurait une tête de bœuf) ; on a utilisé ce pictogramme pour noter le son initial du nom qui désignait telle chose ou tel être dans la langue (A utilisé pour noter « a », issu par acrophonie d'aleph, nom du bœuf en sémitique) ; enfin, on a donné à la lettre alphabétique nouvelle le nom de la chose que figurait le pictogramme originel (aleph est le nom de la lettre A). C'est sur cette hypothèse que s'est fondé l'égyptologue Alan Henderson Gardiner dans ses travaux sur les inscriptions dites « protosinaïtiques » découvertes dans le Sinaï. Elles sont antérieures au xve s. avant J.-C., présentent quelque signes pictographiques et notent une langue apparentée au cananéen. Les conclusions de Gardiner ne portent que sur quelques « lettres » de ce protoalphabet, mais elles semblent convaincantes et devraient permettre de repousser de cinq à sept siècles la naissance du système alphabétique.
La chaîne des premiers alphabets
Des convergences dans la forme, le nom et la valeur phonétique des lettres établissent, entre les alphabets, une parenté incontestable. Pour l'araméen et le grec, celle-ci est collatérale : ils ont pour ancêtre commun le phénicien. De l'alphabet araméen dérivent l'hébraïque (iiie ou iie s. avant J.-C.) et probablement l'arabe (avant le vie s. après J.-C.), avec ses diverses adaptations, qui notent le persan ou l'ourdou, par exemple ; à moins qu'il ne faille distinguer une filière arabique qui aurait une parenté collatérale avec le phénicien. Du grec découle la grande majorité des alphabets actuels : étrusque (ve s. avant J.-C.), italiques puis latin (à partir du ve s. avant J.-C.), copte (iie-iiie s. après J.-C.), gotique (ive s.), arménien (ve s.), glagolitique et cyrillique (ixe s.). La propagation du christianisme joua un rôle majeur dans cette filiation : c'est pour les besoins de leur apostolat que des évangélisateurs, s'inspirant des alphabets grec ou latin dans lesquels ils lisaient les Écritures, constituèrent des alphabets adaptés aux langues des païens.
Écriture devanagariÉcriture devanagari
Quant aux alphabets asiatiques, au nombre d'au moins deux cents, on pense qu'ils remontent tous à l'écriture brahmi. La devanagari, par exemple, a servi à noter le sanskrit et note aujourd'hui le hindi. D’aucuns supposent que l'écriture brahmi aurait été elle-même créée d'après un modèle araméen. Selon cette hypothèse, tous les alphabets du monde proviendraient donc de la même source proche-orientale.
L'alphabet aujourd’hui
Avec la grande extension de l'alphabet, la fonction de l'écrit a évolué. À la conservation de la parole, ou, sur une autre échelle, de la mémoire des hommes, s'est ajoutée l'éducation, l'œuvre de culture, souvent synonyme d'« alphabétisation ». Il existe bel et bien une civilisation de l'alphabet, accomplissement de celle de l'écriture, où un autodafé de documents écrits est considéré comme un acte de barbarie. Depuis le siècle dernier, une étape importante s'est amorcée avec la diffusion de l'alphabet latin hors de l'Europe occidentale, surtout pour noter des parlers encore non écrits, en Afrique ou dans l'ex-Union soviétique. En Turquie, par exemple, la réforme de 1928 (utilisation de l’alphabet latin, légèrement enrichi de diacritiques et d’une lettre supplémentaire) a permis de rapprocher le pays de la civilisation occidentale.
LINGUISTIQUE
L'écriture est un code de communication secondaire par rapport au langage articulé. Mais, contrairement à celui-ci, qui se déroule dans le temps, l'écriture possède un support spatial qui lui permet d'être conservée. La forme de l'écriture dépend d'ailleurs de la nature de ce support : elle peut être gravée sur la pierre, les tablettes d'argile ou de cire, peinte ou tracée sur le papyrus, le parchemin ou le papier, imprimée ou enfin affichée.
Selon la nature de ce qui est fixé sur le support, on distingue trois grands types d'écriture, dont l'apparition se succède en gros sur le plan historique, et qui peuvent être considérés comme des progrès successifs dans la mesure où le code utilisé est de plus en plus performant : les écritures synthétiques (dites aussi mythographiques), où le signe est la traduction d'une phrase ou d'un énoncé complet ; les écritures analytiques, où le signe dénote un morphème ; les écritures phonétiques (ou phonématiques), où le signe dénote un phonème ou une suite de phonèmes (syllabe).
Les écritures synthétiques
On peut classer dans les écritures synthétiques toutes sortes de manifestations d'une volonté de communication spatiale. Certains, d'ailleurs, préfèrent parler en ce cas de « pré-écriture », dans la mesure où ces procédés sont une transcription de la pensée et non du langage articulé. Quoi qu'il en soit, le spécialiste de la préhistoire André Leroi-Gourhan note des exemples de telles manifestations dès le moustérien évolué (50 000 ans avant notre ère) sous la forme d'incisions régulièrement espacées sur des os ou des pierres. À ce type de communication appartiennent les représentations symboliques grâce à des objets, dont un exemple classique, rapporté par Hérodote, est le message des Scythes à Darios ; il consistait en cinq flèches d'une part, une souris, une grenouille et un oiseau d'autre part, formes suggérées à l'ennemi pour échapper aux flèches. Ce genre de communication se retrouve un peu partout dans le monde dans les sociétés dites primitives. On peut ainsi signaler les systèmes de notation par nœuds sur des cordelettes (quipus des archives royales des Incas), mais la forme la plus courante d'écriture synthétique est la pictographie, c'est-à-dire l'utilisation de dessins figuratifs (pictogrammes), dont chacun équivaut à une phrase (« je pars en canot », « j'ai tué un animal », « je rentre chez moi », etc.) : c'est le système utilisé par les Inuits d'Alaska, les Iroquois et les Algonquins (wampums) ou encore par les Dakotas. Les limites de ces modes d'expression apparaissent évidentes : ils ne couvrent que des secteurs limités de l'expérience, ils ne constituent pas, comme le langage, une combinatoire.
Les écritures analytiques
Dans les écritures analytiques (dites aussi, paradoxalement, « idéographiques »), le signe ne représente pas une idée mais un élément linguistique (mot ou morphème), ce n'est plus une simple suggestion, c'est une notation. En réalité, le manque d'économie de ce système (il y aurait un signe pour chaque signifié) fait qu'il n'existe pas à l'état pur : toutes les écritures dites idéographiques comportent, à côté des signes-choses (idéogrammes), une quantité importante de signes à valeur phonétique, qu'il s'agisse des cunéiformes suméro-akkadiens, des hiéroglyphes égyptiens ou de l'écriture chinoise. Par exemple, en chinois, on peut distinguer, en gros, cinq types d'idéogrammes : les caractères représentant des objets, et qui sont, à l'origine, d'anciens pictogrammes (le soleil, la lune, un cheval, un arbre, etc.) ; les caractères évoquant des notions abstraites (monter, descendre, haut, bas) ; les caractères qui sont des agrégats logiques, formés par le procédé du rébus, en associant deux signes déjà signifiants (une femme sous un toit pourra dénoter la paix) ; les caractères utilisés pour noter des homophones : tel caractère désignant à l'origine un objet donné sera utilisé pour noter un mot de même prononciation mais de sens complètement différent ; les caractères qui sont des composés phonétiques, constitués, à gauche, d'un élément qui indique la catégorie sémantique (clef) et, à droite, d'un élément indiquant la prononciation (ce dernier type de caractère constitue jusqu'à 90 % des entrées d'un dictionnaire chinois). Cependant, l'écriture chinoise, malgré ses recours au phonétisme, n'est pas liée à la prononciation : elle peut être lue par les locuteurs des différents dialectes chinois, entre lesquels il n'y a pas d'intercompréhension orale ; elle sert, d'autre part, à noter des langues complètement différentes comme le lolo, l’ancien coréen (qui a depuis créé son propre alphabet, le hangul) ou le japonais, où les idéogrammes chinois coexistent avec une notation syllabique.
Les écritures phonétiques
Les écritures dites « phonétiques » témoignent d'une prise de conscience plus poussée de la nature de la langue parlée : les signes y ont perdu tout contenu sémantique (même si, à l'origine, les lettres sont d'anciens idéogrammes), ils ne sont plus que la représentation d'un son ou d'un groupe de sons. Trois cas peuvent se présenter, selon que le système note les syllabes, les consonnes seules ou les voyelles et les consonnes. Les syllabaires ne constituent pas toujours historiquement un stade antérieur à celui des alphabets. S'il est vrai que les plus anciens syllabaires connus (en particulier le cypriote) précèdent l'invention de l'alphabet (consonantique) par les Phéniciens, d'autres sont, au contraire, des adaptations d'alphabets : c'est le cas de la brahmi, ancêtre de toutes les écritures indiennes actuelles, qui procède de l'alphabet araméen, ou du syllabaire éthiopien, qui a subi des influences sémitiques et grecques.
Quant à la naissance de l'alphabet grec, elle a été marquée, semble-t-il, aussi bien par le modèle phénicien que par celui des syllabaires cypriote et crétois (linéaires A et B). Les systèmes syllabiques se caractérisent par leur côté relativement peu économique, puisqu'il faut, en principe, autant de signes qu'il y a de possibilités de combinaison voyelle-consonne. D'autre part, ils présentent l'inconvénient de ne pouvoir noter simplement que les syllabes ouvertes (C+V) ; en cas de syllabe fermée (C+V+C) ou de groupement consonantique (C+C+V), l'un des signes contiendra un élément vocalique absent de la prononciation.
Alphabet araméen
Alphabet araméen
Alphabet araméenAlphabet arabe
Les alphabets consonantiques, dont le phénicien est historiquement le premier exemple, ne conviennent bien qu'à des langues ayant la structure particulière des langues sémitiques : la racine des mots y possède une structure consonantique qui est porteuse de leur sens, la vocalisation pouvant être devinée par l'ordre très rigoureux des mots dans la phrase, qui indique leur catégorie grammaticale et, par là même, leur fonction. L'alphabet araméen a servi de modèle à toute une série d'alphabets (arabe, hébreu, syriaque, etc.), ainsi qu'à des syllabaires (brahmi) ; l'alphabet arabe a servi et sert à noter des langues non sémitiques, non sans quelques difficultés (il a ainsi été abandonné pour le turc).
Alphabet grec
Alphabet grec
Alphabet grecAlphabet arménien
L'alphabet grec est historiquement le premier exemple d'une écriture notant à la fois et séparément les consonnes et les voyelles. Il a servi de modèle à toutes les écritures du même type qui existent actuellement : alphabets latin, cyrillique, arménien, géorgien, etc.
PÉDAGOGIE
L'apprentissage de l'écriture fait appel à une maîtrise de la fonction symbolique ainsi qu'à une maîtrise motrice de l'espace et du temps. Il s'effectue soit par l'étude progressive et linéaire des lettres, servant à former les mots (méthode analytique), soit par la compréhension directe des mots dans le contexte de la phrase, dont on décomposera seulement après les lettres (méthode globale d’Ovide Decroly). Mais ce sont de plus en plus des méthodes mixtes qui sont utilisées, intégrant parfois expression corporelle et exercices de motricité.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|