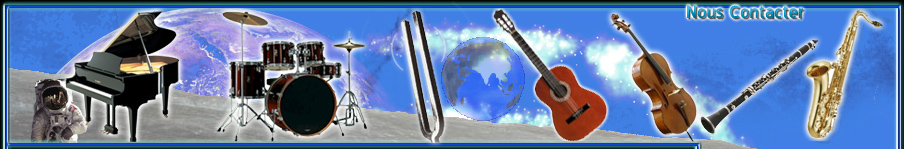|
|
|
|
 |
|
LES TROUS NOIRS ET LA FORME DE L'ESPACE |
|
|
| |
|
| |
LES TROUS NOIRS ET LA FORME DE L'ESPACE
La théorie de la relativité générale, les modèles de trous noirs et les solutions cosmologiques de type " big-bang " qui en découlent, décrivent des espace-temps courbés par la gravitation, sans toutefois trancher sur certaines questions fondamentales quant à la nature de l'espace. Quelle est sa structure géométrique à grande et à petite échelle ? Est-il continu ou discontinu, fini ou infini, possède-t-il des " trous " ou des " poignées ", contient-il un seul feuillet ou plusieurs, est-il " lisse " ou " chiffonné " ? Des approches récentes et encore spéculatives, comme la gravité quantique, les théories multidimensionnelles et la topologie cosmique, ouvrent des perspectives inédites sur ces questions. Je détaillerai deux aspects particuliers de cette recherche. Le premier sera consacré aux trous noirs. Astres dont l'attraction est si intense que rien ne peut s'en échapper, les trous noirs sont le triomphe ultime de la gravitation sur la matière et sur la lumière. Je décrirai les distorsions spatio-temporelles engendrées par les trous noirs et leurs propriétés exotiques : extraction d'énergie, évaporation quantique, singularités, trous blancs et trous de ver, destin de la matière qui s'y engouffre, sites astronomiques où l'on pense les avoir débusqués. Le second aspect décrira les recherches récentes en topologie cosmique, où l'espace " chiffonné ", fini mais de topologie multiconnexe, donne l'illusion d'un espace déplié plus vaste, peuplé d'un grand nombre de galaxies fantômes. L'univers observable acquiert ainsi la forme d'un " cristal " dont seule une maille correspond à l'espace réel, les autres mailles étant des répliques distordues emplies de sources fantômes.
Texte de la 187e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 5 juillet 2000.
Les trous noirs et la forme de l'espace
par Jean-Pierre Luminet
Introduction
La question de la forme de l’espace me fascine depuis que, adolescent, j’ai ouvert une encyclopédie d’astronomie à la page traitant de la théorie de la relativité générale d’Einstein. Il y était écrit que, dans la conception relativiste, l’espace-temps a la forme d’un mollusque. Cette image m’avait beaucoup intrigué, et depuis lors, je n’ai eu de cesse d’élucider les mystères implicitement attachés à ce « mollusque universel ». Lorsqu’ils contemplent un beau ciel nocturne, la plupart des gens n’ont d’yeux que pour le spectacle des étoiles, c’est-à-dire le contenu de l’univers. Or, on peut aussi s’émerveiller devant l’invisible contenant : l’espace n’est-il qu’un réceptacle vide et passif qui accueille les corps, ou bien peut-on lui attribuer une forme, une structure, une architecture ? Est-il plat, courbe, rugueux, lisse, cabossé, plissé, etc. ?
L’espace a-t-il une forme ?
Il est sans doute difficile à la plupart d’entre vous d’attribuer une forme à quelque chose d’aussi impalpable et d’abstrait que l’espace. Au cours des siècles, maintes conceptions philosophiques ont tenté de « donner chair » à l’espace en le considérant, par exemple, comme une substance éthérée qui, non seulement contient les corps matériels, mais aussi les imprègne et partage avec eux certaines de ses propriétés structurelles. Toutefois, pour le physicien, les questions sur la forme de l’espace ne sont pertinentes qu’en utilisant le langage des mathématiques, plus spécifiquement celui de la géométrie.
Quel est l’espace géométrique qui est susceptible de représenter l’espace physique ?
Le problème est plus compliqué qu’il ne semble à première vue. Certes, l’espace « immédiat » qui nous environne est correctement décrit par la géométrie euclidienne ordinaire. Mais l’espace microscopique (à très petite échelle) et l’espace cosmologique (à très grande échelle) en diffèrent profondément. À la question de la forme de l’espace, la physique actuelle donne donc des réponses différentes, selon quatre « niveaux » dépendant de l’échelle à laquelle on examine la structure de l’espace. Les niveaux « intermédiaires » 1 & 2 sont assez bien compris, les niveaux « extrêmes » 0 & 3 font l’objet de spéculations théoriques originales.
Niveau 1 : Géométrie (pseudo-) euclidienne
Champ d’application : mécanique classique, relativité restreinte, électrodynamique quantique
À l’échelle « locale », disons entre 10-18 centimètre (longueur actuellement accessible à l’expérimentation) et 1011 mètres (de l’ordre de la distance Terre - Soleil), la géométrie de l’espace physique se décrit très bien par celle de l’espace euclidien ordinaire. « Très bien » signifie que cette structure mathématique sert de cadre naturel aux théories physiques qui, comme la mécanique classique, la relativité restreinte et l’électrodynamique quantique, permettent d’expliquer correctement la quasi-totalité des phénomènes naturels. L’espace y est à trois dimensions, sans courbure. Dans la théorie relativiste, il est couplé au temps au sein d’une géométrie pseudo-euclidienne quadridimensionnelle plate, dite « espace-temps de Minkowski ».
Niveau 2 : Géométrie différentielle en espace (pseudo-) riemannien
Champ d’application : relativité générale, cosmologie
À l’échelle astronomique (système solaire, étoiles, galaxies, univers dans son ensemble), l’interaction dominante qui « sculpte » l’espace physique est la gravité. Celle-ci est décrite par la relativité générale, qui fait apparaître une structure non-euclidienne de l’espace-temps. La géométrie différentielle des variétés riemanniennes permet précisément de décrire de tels espaces courbes. Il y a de nombreuses modélisations possibles. Par exemple, à grande échelle, la courbure est relativement « douce » et uniforme. Les cosmologistes travaillent donc dans le cadre d’espaces à courbure constante. Au voisinage d’objets très compacts, la courbure peut au contraire varier fortement d’un point à l’autre. La géométrie de Schwarzschild est un exemple de modélisation de l’espace-temps physique autour d’un trou noir sphérique.
Niveau 0 : Géométrie multidimensionnelle, géométrie non-commutative, etc.
Champ d’application : théories d’unification, supercordes, gravité quantique
La description de l’espace à l’échelle microscopique (entre 10-33 centimètre et 10-18 centimètre) est liée au plus grand enjeu de la physique actuelle : l’unification des interactions fondamentales. Celle-ci tente de marier deux points de vue extrêmement différents : celui de la mécanique quantique, décrivant les interactions en termes de champs, et celui de la relativité, décrivant la gravité en termes de courbure.
Aucune théorie de « gravité quantique » satisfaisante n’a vu le jour, mais plusieurs scénarios sont étudiés. Dans tous les cas, les conceptions géométriques usuelles sur l’espace et le temps sont bouleversées. Par exemple, la théorie des supercordes introduit des dimensions spatiales supplémentaires ; la géométrie non-commutative décrit un espace-temps granulaire et « flou » ; la géométrodynamique quantique conçoit l’espace-temps comme un océan bouillonnant d’énergie, agité de « vagues » (les fluctuations quantiques du vide) et ponctué « d’écume » (les univers-bulles).
Niveau 4 : Topologie, espaces « chiffonnés »
Champ d’application : structure globale de l’Univers, topologie cosmique
La question de la forme globale de l’espace (à une échelle supérieure à 1025 mètres) pose des problèmes géométriques spécifiques ne relevant plus seulement de la courbure, mais de la topologie de l’espace-temps. Celle-ci n’est incorporée ni dans la relativité générale, ni dans les approches unificatrices de la physique des hautes énergies. Pour reprendre l’image pittoresque du « mollusque universel », il ne s’agit plus de savoir s’il possède des bosses ou des creux, mais de savoir s’il s’agit d’un escargot, d’une limace ou d’un calmar.
Une nouvelle discipline est née il y a quelques années : la topologie cosmique, qui applique aux modèles cosmologiques relativistes les découvertes mathématiques effectuées dans le domaine de la classification topologique des espaces.
La suite de la conférence s’attachera exclusivement à la description du niveau 2 dans le contexte des trous noirs, et du niveau 4 dans le contexte des modèles d’univers chiffonnés.
Les trous noirs
Un vieux conte persan dit :
« Un jour, les papillons tiennent une vaste assemblée parce qu’ils sont tourmentés par le mystère de la flamme. Chacun propose son idée sur la question. Le vieux sage qui préside l’assemblée dit qu’il n’a rien entendu de satisfaisant, et que le mieux à faire est d’aller voir de près ce qu’est la flamme.
Un premier papillon volontaire s’envole au château voisin et aperçoit la flamme d’une bougie derrière une fenêtre. Il revient très excité et raconte ce qu’il a vu. Le sage dit qu’il ne leur apprend pas grand chose.
Un deuxième papillon franchit la fenêtre et touche la flamme, se brûlant l’extrémité des ailes. Il revient et raconte son aventure. Le sage dit qu’il ne leur apprend rien de plus.
Un troisième papillon va au château et se consume dans la flamme. Le sage, qui a vu la scène de loin, dit que seul le papillon mort connaît le secret de la flamme, et qu’il n’y a rien d’autre à dire. »
Cette parabole préfigure le mystère des trous noirs. Ces objets célestes capturent la matière et la lumière sans espoir de retour : si un astronaute hardi s’aventurait dans un trou noir, il ne pourrait jamais en ressortir pour relater ses découvertes.
Les trous noirs sont des astres invisibles
Le concept d’astre invisible a été imaginé par deux astronomes de la fin du XVIIIe siècle, John Michell (1783) et Pierre de Laplace (1796). Dans le cadre de la théorie de l’attraction universelle élaborée par Newton, ils s’étaient interrogés sur la possibilité qu’il puisse exister dans l’univers des astres si massifs que la vitesse de libération à leur surface puisse dépasser la vitesse de la lumière. La vitesse de libération est la vitesse minimale avec laquelle il faut lancer un objet pour qu’il puisse échapper définitivement à l’attraction gravitationnelle d’un astre. Si elle dépasse la vitesse de la lumière, l’astre est nécessairement invisible, puisque même les rayons lumineux resteraient prisonniers de son champ de gravité.
Michell et Laplace avaient donc décrit le prototype de ce qu’on appellera beaucoup plus tard (en 1968) un « trou noir », dans le cadre d’une autre théorie de la gravitation (la relativité générale). Ils avaient cependant calculé les bons « ordres de grandeur » caractérisant l’état de trou noir. Un astre ayant la densité moyenne de l’eau (1g/cm3) et une masse de dix millions de fois celle du Soleil serait invisible. Un tel corps est aujourd’hui nommé « trou noir supermassif ». Les astronomes soupçonnent leur existence au centre de pratiquement toutes les galaxies (bien qu’ils ne soient pas constitués d’eau !). Plus communs encore seraient les « trous noirs stellaires », dont la masse est de l’ordre de quelques masses solaires et le rayon critique (dit rayon de Schwarzschild) d’une dizaine de kilomètres seulement. Pour transformer le Soleil en trou noir, il faudrait le réduire à une boule de 3 kilomètres de rayon ; quant à la Terre, il faudrait la compacter en une bille de 1 cm !
Les trous noirs sont des objets relativistes
La théorie des trous noirs ne s’est véritablement développée qu’au XXe siècle dans le cadre de la relativité générale. Selon la conception einsteinienne, l’espace, le temps et la matière sont couplés en une structure géométrique non-euclidienne compliquée. En termes simples, la matière-énergie confère, localement du moins, une forme à l’espace-temps. Ce dernier peut être vu comme une nouvelle entité qui est à la fois « élastique », en ce sens que les corps massifs engendrent localement de la courbure, et « dynamique », c’est-à-dire que cette structure évolue au cours du temps, au gré des mouvements des corps massifs. Par exemple, tout corps massif engendre autour de lui, dans le tissu élastique de l’espace-temps, une courbure ; si le corps se déplace, la courbure se déplace avec lui et fait vibrer l’espace-temps sous formes d’ondulations appelées ondes gravitationnelles.
La courbure de l’espace-temps peut se visualiser par les trajectoires des rayons lumineux et des particules « libres ». Celles-ci épousent naturellement la forme incurvée de l’espace. Par exemple, si les planètes tournent autour du Soleil, ce n’est pas parce qu’elles sont soumises à une force d’attraction universelle, comme le voulait la physique newtonienne, mais parce qu’elles suivent la « pente naturelle » de l’espace-temps qui est courbé au voisinage du Soleil. En relativité, la gravité n’est pas une force, c’est une manifestation de la courbure de l’espace-temps. C’est donc elle qui sculpte la forme locale de l’univers.
Les équations d’Einstein indiquent comment le degré de courbure de l’espace-temps dépend de la concentration de matière (au sens large du terme, c’est-à-dire incluant toutes les formes d’énergie). Les trous noirs sont la conséquence logique de ce couplage entre matière et géométrie. Le trou noir rassemble tellement d’énergie dans un région confinée de l’univers qu’il creuse un véritable « puits » dans le tissu élastique de l’espace-temps. Toute particule, tout rayon lumineux pénétrant dans une zone critique définie par le bord (immatériel) du puits, sont irrémédiablement capturés.
Comment les trous noirs peuvent-ils se former ?
Les modèles d’évolution stellaire, développés tout au long du XXe siècle, conduisent à un schéma général de l’évolution des étoiles en fonction de leur masse. Le destin final d’un étoile est toujours l’effondrement gravitationnel de son cœur (conduisant à un « cadavre stellaire »), accompagné de l’expulsion de ses couches externes. Il y a trois types de cadavres stellaires possibles :
- La plupart des étoiles (90 %) finissent en « naines blanches », des corps de la taille de la Terre mais un million de fois plus denses, constituées essentiellement de carbone dégénéré. Ce sera le cas du Soleil.
- Les étoiles dix fois plus massives que le Soleil (9,9 %) explosent en supernova. Leur cœur se contracte en une boule de 15 km de rayon, une « étoile à neutrons » à la densité fabuleuse. Elles sont détectables sous la forme de pulsars, objets fortement magnétisés et en rotation rapide dont la luminosité radio varie périodiquement.
- Enfin, si l’étoile est initialement 30 fois plus massive que le Soleil, son noyau est condamné à s’effondrer sans limite pour former un trou noir. On sait en effet qu’une étoile à neutrons ne peut pas dépasser une masse critique d’environ 3 masses solaires. Les étoiles très massives sont extrêmement rares : une sur mille en moyenne. Comme notre galaxie abrite environ cent milliards d’étoiles, on peut s’attendre à ce qu’elle forme une dizaine de millions de trous noirs stellaires.
Quant aux trous noirs supermassifs, ils peuvent résulter, soit de l’effondrement gravitationnel d’un amas d’étoiles tout entier, soit de la croissance d’un trou noir « germe » de masse initialement modeste.
Comment détecter les trous noirs ?
Certains trous noirs peuvent être détectés indirectement s’ils ne sont pas isolés, et s’ils absorbent de la matière en quantité suffisante. Par exemple, un trou noir faisant partie d’un couple stellaire aspire l’enveloppe gazeuse de son étoile compagne. Avant de disparaître, le gaz est chauffé violemment, et il émet une luminosité caractéristique dans la gamme des rayonnements à haute énergie. Des télescopes à rayons X embarqués sur satellite recherchent de tels trous noirs stellaires dans les systèmes d’étoiles doubles à luminosité X fortement variable. Il existe dans notre seule galaxie une douzaine de tels « candidats » trous noirs.
L’observation astronomique nous indique aussi que les trous noirs supermassifs existent vraisemblablement au centre de nombreuses galaxies - dont la nôtre. Le modèle du « trou noir galactique » explique en particulier la luminosité extraordinaire qui est libérée par les galaxies dites « à noyau actif », dont les plus spectaculaires sont les quasars, objets intrinsèquement si lumineux qu’ils permettent de sonder les confins de l’espace.
En 1979, mon premier travail de recherche a consisté à reconstituer numériquement l’apparence d’un trou noir entouré d’un disque de gaz chaud. Les distorsions de l’espace-temps au voisinage du trou noir sont si grandes que les rayons lumineux épousent des trajectoires fortement incurvées permettant, par exemple, d’observer simultanément le dessus et le dessous du disque. J’ai ensuite étudié la façon dont une étoile qui frôle un trou noir géant est brisée par les forces de marée. L’étirement de l’espace est tel que, en quelques secondes, l’étoile est violemment aplatie sous la forme d’une « crêpe flambée ». Les débris de l’étoile peuvent ensuite alimenter une structure gazeuse autour du trou noir et libérer de l’énergie sur le long terme. Ce phénomène de crêpe stellaire, mis en évidence par les calculs numériques, n’a pas encore été observé, mais il fournit une explication plausible au mode d’alimentation des galaxies à noyau actif.
La physique externe des trous noirs
La théorie des trous noirs s’est essentiellement développée dans les années 1960-70. Le trou noir, comme tous les objets, tourne sur lui-même. On peut l’envisager comme un « maelström cosmique » qui entraîne l’espace-temps dans sa rotation. Comme dans un tourbillon marin, si un vaisseau spatial s’approche trop près, il commence par être irrésistiblement entraîné dans le sens de rotation et, s’il franchit une zone critique de non-retour, il tombe inéluctablement au fond du vortex.
Le temps est également distordu dans les parages du trou noir. Le temps « apparent », mesuré par toute horloge extérieure, se ralentit indéfiniment, tandis que le temps « propre », mesuré par une horloge en chute libre, n’égrène que quelques secondes avant d’être anéantie au fond du trou. Si un astronaute était filmé dans sa chute vers un trou noir, personne ne le verrait jamais atteindre la surface ; les images se figeraient à jamais à l’instant où l’astronaute semblerait atteindre la frontière du trou noir. Or, selon sa propre montre, l’astronaute serait bel et bien avalé par le trou en quelques instants.
Le théorème capital sur la physique des trous noirs se formule de façon pittoresque : « un trou noir n’a pas de poils. » Il signifie que, lorsque de la matière-énergie disparaît à l’intérieur d’un trou noir, toutes les propriétés de la matière telles que couleur, forme, constitution, etc., s’évanouissent, seules subsistent trois caractéristiques : la masse, le moment angulaire et la charge électrique. Le trou noir à l’équilibre est donc l’objet le plus « simple » de toute la physique, car il est entièrement déterminé par la donnée de ces trois paramètres. Du coup, toutes les solutions exactes de la théorie de la relativité générale décrivant la structure de l’espace-temps engendré par un trou noir sont connues et étudiées intensivement.
Par sa nature même, un trou noir est inéluctablement voué à grandir. Cependant, la théorie a connu un rebondissement intéressant au début des années 1980, lorsque Stephen Hawking a découvert que les trous noirs « microscopiques » (hypothétiquement formés lors du big-bang) se comporteraient à l’inverse des gros trous noirs. Régis par la physique quantique et non plus seulement par la physique gravitationnelle, ces micro-trous noirs ayant la taille d’une particule élémentaire mais la masse d’une montagne s’évaporeraient car ils seraient fondamentalement instables. Ce phénomène « d’évaporation quantique » suscite encore beaucoup d’interrogations. Aucun micro-trou noir n’a été détecté, mais leur étude théorique permet de tisser des liens entre la gravité et la physique quantique. Des modèles récents suggèrent que le résultat de l’évaporation d’un trou noir ne serait pas une singularité ponctuelle « nue », mais une corde – objet théorique déjà invoqué par des théories d’unification des interactions fondamentales.
L’intérieur des trous noirs
Le puits creusé par le trou noir dans le tissu élastique de l’espace-temps est-il « pincé » par un nœud de courbure infinie – auquel cas toute la matière qui tomberait dans le trou noir se tasserait indéfiniment dans une singularité ? Ou bien le fond du trou noir est-il « ouvert » vers d’autres régions de l’espace-temps par des sortes de tunnels ? Cette deuxième possibilité, apparemment extravagante, est suggérée par certaines solutions mathématiques de la relativité. Un trou de ver serait une structure topologique exotique ressemblant à une « poignée d’espace-temps » qui relierait deux régions de l’univers, dont l’une serait un trou noir et l’autre un « trou blanc ». Ces raccourcis d’espace-temps, qui permettraient de parcourir en quelques fractions de seconde des millions d’années lumière sans jamais dépasser la vitesse de la lumière, ont fasciné les physiciens tout autant que les écrivains de science-fiction. Des études plus détaillées montrent que de tels trous de ver ne peuvent pas se former dans l’effondrement gravitationnel d’une étoile : aussitôt constitués, ils seraient détruits et bouchés avant qu’aucune particule n’ait le temps de les traverser. Des modèles suggèrent que les trous de ver pourraient cependant exister à l’échelle microscopique. En fait, la structure la plus intime de l’espace-temps pourrait être constituée d’une mousse perpétuellement changeante de micro-trous noirs, micro-trous blancs et mini-trous de ver, traversés de façon fugace par des particules élémentaires pouvant éventuellement remonter le cours du temps !
La forme globale de l’univers
À l'échelle de la cosmologie, le « tissu élastique » de l’espace-temps doit être conçu comme chargé d’un grand nombre de billes - étoiles, galaxies, amas de galaxies - réparties de façon plus ou moins homogène et uniforme. La courbure engendrée par la distribution des corps est donc elle-même uniforme, c’est-à-dire constante dans l’espace. En outre, la distribution et le mouvement de la matière universelle confèrent à l’espace-temps une dynamique globale : l’univers est en expansion ou en contraction.
La cosmologie relativiste consiste à rechercher des solutions exactes de la relativité susceptibles de décrire la structure et l’évolution de l’univers à grande échelle. Les modèles à courbure spatiale constante ont été découverts par Alexandre Friedmann et Georges Lemaître dans les années 1920. Ces modèles se distinguent par leur courbure spatiale et par leur dynamique.
Dans la version la plus simple :
- Espace de courbure positive (type sphérique)
L’espace, de volume fini (bien que dans frontières), se dilate initialement à partir d’une singularité (le fameux « big-bang »), atteint un rayon maximal, puis se contracte pour s’achever dans un « big-crunch ». La durée de vie typique d’un tel modèle d’univers est une centaine de milliards d’années.
- Espace de courbure nulle (type euclidien) ou négative (type hyperbolique)
Dans les deux cas, l’expansion de l’univers se poursuit à jamais à partir d’un big-bang initial, le taux d’expansion se ralentissant toutefois au cours du temps.
La dynamique ci-dessus est complètement modifiée si un terme appelé « constante cosmologique » est ajouté aux équations relativistes. Ce terme a pour effet d’accélérer le taux d’expansion, de sorte que même un espace de type sphérique peut être « ouvert » (c’est-à-dire en expansion perpétuelle) s’il possède une constante cosmologique suffisamment grande. Des observations récentes suggèrent que l’espace cosmique est proche d’être euclidien (de sorte que l’alternative sphérique / hyperbolique n’est nullement tranchée !), mais qu’il est en expansion accélérée, ce qui tend à réhabiliter la constante cosmologique (sous une forme associée à l’énergie du vide).
Je ne développerai pas davantage la question, car elle figure au programme de la 186e conférence de l’Utls donnée par Marc Lachièze-Rey.
Quelle est la différence entre courbure et topologie ?
Avec la cosmologie relativiste, disposons-nous d’une description de la forme de l’espace à grande échelle ? On pourrait le croire à première vue, mais il n’en est rien. Même la question de la finitude ou de l’infinitude de l’espace (plus grossière que celle concernant sa forme) n’est pas clairement tranchée. En effet, si la géométrie sphérique n’implique que des espaces de volume fini (comme l’hypersphère), les géométries euclidienne et hyperbolique sont compatibles tout autant avec des espaces finis qu’avec des espaces infinis. Seule la topologie, cette branche de la géométrie qui traite de certaines formes invariantes des espaces, donne des informations supplémentaires sur la structure globale de l’espace - informations que la courbure (donc la relativité générale) ne saurait à elle seule fournir.
Pour s’assurer qu’un espace est localement euclidien (de courbure nulle), il suffit de vérifier que la somme des angles d’un triangle quelconque fait bien 180° - ou, ce qui revient au même, de vérifier le théorème de Pythagore. Si cette somme est supérieure à 180°, l’espace est localement sphérique (courbé positivement), et si cette somme est inférieure à 180°, l’espace est localement hyperbolique (courbé négativement).
Cependant, un espace euclidien n’est pas nécessairement aussi simple que ce que l’on pourrait croire. Par exemple, une surface euclidienne (à deux dimensions, donc) n’est pas nécessairement le plan. Il suffit de découper une bande dans le plan et d’en coller les extrémités pour obtenir un cylindre. Or, à la surface du cylindre, le théorème de Pythagore est tout autant vérifié que dans le plan d’origine. Le cylindre est donc une surface euclidienne de courbure strictement nulle, même si sa représentation dans l’espace (fictif) de visualisation présente une courbure « extrinsèque ». Bien qu’euclidien, le cylindre présente une différence fondamentale d’avec le plan : il est fini dans une direction. C’est ce type de propriété qui relève de la topologie, et non pas de la courbure. En découpant le plan et en le recollant selon certains points, nous n’avons pas changé sa forme locale (sa courbure) mais nous avons changé radicalement sa forme globale (sa topologie). Nous pouvons aller plus loin en découpant le cylindre en un tube de longueur finie, et en collant les deux extrémités circulaires. Nous obtenons un tore plat, c’est-à-dire une surface euclidienne sans courbure, mais fermée dans toutes les directions (de superficie finie). Une bactérie vivant à la surface d’un tore plat ne ferait pas la différence avec le plan ordinaire, à moins de se déplacer et de faire un tour complet du tore. À trois dimensions, il est possible de se livrer à ce même genre d’opérations. En partant d’un cube de l'espace euclidien ordinaire, et en identifiant deux à deux ses faces opposées, on crée un « hypertore », espace localement euclidien de volume fini.
Les espaces chiffonnés
Du point de vue topologique, le plan et l’espace euclidien ordinaire sont monoconnexes, le cylindre, le tore et l’hypertore sont multiconnexes. Dans un espace monoconnexe, deux points quelconques sont joints par une seule géodésique (l’équivalent d'une droite en espace courbe), tandis que dans un espace multiconnexe, une infinité de géodésiques joignent deux points. Cette propriété confère aux espaces multiconnexes un intérêt exceptionnel en cosmologie. En effet, les rayons lumineux suivent les géodésiques de l'espace-temps. Lorsqu’on observe une galaxie lointaine, nous avons coutume de croire que nous la voyons en un unique exemplaire, dans une direction donnée et à une distance donnée. Or, si l’espace cosmique est multiconnexe, il y a démultiplication des trajets des rayons lumineux, donnant des images multiples de la galaxie observée. Comme toute notre perception de l'espace provient de l’analyse des trajectoires des rayons lumineux, si nous vivions dans un espace multiconnexe nous serions plongés dans une vaste illusion d’optique nous faisant paraître l’univers plus vaste que ce qu’il n'est; des galaxies lointaines que nous croirions « originales » seraient en réalités des images multiples d’une seule galaxie, plus proche dans l'espace et dans le temps.
Figure : Un univers très simple à deux dimensions illustre comment un observateur situé dans la galaxie A (sombre) peut voir des images multiples de la galaxie B (claire). Ce modèle d’univers, appelé tore, est construit à partir d’un carré dont on a « recollé » les bords opposés : tout ce qui sort d’un côté réapparaît immédiatement sur le côté opposé, au point correspondant. La lumière de la galaxie B peut atteindre la galaxie A selon plusieurs trajets, de sorte que l’observateur dans la galaxie A voit les images de la galaxie B lui parvenir de plusieurs directions. Bien que l’espace du tore soit fini, un être qui y vit a l’illusion de voir un espace, sinon infini (en pratique, des horizons limitent la vue), du moins plus grand que ce qu’il n’est en réalité. Cet espace fictif a l’aspect d’un réseau construit à partir d’une cellule fondamentale, qui répète indéfiniment chacun des objets de la cellule.
Les modèles d’ univers chiffonné permettent de construire des solutions cosmologiques qui, quelle que soit leur courbure, peuvent être finies ou infinies, et décrites par des formes (topologies) d’une grande subtilité. Ces modèles peuvent parfaitement être utilisés pour décrire la forme de l’espace à très grande échelle. Un espace chiffonné est un espace multiconnexe de volume fini, de taille est plus petite que l’univers observé (dont le rayon apparent est d’environ 15 milliards d’années-lumière).
Les espaces chiffonnés créent un mirage topologique qui démultiplie les images des sources lumineuses. Certains mirages cosmologiques sont déjà bien connus des astronomes sous le nom de mirages gravitationnels. Dans ce cas, la courbure de l’espace au voisinage d'un corps massif situé sur la ligne de visée d’un objet plus lointain, démultiplie les trajets des rayons lumineux provenant de l'arrière-plan. Nous percevons donc des images fantômes regroupées dans la direction du corps intermédiaire appelé « lentille ». Ce type de mirage est dû à la courbure locale de l’espace autour de la lentille.
Dans le cas du mirage topologique, ce n’est pas un corps particulier qui déforme l’espace, c’est l’espace lui-même qui joue le rôle de la lentille. En conséquence, les images fantômes sont réparties dans toutes les directions de l'espace et toutes les tranches du passé. Ce mirage global nous permettrait de voir les objets non seulement sous toutes leurs orientations possibles, mais également à toutes les phases de leur évolution.
Tests observationnels de l'univers chiffonnés
Si l’espace est chiffonné, il l’est de façon subtile et à très grande échelle, sinon nous aurions déjà identifié des images fantômes de notre propre galaxie ou d'autres structures bien connues. Or, ce n’est pas le cas. Comment détecter la topologie de l’univers? Deux méthodes d’analyse statistique ont été développées récemment. L’une, la cristallographie cosmique, tente de repérer certaines répétitions dans la distribution des objets lointains. L’autre étudie la distribution des fluctuations de température du rayonnement fossile. Ce vestige refroidi du big-bang permettrait, si l’espace est chiffonné, de mettre en évidence des corrélations particulières prenant l’aspect de paires de cercles le long desquels les variations de température cosmique d’un point à l’autre seraient les mêmes.
Les projets expérimentaux de cristallographie cosmique et de détection de paires de cercles corrélés sont en cours. Pour l’instant, la profondeur et la résolution des observations ne sont pas suffisantes pour tirer des conclusions sur la topologie globale de l’espace. Mais les prochaines années ouvrent des perspectives fascinantes ; elles livreront à la fois des sondages profonds recensant un très grand nombre d’amas lointains de galaxies et de quasars, et des mesures à haute résolution angulaire du rayonnement fossile. Nous saurons peut-être alors attribuer une forme à l'espace.
Bibliographie
Jean-Pierre Luminet, Les trous noirs, Le Seuil / Points Sciences, 1992.
Jean-Pierre Luminet, L’univers chiffonné, Fayard, 2001.
COMMENTAIRES
AJOUTER UN COMMENTAIRE LIRE LES COMMENTAIRES
Alain MOCCHETTI 14/02/2018 00H09
QU'EST-CE QU’UN VORTEX ESPACE - TEMPS ET UN TROU DE VER ?
Un Vortex Espace – Temps ou Porte Spatio-Temporelle est un 4ème type de VORTEX qui permet de voyager à la fois dans l’Espace et dans le Temps :
- Voyager dans l’Espace en reliant un Univers Multiple à un autre,
- Voyager dans l’Espace en reliant un Univers Parallèle à un autre,
- Voyager dans l’Espace en reliant 2 points au sein du même Univers Multiple ou du même Univers Parallèle.
Il permet de voyager également dans le Temps :
- Du Futur vers le Passé,
- Du Passé vers le Futur.
Certains Vortex qui permettent de voyager dans l’Espace Temps sont appelés TROU DE VER.
Définition d’un Trou de Ver :
Un trou de ver est, en physique, un objet hypothétique qui relierait deux feuillets distincts ou deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifesterait, d'un côté, comme un trou noir et, de l'autre côté, comme un trou blanc. Un trou de ver formerait un raccourci à travers l'espace-temps. Pour le représenter plus simplement, on peut se représenter l'espace-temps non en quatre dimensions mais en deux dimensions, à la manière d'un tapis ou d'une feuille de papier. La surface de cette feuille serait pliée sur elle-même dans un espace à trois dimensions. L'utilisation du raccourci « trou de ver » permettrait un voyage du point A directement au point B en un temps considérablement réduit par rapport au temps qu'il faudrait pour parcourir la distance séparant ces deux points de manière linéaire, à la surface de la feuille. Visuellement, il faut s'imaginer voyager non pas à la surface de la feuille de papier, mais à travers le trou de ver, la feuille étant repliée sur elle-même permet au point A de toucher directement le point B. La rencontre des deux points serait le trou de ver. L'utilisation d'un trou de ver permettrait le voyage d'un point de l'espace à un autre (déplacement dans l'espace), le voyage d'un point à l'autre du temps (déplacement dans le temps) et le voyage d'un point de l'espace-temps à un autre (déplacement à travers l'espace et en même temps à travers le temps). Les trous de ver sont des concepts purement théoriques : l'existence et la formation physique de tels objets dans l'Univers n'ont pas été vérifiées. Il ne faut pas les confondre avec les trous noirs, dont l'existence tend à être confirmée par de nombreuses observations, dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière de s'en échapper.
Alain Mocchetti
Ingénieur en Construction Mécanique & en Automatismes
Diplômé Bac + 5 Universitaire (1985)
UFR Sciences de Metz
alainmocchetti@sfr.fr
alainmocchetti@gmail.com
@AlainMocchetti
VIDEO canal U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LA GRAVITATION |
|
|
| |
|
| |
LA GRAVITATION
Le terme gravitation a une origine relativement récente puisqu'il date du XVIIIème siècle : il a été inventé pour désigner une théorie qui jetait un pont entre les phénomènes terrestres et célestes. Ce pont fut la physique de Newton pendant 250 ans, mais en 1916, ce pont s'est avéré un peu étroit pour canaliser les découvertes de la physique moderne. Il fut donc remplacé par un « Golden Gate Bridge » : la relativité générale d'Einstein.
Texte de la 578 e conférence de l'Université de tous les savoirs prononcée le 21 juin2005
Par Nathalie Deruelle: « La gravitation »
la transcription de cette conférence a été réalisée par Pierre Nieradka
1. Le terme « gravitation » a une origine relativement récente puisqu'il date du XVIIIème siècle : il a été inventé pour désigner une théorie, un cadre de pensée même, tout à fait nouveaux, qui jetaient pour la première fois un pont entre les phénomènes terrestres et célestes. Ce pont fut la physique de Newton, qui tint pendant 250 ans. Mais en 1916, ce « Pont-Neuf » s'avéra trop étroit pour canaliser les découvertes de la physique moderne ; il fut remplacé par un «Golden Gate Bridge » : la relativité générale d'Einstein.
I / Contexte historique :
2. La science grecque faisait une distinction très nette entre Ciel et Terre. Le monde des astres était la réalisation de la géométrie d'Euclide ; leurs mouvements, sans cause, étaient décrits en termes purement mathématiques. En revanche, c'étaient en termes quasi-animistes que l'on décrivait notre monde sublunaire. Par exemple, le mot « gravitas » a d'abord décrit une personne « pondérée » avant de désigner la cause de la chute des corps. Cette dichotomie dura presque 2000 ans.
3. Au XVI-XVIIème siècles, deux révolutions résolurent cette dichotomie. La première fut celle de Nicolas Copernic qui eut l'idée, non évidente, de bâtir une nouvelle astronomie en plaçant le Soleil, et non la Terre, au centre du système solaire. Ce changement de point de vue permit d'abord une description plus économique et plus précise du mouvement des astres, comme le montra brillamment Kepler. Mais il permit aussi de considérer les autres étoiles comme le centre d'autres mondes. Ainsi la physique « sublunaire » se mit à étendre considérablement son champ d'application.
4. La deuxième grande révolution fut celle de Galilée, grand astronome, mais aussi et surtout le premier physicien moderne pour avoir dit que « Le livre de la Nature est écrit en termes mathématiques ». Cela signifiait que les mathématiques, et en particulier la reformulation de la géométrie d'Euclide (et de son théorème de Pythagore) par Descartes devaient s'appliquer à la fois au monde céleste et au monde terrestre. Grâce à ces deux révolutions un pont entre Ciel et Terre se dessinait.
5. C‘est Newton qui bâtit réellement ce pont, en 1666, à l'âge de 24 ans, dans la maison de ses parents où il fuyait la peste qui sévissait à Cambridge. Il eut en effet l'idée géniale de considérer que la gravité (la cause de la chute des corps terrestres) devait AUSSI régir le mouvement des astres. Pour marquer ce gigantesque saut conceptuel un nouveau mot fut créé pour désigner cette cause commune, ce « champ de force » qui envahit l'espace de la Terre jusqu'à la Lune : le terme gravitation. Il fallut ensuite formuler cette idée en langage
mathématique, ce qui prit 20 ans de travail à Newton, travail que l'on résume aujourd'hui en deux équations :
La première équation dit que l'accélération d'un corps est proportionnelle à la force qui lui est appliquée. Ainsi si les forces extérieures sont nulles, si donc le mouvement est « libre », le corps a une accélération nulle, une vitesse constante : il est en « translation rectiligne uniforme ». C'est la loi d'inertie des corps libres, le « mouvement inertiel » trouvés par Galilée. Une pomme qui tombe d'un arbre en revanche n'a pas une vitesse constante, comme le montra Galilée ; pas plus que la Lune qui ne va pas en ligne droite puisqu'elle tourne autour de la Terre le long d'un cercle un peu déformé, l'ellipse de Kepler. La pomme et la Lune sont donc soumises à une force, la même avait compris Newton : la force de gravitation exercée par la Terre.
La deuxième équation est l'expression mathématique donnée par Newton à cette force de gravitation : elle est proportionnelle à chacune des deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance (Terre/Lune ou Terre/pomme). Les petites flèches qui surmontent certaines lettres désignent des objets mathématiques, des « vecteurs » qui représentent la direction de la force dans l'espace. Cette direction n'est pas repérée par rapport aux murs de la salle par exemple, mais par rapport à l'ensemble des étoiles lointaines, quasiment fixes, qui définissent un repère, appelé le « repère absolu de Newton ».
6. Ce pont, construit par Newton, ouvrit une ère nouvelle à la physique qui connut deux siècles d'or.
Deux siècles, marqués d'abord par une formulation mathématique de plus en plus performante des équations de Newton, en particulier par Laplace.
Deux siècles marqués aussi par de spectaculaires découvertes. Ainsi l'astronome britannique Herschel découvrit à la fin du XVIIIème siècle que la trajectoire de la planète Uranus était anormale dans le sens où elle ne respectait pas rigoureusement les deux lois de Newton. Adams, en Grande-Bretagne, et Le Verrier, en France, parièrent pour les équations de Newton et émirent l'hypothèse que la trajectoire d'Uranus devait être perturbée par une autre planète, baptisée Neptune. Ils calculèrent la trajectoire de cette planète postulée et deux mois plus tard, elle fut découverte, par l'astronome allemand Gall, à l'endroit prédit ! Cette magnifique confirmation de la théorie de Newton valut à Le Verrier une réception triomphale à l'Académie des sciences, Arago s'exclamant : « Monsieur le Verrier a découvert un astre nouveau au bout de sa plume ».
Enfin, d'autres forces que l'on découvrait peu à peu, notamment la force électrique de Coulomb, pouvaient être décrites par les mêmes équations, en remplaçant les masses des corps par leurs charges.
7. Le tableau avait cependant quelques ombres qui pendant longtemps furent considérées comme de simples curiosités ou alors tout simplement ignorées.
Par exemple, le coefficient de proportionnalité m de la première loi est une masse dite inerte qui mesure la résistance d'un corps au mouvement. Tandis que dans la deuxième loi, le
coefficient m est une masse dite grave qui mesure l'ampleur de la réponse à l'attraction gravitationnelle du corps M. Il n'y a à priori aucune raison que ces deux masses m soient égales mais il se trouve que c'est le cas. Ceci a pour conséquence que le mouvement d'un corps en chute « libre » (c'est à dire soumis seulement à un champ de gravitation) ne dépend pas de sa masse, puisque, en égalant les deux équations, m se simplifie. Newton, étonné de cette égalité, voulut la vérifier avec précision expérimentalement et obtint une précision du millième. La relativité générale se base sur cette égalité comme nous le verrons, d'où l'importance de la vérifier expérimentalement : la précision actuelle est de 10-12 !
Une autre énigme était la trajectoire de Mercure autour du soleil. En effet, malgré les efforts des astronomes, Le Verrier en particulier, pour la faire « rentrer dans le rang » l'ellipse de sa trajectoire tournait autour du soleil un peu plus que ce que la théorie newtonienne prévoyait.
Une autre question enfin concernait le repère « absolu » des étoiles fixes par rapport auquel s'orientent les directions des forces. On remarqua d'abord qu'on pouvait en fait utiliser tout une série d'autres repères pour décrire les mouvements : les repères dits libres, inertiels, ou galiléens, en translation uniforme quelconque par rapport au repère absolu, dans lesquels les deux lois de Newton restent les mêmes. L'utilité du repère absolu était donc limitée. Par ailleurs, les étoiles fixes, censées incarner ce repère absolu, ne peuvent en fait rester fixes car aussi loin soient elles les unes des autres, la force de gravitation les attire.
Ces différentes questions pouvaient laisser penser que le pont de Newton, était peut-être bâti sur du sable.
8. Le premier coup de butoir à l'édifice newtonien vint d'un côté inattendu de la physique, à savoir des propriétés électriques et magnétiques de la matière, plus spécifiquement des propriétés de la lumière, qui est l'agent de transmission de l'interaction électromagnétique entre les corps chargés, propriétés magistralement résumées par Maxwell.
Toutes les expériences montraient en effet que la vitesse de la lumière, c, était la même dans tous les repères libres. Ceci venait évidemment en contradiction avec la loi de composition des mouvements galiléenne qui implique que si je marche à 3km/h dans un TGV qui lui- même traverse une gare à 300km/h, je me déplace à 303 km/h par rapport au quai. Et bien cela n'est plus vrai si je suis un rayon de lumière : je vais à 300 000 km /sec par rapport au TGV ET au quai ! Lorentz et Poincaré essayèrent de réconcilier cette invariance de la vitesse de la lumière et la loi de composition des vitesses. Techniquement, ils réussirent.
9. Prenons par exemple, l'équation de Maxwell
A est une fonction du temps et de l'espace qui repère la position d'un photon (ou rayon de lumière) à un instant donné. Le Carré (ou D'Alembertien) est un opérateur qui agit sur la fonction A et la transforme selon des opérations bien définies. Cette équation est vraie dans un repère R donné, assimilé au repère absolu de Newton. Lorentz et Poincaré remarquèrent qu'on pouvait l'écrire de la même façon dans un autre repère R' allant à la vitesse V par rapport au premier, mais qu'il fallait pour cela introduire de nouvelles variables, auxiliaires, « fictives », x' et t', liées à la position du photon x dans R et au temps t, non pas par les relations prédites par la physique newtonienne, à savoir x'=x-Vt et t'=t, mais par des transformations mathématiques plus compliquées, dites de Lorentz. Et il se trouve que ces transformations sont telles que si la vitesse d'un objet, v=x/t, vaut c, la vitesse de la lumière, dans R, alors sa vitesse « fictive » v' =x'/t' est aussi c dans R'. Ils étaient donc tout près du but.
Il restait cependant un pas à franchir : donner une réalité à cette vitesse « fictive » v'.
C'est Einstein qui en 1905 franchit ce pas et donna son véritable sens aux transformations de Lorentz-Poincaré, par une illumination géniale, qui fut de dire que la variable « auxiliaire, fictive » t' n'était autre que le temps, le temps « pur et simple » mesuré par une horloge liée à R'. Ce fut une véritable révolution car c'était postuler, contrairement à Newton, que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde. « Le temps est affaire de perspective », dépend du repère, de l' « angle » sous lequel on le mesure (comme le dit joliment Jean-Marc Levy-Leblond), et se retrouve donc sur le même pied que la largeur, la hauteur et la profondeur. Bientôt, avec le mathématicien Minkowski, on parla non plus d'espace à trois dimensions mais d'espace-temps à quatre dimensions.
Les lois de Newton étaient formulées comme nous l'avons vu, en termes de vecteurs définis dans un espace à 3 dimensions où s'appliquait le théorème de Pythagore. Puisque le temps était devenu une dimension il fallut, avec le mathématicien Minkowski, reformuler les lois de la mécanique et de l'électromagnétisme en termes de « quadrivecteurs » dans un espace-temps à quatre dimensions où la « distance d'espace-temps » entre deux événements (deux flashs lumineux par exemple) est donnée par un théorème de Pythagore généralisé.
10. En 1905, la gravitation restait cependant décrite par les lois de Newton, alors qu'Einstein venait de montrer que le cadre mathématique dans lequel s'exprimaient ces lois était trop restreint pour rendre compte des phénomènes électromagnétiques. Le pont reliant Ciel et Terre était donc rompu. Einstein considéra cette reconstruction comme prioritaire devant la physique quantique et y consacra dix ans de travail acharné entre 1905 et 1915.
Il trouva la solution grâce à une autre illumination. Supposez que vous tombiez d'un toit en même temps que votre pomme. Comme tous les corps tombent de la même façon la pomme doit rester immobile par rapport à vous, exactement comme si vous étiez dans un astronef, loin de tout champ de gravitation. Vous pouvez donc considérer votre mouvement et celui de la pomme comme libres, et les décrire comme si votre chute avait effacé la gravitation. Vous ne pouvez cependant pas dire que votre mouvement « est comme rien » trop longtemps. Car au bout d'un certain temps vous allez vous apercevoir que la pomme se rapproche lentement de vous. En effet deux objets qui chutent se rapprochent car ils sont attirés par le centre de la Terre. Comment réconcilier cela avec l'idée que ces objets sont censés avoir des mouvements libres l'un par rapport et donc des trajectoires parallèles ?
Pour réconcilier l'idée de mouvement libre avec le fait que les trajectoires convergent, Einstein supposa que les mouvements s'effectuent, non pas dans l'espace euclidien de Newton mais dans un espace courbe où les parallèles peuvent se couper. Pour la mathématisation de ces idées, Einstein fit appel à son ami Marcel Grossman qui lui expliqua les travaux de Riemann, alors récents, sur la géométrie des espaces courbes.
11. Dans un espace-temps courbe le théorème de Pythagore se généralise une nouvelle fois :
La distance ds entre 2 flashs lumineux dépend de 10 fonctions de l'espace et du temps gij(t,x,y,z), appelées la « métrique » de l'espace-temps. Ainsi, grâce à une formidable intuition physique guidée par les mathématiques, Einstein aboutit en 1915-1916 aux nouvelles équations de la gravitation :
Le « tenseur » Gμν représente la courbure de l'espace temps ; c'est un opérateur, un « programme de manipulation » qui agit sur les 10 fonctions gi.Tμν représente la masse énergie des objets qui courbent l'espace temps. Enfin, le coefficient 8πG/c4 assure que pour des espaces faiblement courbés, la théorie newtonienne rejoint celle d'Einstein.
Ces équations sont donc le « Golden Gate Bridge » qui remplace le « Pont Neuf » de Newton.
II / Les succès de la relativité générale :
12. Commençons par passer rapidement en revue quelques tests de la relativité générale, quelques exemples, qui démontrent la puissance de cette théorie.
Nous avons vu précédemment que Le Verrier avait échoué dans ses tentatives d'explications de l'avance du périhélie de Mercure dans le cadre de la théorie newtonienne. Einstein, qui pourtant avait basé sa théorie sur une base très conceptuelle, calcula cette avance dans le cadre de la relativité générale et obtint 43 secondes d'arc par siècle, exactement la valeur observée ! Ce fut dit-il la plus grande émotion scientifique de sa vie.
En 1916, Einstein fit cette fois ci une prédiction : la lumière ne devait pas se propager en ligne droite comme le supposait Newton mais devait être déviée par les champs de gravitation des astres. Eddington vérifia cette prédiction en 1919 ; on la vérifie maintenant avec une grande précision, récemment grâce aux signaux radio émis par la sonde Cassini lors de son voyage vers Saturne. Grâce à cette propriété de la lumière d'être déviée par les corps massifs on peut ainsi maintenant calculer la masse (en particulier la masse invisible des galaxies) présente entre un astre lumineux, un quasar par exemple, et nous en étudiant le trajet que prend la lumière entre lui et nous.
En relativité générale l'écoulement du temps dépend du mouvement mais aussi du champ gravitationnel dans lequel l'horloge se trouve. Ce 3ème effet est appelé le « redshift gravitationnel ». Il a été mesuré pour la première fois en 1963 et aujourd'hui la précision des horloges est telle qu'il est indispensable d'en tenir compte dans les routines du programme du Global Positionning System, sans quoi ce système ne fonctionnerait pas !
Mentionnons enfin, l'effet Shapiro : si on envoie de la Terre un signal laser ou radar sur la lune ou sur une sonde et si ce signal revient, on calcule que le temps que met ce signal pour faire l'aller retour est différent de ce que prévoit la physique newtonienne. C'est aussi la sonde Cassini qui a permis de vérifier cet effet avec la plus grande précision.
Après ce bref survol des tests de la relativité générale, concentrons-nous sur une autre facette de la relativité générale : les ondes gravitationnelles.
13. Commençons par présenter les « pulsars binaires » grâce auxquels les ondes gravitationnelles ont été détectées. Un « pulsar » est une étoile à neutrons, c'est à dire dont la densité est celle de la matière nucléaire, qui peut donc peser 2 ou 3 masses solaires pour seulement quelques kilomètres de rayon. Ces pulsars produisent, par des mécanismes encore mal connus, des champs magnétiques très intenses. De plus, ces étoiles tournent sur elles- mêmes parfois avec une période de rotation de 1 milliseconde (à comparer au 24 h pour la
Terre !). Le champ magnétique tourne alors autour de l'axe de rotation. Ce pulsar émet donc un « pinceau de magnétisme », un faisceau lumineux (radio), qui balaie l'espace comme un gyrophare et qui peut être détecté par des radiotélescopes si la Terre se trouve dans sa trajectoire.
Un pulsar « binaire » est une étoile à neutrons qui gravite autour d'un autre objet, qui peut lui- même être une autre étoile à neutrons. L'intervalle de temps entre l'arrivée sur Terre de deux flashs, 2 « bips » consécutifs du « gyrophare » n'est alors pas constant du fait que pulsar s'éloigne et se rapproche périodiquement de l'observateur, lors de ses révolutions autour de son compagnon. On peut ainsi reconstituer, par cet « effet Doppler », la trajectoire de ce pulsar binaire.
14-15. Enfin, en tournant l'un autour de l'autre, les deux étoiles déforment périodiquement l'espace-temps et ces déformations de la métrique se propagent jusqu'à l'infini : ce sont les ondes gravitationnelles.
16. Il s'agit de mettre en équations ces ondes...
La phase du pulsar, qui donne le rythme auquel le gyrophare tourne, est donné en fonction du temps par l'équation suivante :
Le temps t qui apparaît dans cette équation est celui d'une horloge liée au pulsar. Ce temps n'est pas le même dans le laboratoire qui détecte le signal (la Terre), en raison notamment du ralentissement des horloges. Appelons Τ le temps du laboratoire. On montre à partir des équations d'Einstein de la relativité générale que les temps t et T sont liés par la relation suivante :
Le premier terme correctif Delta R est une correction simplement newtonienne, qui tient compte du fait que la distance entre le pulsar et le laboratoire est variable et que la lumière a une vitesse finie.
Les termes suivants sont des corrections relativistes.
Plus précisément, ∆E, appelé effet Einstein, est une correction qui combine les effets de retard dus au mouvement du pulsar et au champ de gravitation de son compagnon (c'est de ce même effet qu'il faut tenir compte pour faire fonctionner le système GPS). Il s'exprime de la façon suivante :
Enfin, le dernier terme ∆S, est l'effet Shapiro. Il s'agit de l'effet dû au retard que prend la lumière dans le champ de gravitation des étoiles à neutrons :
Les différents paramètres, delta, γ, r, s, etc, intervenant dans ces différentes équations sont des paramètres dits « post-képlériens », dont les valeurs sont nulles en théorie newtonienne. En ajustant cette « formule de chronométrage » Φ=Φ(T) avec la phase phi observée, on obtient les valeurs numériques de ces différents paramètres.
17. Par exemple, pour le pulsar binaire récemment observé par Kramer et al, on trouve que l'avance du périastre est de 16,9 degrés/an (à comparer aux 43 secondes d'arcs par siècle pour Mercure !). De même la période orbitale est de 0,1 jour contre 365 jours pour la Terre. Enfin, l'ellipse de la trajectoire du pulsar rétrécit peu à peu au cours du temps. Le système perd de l'énergie lors de ce rétrécissement et cette énergie est dissipée sous forme d'ondes gravitationnelles. Il s'agit d'un effet extrêmement faible : il faut compter une centaine de millions d'années pour qu'ils deviennent notable.
18. Ces paramètres post-képlériens, comme nous l'avons dit, devraient être nuls en théorie newtonienne. Le fait qu'on observe qu'ils ne le sont pas montre déjà que la théorie newtonienne est inapte à décrire le mouvement d'un tel pulsar binaire. La relativité générale quant à elle, non seulement prédit une valeur non nulle pour ces paramètres mais les exprime en fonction des masses des deux objets MA et MB, selon des formules plus ou moins compliquées extraites des équations d'Einstein.
19. On peut ainsi tracer sur un diagramme l'avance du périastre, la variation de la période orbitale, etc, en fonction des masses MA et MB. Si ces courbes ne se recoupaient pas en un seul point cela signifierait un désaccord entre théorie et expérience car on obtiendrait des valeurs contradictoires pour les masses MA et MB du pulsar et de son compagnon. Mais il se trouve qu'elles se coupent toutes, avec une très grande précision ! L'intersection de deux courbes (l'avance du périastre omega dot et de l'effet Einstein gamma par exemple) donne les masses Ma et MB. Chaque courbe supplémentaire, à condition qu'elle passe au même point, représente un test de la relativité générale ; ainsi le pulsar binaire de Kramer et al fournit trois tests indépendants !
Grâce donc à un système d'étoiles situé à plusieurs milliers d'années-lumière de la Terre on vérifie actuellement une théorie construite en 1915 sur une base surtout conceptuelle avec une précision supérieure au millième.
20. Le test consistant à mesurer le rétrécissement de l'orbite d'un pulsar binaire dû à l'émission d'ondes gravitationnelles et vérifier qu'il coïncide avec la valeur prédite par la relativité générale, a été effectué pour la première fois par Hulse et Taylor à l'aide du premier pulsar binaire qu'ils avaient découvert en 1974. Pendant 30 ans, ils ont monitoré ce système pour mesurer avec un précision de plus en plus grande l'effet cumulatif de retard au périastre dû à ce rétrécissement et ont obtenu un accord entre observation et prédiction supérieur à 2 millièmes. Ces travaux ont valu à Hulse et Taylor le premier prix Nobel de relativité générale en 1993.
III/ Une nouvelle fenêtre sur l'univers :
22-23. Les ondes gravitationnelles ont donc été détectées par l'intermédiaire du rétrécissement de l'ellipse tracée par deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre mais pas « directement »,
c'est à dire par l'intermédiaire de télescopes « gravitationnels » placés sur Terre sensibles aux « frémissements » de la géométrie de l'espace-temps. Tant que les étoiles sont éloignées l'une de l'autre, les ondes gravitationnelles sont beaucoup trop faibles pour être détectées par de tels « télescopes ». En revanche, on peut espérer les détecter lorsque les deux étoiles se rapprochent l'une de l'autre et fusionnent pour donner par exemple un trou noir car alors une énorme « bouffée » d'ondes est émise.
24. Un effort international important est par conséquent mené pour essayer d'observer directement ces ondes. Les Etats-Unis, l'Europe et le Japon construisent actuellement des détecteurs gigantesques, sous forme d'interféromètres constitués de deux bras perpendiculaires d'environ 3 km de long, dans lesquels un faisceau laser se propage et se réfléchit des centaines de fois. Ces différents rayons lumineux se combinent en fin de course en un « creux de lumière », une frange noire. Si une onde gravitationnelle arrive sur Terre, la géométrie d'espace-temps entre les miroirs va être très légèrement perturbée, les miroirs aux extrémités des bras vont très légèrement bouger et une frange de lumière va apparaître puis disparaître.
25. Il s'agit là encore d'expliquer ce mouvement des miroirs en « faisant parler » les équations d'Einstein. L'accélération du pulsar qui va déterminer le mouvement et donc la courbure de l'espace-temps dont les frémissements vont atteindre le détecteur s'exprime de la manière suivante :
Le premier terme est celui de Newton, inversement proportionnel au carré de la distance entre le pulsar et son compagnon.
Les termes suivants sont les corrections relativistes obtenues en résolvant, avec une précision croissante (« itérativement ») l'équation d'Einstein
1/c2.A1PN est le terme donnant en particulier l'avance du périastre.
1/c5A2 .5PN représente la force qui provoque le rétrécissement de l'ellipse observé par Hulse et Taylor (son expression a été obtenue en 1982).
Enfin, le terme 1/c7.A3.5PN a été obtenu au début des années 2000.
26. Mais ce travail n'est qu'une étape pour décrire correctement l'onde gravitationnelle qui va faire bouger les miroirs et qu'on puisse un jour, à partir de ce mouvement, vérifier si la relativité générale décrit correctement le début de la coalescence des deux étoiles : il faut prédire plus précisément encore la phase de l'orbite (liée au temps mis par le pulsar à faire un tour : Φ=Ω.t pour un mouvement circulaire newtonien). Dans son expression obtenue très récemment dans le cadre de la relativité générale, le premier terme décrit le rétrécissement de l'orbite dû au seul terme 1 /c5.A2.5PN. Les corrections suivantes nécessitent la connaissance du champ de gravitation et de la luminosité (puissance rayonnée par ce champ) très loin du pulsar
binaire. Ces calculs on représenté un travail de très longue haleine, où l'école française, pilotée notamment par Thibault Damour, s'est distinguée.
27. Cependant, ces corrections de plus en plus fines à la physique newtonienne ne suffisent plus lorsque les deux étoiles coalescent. Pour décrire cette phase ultime il faut résoudre exactement les équations d'Einstein, ce que l'on ne peut faire que numériquement dans ce cas. La relativité numérique est donc en plein essor, en particulier à l'Observatoire de Meudon. Parmi les succès récents de cette discipline citons le calcul de la coalescence de deux étoiles à neutrons et celle de deux trous noirs ---qu'on ne peut pas voir car les trous noirs ne rayonnent pas de lumière mais qui doivent produire, si ils coalescent, une énorme bouffée d'ondes gravitationnelles.
28. La détection d'ondes gravitationnelles ouvrira une nouvelle fenêtre sur l'univers dans la mesure où il s'agit d'un signal non lumineux, de « friselures » de l'espace-temps. L'observation de ces ondes permettrait d'en savoir plus sur les étoiles à neutrons car le signal gravitationnel émis dépend de leur structure interne. Grâce aux ondes gravitationnelles on devrait donc mieux connaître les propriétés nucléaires de la matière, la structure des trous noirs, voire même les débuts de l'univers dans lequel les ondes gravitationnelles se sont propagées librement bien avant la lumière.
IV / Les défis à relever :
Les succès de la relativité générale sont donc nombreux mais il reste des défis à relever.
29. Le premier est celui de la cosmologie. En effet, toutes les mesures actuelles tendent à montrer que la matière qui compose l'univers est, quasiment en totalité, totalement inconnue (30 % de « matière noire », 70 % d' « énergie noire »). Ainsi la matière dont les étoiles sont constituées ne représenterait qu'une infime partie de la masse totale. L'hypothèse optimiste est de parier sur les équations d'Einstein et de les utiliser pour mieux connaître les caractéristiques de l'univers, la nature de la matière et l'énergie noires ou la valeur de l'accélération de son expansion par exemple. Mais il n'est pas exclu, hypothèse pessimiste que la Relativité Générale trouve ses limites en cosmologie.
30. Le second défi est celui de la quantification de la gravitation : le pont entre Ciel et Terre dressé par Einstein ignore en effet la mécanique quantique dont les lois régissent pourtant superbement le monde microscopique. Bien qu'aucune évidence expérimentale ne l'impose actuellement (sauf peut-être les mystères de la cosmologie ?), réconcilier les principes et cadres conceptuels de la relativité générale et de la mécanique quantique est un programme majeur de la physique du XXIème siècle. Des théories sont en chantier pour tenter de répondre à ces interrogations, parmi elles la théorie des supercordes sur laquelle beaucoup de physiciens fondent leurs espoirs depuis déjà une trentaine d'années.
VIDEO canal U LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LES NEUTRINOS DANS L'UNIVERS |
|
|
| |
|
| |
LES NEUTRINOS DANS L'UNIVERS
Notre corps humain contient environ 20 millions de neutrinos issus du big bang, émet quelques milliers de neutrinos liés à sa radioactivité naturelle. Traversé en permanence par 65 milliards de neutrinos par cm2 par seconde venus du Soleil, il a été irradié le 23 février 1987 par quelques milliards de neutrinos émis il y a 150000 ans par l'explosion d'une supernova dans le Grand Nuage de Magellan. Les neutrinos sont également produits dans l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère ou dans les noyaux actifs de galaxies… Quelle est donc cette particule présente en abondance dans tout l'Univers où elle joue un rôle-clé ? Inventé par W.Pauli en 1930 pour résoudre le problème du spectre en énergie des électrons dans la désintégration b, le neutrino fut découvert par F.Reines et C.Cowan en 1956, auprès du réacteur nucléaire de Savannah River (Caroline du Sud). Il n'a plus depuis quitté le devant de la scène, que ce soit chez les physiciens des particules, les astrophysiciens ou les cosmologistes. Cette particule élémentaire, sans charge électrique, n'est soumise qu'à l'interaction faible, ce qui lui permet de traverser des quantités de matière importantes sans interagir. En 1938, H.Bethe imaginait que des réactions nucléaires de fusion étaient au coeur de la production d'énergie des étoiles, en premier lieu le Soleil. Dans les années 60, les astrophysiciens se lancent dans la construction de modèles solaires et des expérimentateurs dans la construction de détecteurs pour les piéger. Il a fallu attendre 2002 pour comprendre que le déficit de neutrinos solaires observé (le célèbre "problème des neutrinos solaires") était dû à un phénomène lié à la mécanique quantique, appelé l'oscillation des neutrinos. La mise en évidence de cette oscillation a apporté la preuve décisive que les neutrinos avaient une masse non nulle. Nous ferons le point sur cette particule fascinante après les découvertes récentes.
Texte de la 581 e conférence de l'Université de tous les savoirs prononcée le 24 juin
2005
Par Daniel Vignaud: « Les neutrinos dans l'Univers »
Introduction
Notre corps humain contient environ 20 millions de neutrinos issus du big bang et émet chaque seconde quelques milliers de neutrinos liés à sa radioactivité naturelle. Traversé en permanence par 65 milliards de neutrinos par cm2 par seconde venus du Soleil et quelques millions d'antineutrinos cm2 par seconde venus de la Terre, il a été irradié le 23 février 1987 par quelques milliards de neutrinos émis il y a 150000 ans par l'explosion d'une supernova dans le Grand Nuage de Magellan. Les neutrinos sont également produits dans l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère ou dans les noyaux actifs de galaxies... Quelle est donc cette particule présente en abondance dans tout l'Univers où elle joue un rôle-clé ?
Inventé par W. Pauli en 1930 pour résoudre le problème du spectre en énergie des électrons dans la désintégration b, le neutrino fut découvert par F. Reines et C. Cowan en 1956, auprès du réacteur nucléaire de Savannah River (Caroline du Sud). Il n'a plus depuis quitté le devant de la scène, que ce soit chez les physiciens des particules, les astrophysiciens ou les cosmologistes. Cette particule élémentaire, sans charge électrique, n'est soumise qu'à l'interaction faible, ce qui lui permet de traverser des quantités de matière importantes sans interagir.
En 1938, H. Bethe imaginait que des réactions nucléaires de fusion étaient au cSur de la production d'énergie des étoiles, en premier lieu le Soleil. Dans les années 60, les astrophysiciens se lancent dans la conception de modèles solaires et des expérimentateurs dans la construction de détecteurs pour les piéger. Il a fallu attendre 2002 pour comprendre avec certitude que le déficit de neutrinos solaires observé (le célèbre « problème des neutrinos solaires ») était dû à un phénomène lié à la mécanique quantique, appelé l'oscillation des neutrinos. La mise en évidence de cette oscillation a apporté la preuve décisive que les neutrinos avaient une masse non nulle.
Nous ferons le point sur cette particule fascinante après les découvertes récentes.
1. Le neutrino, particule élémentaire
Le neutrino est né en 1930 pour répondre à un problème expérimental non résolu. A la fin des années 20, période charnière en physique s'il en est, les physiciens s'interrogent sur une difficulté liée à la désintégration b des noyaux radioactifs. L'énergie de l'électron émis devrait avoir une valeur unique et non la forme d'un spectre étendu comme il est observé. Niels Bohr va alors jusqu'à proposer de manière iconoclaste que l'énergie n'est pas conservée dans un tel processus. En décembre 1930, Wolfgang Pauli, dans une lettre restée célèbre « Chers messieurs et dames radioactifs ... », émet l'hypothèse qu'une particule inconnue emporte une partie de l'énergie pour rétablir l'équilibre. Il n'est pas trop sûr de son idée, pourtant géniale, et il faudra plusieurs mois pour qu'il l'élabore plus officiellement. Le déclic a lieu à Rome à l'automne 1933. Enrico Fermi, qui a baptisé la particule « neutrino » (le petit neutre), l'incorpore à la théorie de l'interaction faible qu'il construit magistralement.
Le neutrino restera longtemps à l'état de particule « virtuelle ». Plusieurs physiciens, et non des moindres comme Hans Bethe, écriront même qu'il est quasiment impossible de le mettre en évidence, tant est faible sa probabilité d'interaction. Il faudra attendre d'avoir des sources de neutrinos suffisamment puissantes.
Le neutrino sera découvert en 1956 par Frederick Reines et Clyde Cowan, auprès du réacteur de Savannah River (Caroline du Sud), après une première tentative en 1953. Il s'agit en réalité de l'antineutrino émis dans la fission de l'uranium. Lorsque cet antineutrino interagit avec un proton de la cible, il émet un positron (antiparticule de l'électron) et un neutron. La détection simultanée de ces deux particules est la signature non ambiguë de l'interaction de l'antineutrino. Ces neutrinos associés avec un électron sont appelés neutrinos électroniques ne.
En 1962 une équipe de physiciens mettra en évidence un deuxième type de neutrinos, le neutrino-muon nm, auprès de l'accélérateur du Brookhaven National Laboratory. Les nm sont issus de la désintégration des mésons p (ou pions) en association avec un muon m, le m étant un lepton plus lourd que l'électron. A la suite de la découverte d'un troisième lepton encore plus lourd, le tau t, en 1978, il était clair qu'il y avait un troisième type de neutrinos associé, le nt. Celui-ci ne sera découvert qu'en 2000.
Combien y a-t-il d'espèces de neutrinos ? La réponse est venue du collisionneur électron-positron du CERN, le LEP, en 1990. En mesurant avec précision la largeur de désintégration du boson Z, proportionnelle au nombre d'espèces, les physiciens ont déterminé qu'il n'y en avait que trois. Ces trois neutrinos et les trois leptons chargés qui leur sont associés sont les briques leptoniques de la matière, soumises à l'interaction faible. Les 6 quarks sont les briques hadroniques de la matière, soumises à l'interaction forte. Ils sont regroupés en trois doublets dont l'association aux 3 doublets leptoniques est fondamentale au modèle standard de la physique des particules. Toutes les particules chargées sont en outre soumises à l'interaction électromagnétique, dont l'intensité est intermédiaire entre la force faible et la force forte. Les neutrinos, sans charge électrique, ne sont soumis qu'à l'interaction faible : ils interagissent environ mille milliards de fois moins que l'électron, qui lui-même interagit environ cent fois moins qu'un proton. Quid de leur masse ? Attendons la suite.
2. L'oscillation des neutrinos
Dans le modèle standard dit « minimal » de la physique des particules, les neutrinos n'ont pas de masse. C'est à priori surprenant car toutes les autres briques de matière (quarks, électrons, muons, ...) en ont une. Les tentatives de mesurer directement cette masse sont restées vaines. Les physiciens les plus ingénieux n'ont pu mettre que des limites supérieures sur leur valeur. Et cette limite supérieure est bien inférieure à la masse des leptons chargés associés. Par exemple celle sur la masse du ne est 1 eV [1] alors que la masse de l'électron est de 511000 eV (et celle du proton un milliard d'eV). Si les mesures directes ne donnent rien pour l'instant, il faut faire appel à la ruse, en l'occurrence une propriété liée à la mécanique quantique.
La mécanique quantique nous dit que les neutrinos que l'on observe, les ne, nm ou nt ne coïncident pas nécessairement avec ce qu'on appelle les états propres de masse mais peuvent en être des superpositions. Si les neutrinos ont une masse, le calcul montre alors que lorsqu'ils se déplacent, ils peuvent se transformer (plus ou moins totalement) d'une espèce dans une autre. Le phénomène est périodique en fonction de la distance L parcourue entre la source et le détecteur et a pris le nom d'oscillation. La longueur d'oscillation est proportionnelle à l'énergie et inversement proportionnelle à la différence des carrés des masses des deux neutrinos considérés. Comme nous avons 3 familles de neutrinos, les paramètres de l'oscillation sont 3 angles de mélange qi et deux différences des carrés des masses Dm2ij. La mise en évidence de l'oscillation serait donc une preuve directe que les neutrinos sont massifs.
Si nous voulons illustrer de manière simple le mécanisme d'oscillation et ses conséquences, donnons une couleur à chaque espèce de neutrinos, par exemple bleu pour le ne, rouge pour le nm et vert pour le nt. Supposons une source de neutrinos bleus et un détecteur de neutrinos sensible uniquement aux neutrinos rouges. Si le détecteur ne compte rien, c'est qu'il n'y a pas eu d'oscillation ; si le détecteur compte toujours du rouge, c'est que l'oscillation est maximale ; si le détecteur compte parfois du rouge c'est que le mélange est partiel.
La question de la masse des neutrinos est fondamentale pour ouvrir la porte du modèle standard vers de nouvelles théories plus complètes. Comme nous allons le voir, le mécanisme d'oscillation va prouver non seulement que les neutrinos ont une masse, mais également qu'il est la clé de plusieurs énigmes astrophysiques.
3. Les neutrinos solaires
Depuis les années 20, on pressent que la source d'énergie du Soleil (et des étoiles) est d'origine nucléaire. Les neutrinos nous en ont apporté la preuve directe, à la suite de quarante années excitantes d'échanges passionnés entre les astrophysiciens qui construisent des modèles du Soleil, les expérimentateurs qui inventent et mettent en Suvre des détecteurs de plus en plus gros et de plus en plus sensibles, les théoriciens qui affinent notre compréhension du comportement des neutrinos.
Le Soleil est une gigantesque boule de gaz, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Au centre, la température est suffisamment élevée (15 millions de degrés) pour initier des réactions nucléaires de fusion entre deux protons (deux noyaux d'hydrogène). Cette fusion produit un noyau de deutérium, un positron et un ne. Il s'ensuit un cycle compliqué de réactions nucléaires où l'hydrogène va se transformer en hélium en libérant une minuscule quantité d'énergie (10-12W). Lorsque l'on connaît l'énergie produite par le Soleil (1360 W par m2 sur Terre), on calcule que l'on est bombardé en permanence par 65 milliards de neutrinos solaires par cm2 par seconde.
L'histoire commence en 1964 par des discussions entre deux scientifiques que rien ne destinait à collaborer. L'astrophysicien John Bahcall fait les premiers calculs du flux et du spectre en énergie des neutrinos solaires. Raymond Davis, un chimiste, reprend une de ses idées antérieures de détecter les ne avec du chlore grâce à la réaction ne + 37Cl ® e- + 37Ar qui fait intervenir un des isotopes du chlore. Cette méthode radiochimique nécessite de construire un détecteur contenant 600 tonnes de tétrachlorure de carbone C2Cl4, de le placer profondément sous terre dans la mine d'or de Homestake (Dakota du Sud), d'extraire régulièrement les atomes d'argon radioactif (37Ar) et de compter leur désintégration, témoignage direct du passage des neutrinos solaires. L'expérience est difficile car malgré le flux important de neutrinos qui traverse le détecteur, un par jour seulement transmute le chlore en argon. Les premiers résultats, en 1968, montreront que Davis compte trois fois moins d'argon que prévu. C'est le début de ce que l'on a appelé le problème ou l'énigme des neutrinos solaires.
Les astrophysiciens ont raffiné leurs modèles ; plusieurs équipes, dont des françaises, ont brillamment contribué à mieux connaître le fonctionnement du Soleil. L'expérience chlore a continué pendant 30 ans, perfectionnant sa méthode, traquant les inefficacités. D'autres expériences se sont construites : Kamiokande au Japon, à partir de 1986 avec 3000 tonnes d'eau ; les expériences gallium (GALLEX au laboratoire souterrain du Gran Sasso, Italie, et SAGE au laboratoire souterrain de Baksan, Caucase), à partir de 1990 rassemblant près de 100 tonnes de ce précieux métal ; SuperKamiokande au Japon à partir de 1996 et ses 50000 tonnes d'eau. Rien à faire : le flux mesuré est toujours resté inférieur au flux calculé, après toutes les vérifications expérimentales et les progrès théoriques.
Parallèlement, les physiciens des particules, dans leur tentative d'inclure les neutrinos dans leur modèle standard, étudiaient sérieusement cette possibilité que les neutrinos puissent osciller d'une espèce dans une autre. Ils mettaient en évidence un effet nouveau d'amplification possible de l'oscillation dans la matière du Soleil. A la fin des années 90, il était séduisant de penser que les neutrinos solaires n'avaient pas disparu, mais que les ne s'étaient transformés en nm ou nt (hypothèse confortée par la mise en évidence de l'oscillation des nm atmosphériques en 1998 comme nous le verrons dans le chapitre suivant). En effet, tous les détecteurs n'étaient sensibles qu'à ces ne et pas aux nm ou nt. Mais il manquait la preuve ! C'est alors que le détecteur SNO (Sudbury Neutrino Observatory) entre en scène. Utilisant une cible de 2000 tonnes d'eau lourde placée à 2000 m sous terre dans une mine de nickel au Canada, SNO a pu observer non seulement les interactions des ne (ne d ® e- p p) en mesurant l'électron, mais également les interactions de toutes les espèces (n d ® n p n) en mesurant le neutron. En juin 2001, les physiciens de SNO ont pu annoncer que les ne n'avaient pas vraiment disparu, mais qu'ils s'étaient transformés par le mécanisme d'oscillation. Ils montraient également que le flux total de neutrinos solaires était bien égal à celui calculé par les modèles. Ils continuent d'affiner leurs mesures, mais l'essentiel est là, fabuleux épilogue d'une belle histoire scientifique. Nous savons aujourd'hui que les neutrinos solaires se transforment en grande partie (mais pas totalement) en nm ou nt, sans savoir dans quel type en particulier.
4. Les neutrinos atmosphériques.
L'atmosphère est bombardée en permanence par le rayonnement cosmique, constitué pour l'essentiel de protons ou de noyaux plus lourds. Lorsque ces particules arrivent dans les hautes couches de l'atmosphère, elles interagissent avec l'air en produisant des pions. Ceux-ci vont se désintégrer en émettant un muon m et un neutrino nm. Après un parcours variable, le muon lui-même se désintègre en un électron, un antineutrino électronique et un nm. Un bilan rapide donne au niveau du sol deux fois plus de nm que de ne si on oublie la distinction particule-antiparticule, sans importance au premier ordre. Des modèles phénoménologiques calculent toutes les caractéristiques des neutrinos (nature, énergie, direction,...) avec la précision requise.
La mesure des neutrinos atmosphériques est intéressante en soi, mais n'était pas prioritaire pour les physiciens, car la source de ces neutrinos n'a que peu d'intérêt astrophysique. Ils y sont venus lorsqu'ils ont construit au début des années 80 des détecteurs pour observer la désintégration du proton, processus fondamental prédit par les théories de grande unification (fort heureusement avec une durée de vie supérieure à 1032 ans qui nous laisse le temps d'y penser). En effet, les interactions des neutrinos atmosphériques dans le détecteur constituaient un bruit de fond incontournable pour le signal attendu pour la mort du proton.
Le proton s'accrochant à la vie plus que prévu, les physiciens se sont concentrés sur les neutrinos atmosphériques, en essayant de comptabiliser séparément les ne des nm. Les premières expériences (Fréjus au laboratoire souterrain de Modane, Kamiokande au Japon, IMB dans l'Ohio) donnaient des résultats contradictoires. Avec quelques poignées d'événements, certaines observaient un rapport entre les deux types de neutrinos conforme aux prédictions, d'autres observaient un peu moins de nm que prévu. La difficulté de séparer les interactions des deux types de neutrinos (un électron dans un cas, un muon dans l'autre) et la faible statistique rendaient la communauté sceptique.
SuperKamiokande, dont nous avons déjà parlé pour les neutrinos solaires, arrive au printemps 1996. 50000 tonnes d'eau ultra-pure sont observées par plus de 10000 photomultiplicateurs, comme autant d'yeux. Ceux-ci sont sensibles à la lumière Tcherenkov émise dans l'ultra-violet par le passage des particules chargées. L'électron et le muon ont un comportement légèrement différent. Le muon produit un bel anneau de lumière, l'électron un anneau plus flou, plus large. En deux ans, la collaboration SuperKamiokande accumule plusieurs milliers d'interactions de neutrinos et raffine la séparation des deux types. En juin 1998, elle annonce qu'il y a bien un déficit de nm mais que les ne sont au rendez-vous avec le nombre attendu. Elle précise que le déficit de nm est associé à ceux venus des antipodes, c'est-à-dire ceux qui ont traversé la terre en parcourant une distance de plusieurs milliers de km. Comme nous avons appris que l'oscillation dépendait de la distance parcourue, l'interprétation en termes d'oscillation s'imposait naturellement. Depuis, tous les artefacts ont été traqués, les données se sont accumulées, et nous avons maintenant la certitude que non seulement les nm oscillent, mais qu'ils se transforment intégralement en nt.
5. Les neutrinos de supernova
Nous avons vu que les neutrinos étaient les témoins directs de la vie du Soleil : 8 minutes après avoir été produits au cSur de l'étoile, ces messagers nous informent que l'astre qui conditionne la vie sur Terre est en parfaite santé ; il est en plein âge mûr et a encore plus de 4 milliards d'années devant lui. Mais les neutrinos peuvent être également les messagers de la mort des étoiles lorsqu'elles explosent à la fin de leur vie, phénomène que l'on appelle supernova.
Le Grand Nuage de Magellan est une petite galaxie voisine de la Voie Lactée, notre Galaxie, à 150000 années-lumière, visible depuis l'hémisphère sud. A la fin de février 1987, un événement astronomique n'est pas passé inaperçu : nous avons reçu sur Terre le faire-part de décès d'une étoile de ce Nuage, Sanduleak -69°202, il y a justement 150000 ans. Et le message a été transmis par la lumière ... et par les neutrinos.
Dans la nuit du 23 au 24 février 1987, à l'observatoire chilien de Las Campanas, un astronome canadien et son assistant chilien observent par hasard une nouvelle étoile brillante dans le Grand Nuage de Magellan, une étoile qui va être visible pendant quelques dizaines de jour sans télescope. C'est la première supernova de l'année 1987 et elle sera baptisée SN1987A. Il y a des siècles qu'une supernova n'a pas été observée à l'Sil nu. Assez proche de la Terre (tout est relatif), elle n'intéresse pas que les astronomes. Depuis les années 40, on sait que les explosions de certaines supernovas sont des sources de neutrinos. Il devient urgent de le vérifier. Par chance, il y a deux ou trois détecteurs de neutrinos en fonctionnement, en particulier celui de Kamiokande au Japon, qui vient d'entrer en service il y a quelques semaines. Dès l'annonce du télégramme, les japonais se précipitent sur les données accumulées dans les dernières heures. Bienheureuse surprise lorsqu'ils découvrent que, le 23 février à 7h35 en temps universel, une dizaine de signaux caractéristiques se détachent du ronronnement du détecteur (qu'ils appellent le bruit de fond). Le phénomène a duré une poignée de secondes. Une dizaine de neutrinos voyageant depuis 150000 ans se sont laissés piéger par le détecteur souterrain. Mission accomplie pour ces témoins directs de la mort d'une étoile.
Les étoiles ne peuvent vivre qu'en consommant des quantités considérables de carburant. Plus elles sont massives, plus elles en consomment et moins elles vivent longtemps : le carburant s'épuise plus vite car la température centrale de l'étoile est plus élevée. L'histoire commence toujours par la transformation de l'hydrogène en hélium, comme dans le Soleil. Mais ensuite le cycle de réactions nucléaires fait intervenir le carbone, l'oxygène, le néon, puis le silicium, et enfin le fer, le noyau le plus stable. La structure de l'étoile est alors comparable à celle d'un oignon, avec les éléments les plus lourds au centre. Lorsque le cSur de fer a atteint une masse de 1,4 fois celle du Soleil, appelée masse de Chandrasekhar, il s'effondre violemment sur lui-même. La température monte brutalement, mais aucune réaction nucléaire ne peut plus avoir lieu car il n'y a plus de combustible approprié. La densité devient extrême. Les nombreux photons vont alors provoquer la photodésintégration du fer qui va retourner à l'état initial de protons et de neutrons. C'est alors que les électrons se font capturer par les protons dans une réaction (e- p ® n ne) qui est source de neutrinos, les premiers témoins de la mort de l'étoile. Des réactions d'annihilation entre les électrons et les positrons produisent des paires neutrino-antineutrino et ces malheureux restent quelques instants prisonniers tellement la densité est élevée. Soudain, alors que la partie centrale du cSur ne fait plus qu'une vingtaine de km de diamètre, elle se durcit brutalement et provoque le rebond des couches externes, qui tombent en chute libre, créant une formidable onde de choc. L'implosion, jusque là cachée aux yeux extérieurs se transforme en une gigantesque déflagration dévastatrice qui va se propager à travers les pelures de l'oignon. Les couches externes sont alors balayées vers l'extérieur. Au moment de l'explosion, l'étoile qui meurt devient brillante comme mille soleils et les neutrinos libérés se propagent dans tout l'espace.
Dans la réalité, les choses sont un peu plus complexes et les physiciens qui modélisent n'ont pas réussi à faire exploser l'étoile : l'énergie rejetée violemment vers l'extérieur ne serait pas suffisante pour traverser toutes les couches externes qui n'arrêtent pas de tomber vers le centre. Et pourtant l'étoile explose puisqu'on en voit le feu d'artifice. Les physiciens ont alors pensé que les neutrinos pourraient jouer un rôle dans cette explosion en venant à la rescousse de la déflagration. La situation s'améliore, mais l'explosion n'est pas assurée. S'il y a encore du travail, on pense aujourd'hui que les neutrinos sont bien des acteurs indispensables à l'explosion.
Une grande partie de l'énergie gravitationnelle de l'étoile se transforme en neutrinos de toutes les espèces et le nombre produit lors de l'explosion est fabuleux. Environ 1058 de ces particules ont été émises dans toutes les directions. 500 millions de milliards ont traversé le détecteur Kamiokande en moins de 10 secondes et une dizaine a laissé un signal.
Depuis 1987, d'autres détecteurs plus gros, plus performants ont été construits ou sont en projet. La veille est longue. La Nature ne nous a pas encore récompensé d'une nouvelle explosion. Mais nous sommes sûrs que les neutrinos messagers de la mort des étoiles sont déjà en route vers nous. A quand le prochain signal ? Dans un jour, dans un an ou dans dix ans ? Sachons être patients.
6. Les neutrinos extragalactiques
L'Univers est le siège de phénomènes particulièrement violents. Nous venons d'en voir un exemple avec les supernovas, mais il existe des astres dont la violence est permanente. Et si là encore les neutrinos pouvaient compléter les informations que nous donne la lumière reçue dans les télescopes, des ondes radio aux photons gamma en passant par la lumière visible.
Parmi les sources de lumière particulièrement intenses se trouvent les quasars. Il s'agit de trous noirs très massifs, en général au cSur d'une galaxie (on les appelle aussi noyaux actifs de galaxie), qui brillent à eux tout seuls beaucoup plus que le reste de la galaxie. Le trou noir attire la matière avant de l'engloutir, ce qui fournit une fabuleuse source d'énergie gravitationnelle (un ogre comme 3C273, à plus d'un milliard d'années-lumière de nous, se nourrit chaque année de l'équivalent de plusieurs soleils). Cette matière a la forme d'un disque, appelé disque d'accrétion. Perpendiculairement à ce disque, deux puissants jets de particules relativistes sont émis à des distances de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Dans ces jets, il y a bien sûr des électrons, qui émettent en particulier des rayons gamma très énergiques, du keV au TeV, que l'on observe tous les jours avec les satellites comme INTEGRAL ou les détecteurs au sol comme HESS, en Namibie. Mais il y a aussi probablement des protons. Et ces protons, dans leurs interactions avec la matière environnante, vont produire des pions (rappelons nous les neutrinos atmosphériques) qui vont se désintégrer en gammas s'ils sont neutres ou en muons et neutrinos s'ils sont chargés. Pour nous aider à comprendre le fonctionnement de ces quasars ou d'autres objets astrophysiques comme les pulsars binaires ou les sursauts gamma, il est important de mesurer le flux de neutrinos qu'ils émettent.
Les neutrinos offrent bien des avantages : comme ils interagissent très faiblement, ils peuvent traverser des quantités importantes de matière alors que même les gammas peuvent être absorbés sur des distances cosmologiques ; comme ils n'ont pas de charge, ils ne sont pas déviés par les champs magnétiques galactiques ou intergalactique des régions traversées. Mais il n'y a pas que des avantages. L'inconvénient majeur est bien sûr leur minuscule probabilité d'interaction, même si celle-ci augmente proportionnellement à leur énergie. En outre, les flux prédits par les modèles, si importants soient-ils, sont des milliards de fois inférieurs à celui des neutrinos solaires. La tâche est herculéenne.
Depuis une trentaine d'années, des projets de détecter ces neutrinos venus de l'enfer des quasars ou des sursauts gamma sont à l'étude. Depuis une dizaine d'années, plusieurs sont en construction, que ce soit dans la glace du pôle sud (AMANDA) ou au fond de la Méditerranée (ANTARES). Le principe est toujours le même. Il faut s'affranchir des bruits de fond parasites en s'installant à quelques milliers de mètres de profondeur. Mais même à 2 ou 3 mille mètres, les neutrinos atmosphériques sont le signal dominant (de la même façon qu'on ne voit pas les étoiles durant le jour car la lumière du Soleil est beaucoup plus forte). L'astuce consiste à observer les neutrinos venus des antipodes et qui ont traversé la Terre, utilisée comme filtre au rayonnement parasite. AMANDA observe ainsi l'hémisphère nord du ciel et ANTARES plutôt l'hémisphère sud. Les prédictions, malgré leurs incertitudes, annoncent toutes que ces détecteurs doivent avoir des tailles gigantesques, de l'ordre du km3. Les neutrinos interagissent dans l'eau, la glace ou la roche au voisinage ou à l'intérieur du détecteur ; ils émettent alors un muon (s'il s'agit d'un nm, ou un électron s'il s'agit d'un ne) qui va parcourir plusieurs dizaines ou centaines de mètres à une énergie de plusieurs TeV (1015 eV). Ce muon garde la mémoire de la direction du neutrino incident à ces énergies élevées. Il émet du rayonnement Tcherenkov (cf. SuperKamiokande) observé par des centaines de photomultiplicateurs déployés sur des lignes verticales au fond de la mer ou de la glace.
AMANDA a montré que son détecteur fonctionnait bien, malgré les difficultés de l'implantation au pôle sud ; les physiciens déploient aujourd'hui ICECUBE, au rythme des courts étés antarctiques. ANTARES, une douzaine de lignes de photomultiplicateurs en cours d'installation au large de Toulon, servira de prototype pour un grand projet européen de détecteur kilométrique au fond de la Méditerranée. Au-delà de ces détecteurs pionniers, qui nous réserveront certainement des surprises, comme toujours avec les neutrinos, les physiciens imaginent d'utiliser la radio ou les ondes sonores pour détecter les neutrinos les plus énergiques venus des tréfonds de l'Univers.
7. Les neutrinos du big bang
Nous nous sommes éloignés de notre planète en observant « notre étoile », le Soleil, nous avons franchi les frontières de la galaxie, nous avons remonté l'espace (et le temps) dans le monde extragalactique et les neutrinos sont toujours là. Poursuivons notre voyage vers les origines, le fameux big bang. Les neutrinos y jouent-ils un rôle ?
L'histoire thermique de l'Univers présent commence il y a environ 13 milliards d'années par ce qu'on appelle aujourd'hui le big bang. Son origine reste aujourd'hui encore très spéculative car les lois de la physique ne s'appliquent plus vraiment dans les conditions de température et de densité extrêmes de la singularité initiale. Il y a probablement eu très tôt (vers 10-43 s) une période d'inflation (brusque augmentation de l'espace en quelques 10-40 s), suivie d'une période continue de refroidissement et d'expansion.
Lorsque le temps s'écoule, le fluide cosmique (appelé encore la soupe primordiale) se refroidit en raison de l'expansion et la température diminue très rapidement. Les forces qui régissent le comportement de la matière vont se singulariser l'une après l'autre, en commençant par l'interaction gravitationnelle, bientôt suivie par l'interaction forte. La soupe contient alors des quarks et des leptons. Il y a en particulier des électrons, des photons, et les trois espèces de neutrinos, qui s'annihilent joyeusement avec leurs antiparticules, en se transformant les uns dans les autres. Bien vite cependant l'interaction faible devient beaucoup plus faible que l'interaction électromagnétique et les neutrinos s'annihilent beaucoup moins souvent. Il y a aussi dans la soupe quelques quarks qui vont commencer à former les premiers protons et les premiers neutrons. Lorsque l'Univers continue de refroidir, les neutrinos deviennent si dilués qu'ils ne peuvent plus s'annihiler. Il ne s'est passé qu'une seconde depuis l'explosion primordiale (ou ce qu'on qualifie comme tel), la température est de 10 milliards de degrés et nous voilà en présence des premiers fossiles connus de l'Univers, condamnés à errer à jamais dans l'espace : les neutrinos du big bang. L'histoire continue et le refroidissement se poursuit inexorablement. Le découplage des photons correspond au moment où les électrons se combinent aux premiers noyaux (principalement au plus simple d'entre eux, le proton) pour former les atomes, électriquement neutres. L'Univers est alors âgé de 1 million d'années et la température est de 3000 K. Les photons fossiles vont continuer de se refroidir jusqu'à atteindre la valeur de 3K, température à laquelle ils ont été découverts par Penzias et Wilson en 1965. Les neutrinos eux se sont refroidis un peu plus ; leur température est de 2K, correspondant à une énergie de l'ordre du milli-électron-volt (meV).
Des quantités fabuleuses de neutrinos ont été produites, puisqu'on estime aujourd'hui leur nombre à 300 par cm3 dans tout l'Univers, toutes espèces confondues. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à les observer et leur détection est extrêmement difficile, en particulier en raison de leur énergie ridiculement faible. Une telle quantité de neutrinos ne peut laisser indifférent. Ils pourraient être une contribution importante de la matière noire de l'Univers. Las ! Leur masse est trop faible (voir chapitre suivant) pour qu'ils puissent jouer un rôle important à cet égard. On estime aujourd'hui leur contribution quelques pour mille de la densité critique[2], ce qui est malgré tout autant que la masse visible de toutes les étoiles et galaxies. Mais leur rôle en cosmologie n'est pas limité pour autant. Ils interviennent tout d'abord dans la formation des structures de l'Univers, galaxies et amas de galaxies. L'effet est le suivant : tant que les neutrinos sont relativistes (et cette notion dépend de leur masse), ils voyagent librement des régions denses vers les régions moins denses et vont donc contribuer plus ou moins rapidement à la densité locale, définissant des échelles de structures plus ou moins grandes. L'analyse de ce qu'on appelle les grandes structures, avec des sondages profonds de l'Univers, permet aujourd'hui de contraindre la masse des neutrinos à moins de 0,5 eV, mieux que les mesures directes. Ensuite, les neutrinos, en particulier les ne sont indispensables à la nucléosynthèse primordiale ; ils sont nécessaires pour transformer les neutrons en protons et vice-versa à l'aide de plusieurs réactions : ne n « p e- ; p « n e+ ; n ® p e- . Sans ces réactions, nous resterions paralysés par le nombre de protons et de neutrons présents à l'origine, et nous n'aurions pas eu ce formidable réservoir d'hydrogène qui est la source d'énergie de départ de toutes les étoiles qui veulent vivre longtemps. La mesure de l'hélium primordial dans l'Univers a ainsi permis de contraindre le nombre de familles de neutrinos à une valeur de 3, la même que les expériences auprès du LEP.
8. En guise de conclusion.
Les neutrinos sont au cSur d'un processus dialectique fécond entre la physique des particules, l'astrophysique et la cosmologie, entre la théorie et l'expérience. Les progrès considérables de ces dernières années dans notre compréhension des neutrinos sont dûs principalement à l'observation de phénomènes astrophysiques où ils jouent un rôle-clé ; en retour, ils ont solutionné quelques vieilles énigmes. Quel bilan peut-on tirer ? Que nous réserve l'avenir ?
L'analyse simultanée des résultats des expériences de neutrinos solaires et de neutrinos atmosphériques (complétée avec les expériences auprès des réacteurs nucléaires comme Chooz ou KamLAND) donne accès aux paramètres de l'oscillation entre les trois espèces de neutrinos. Concernant la masse, les deux paramètres sont des différences de masses au carré Dm2, et pas la valeur absolue, et on obtient 2,3 10-3 eV2 et 8 10-5 eV2. On peut illustrer la petitesse des masses de neutrino correspondantes à l'aide de quelques hypothèses, et notamment celle d'une hiérarchie des masses de neutrinos analogue à celle des leptons chargés. On estime alors la masse du neutrino le plus lourd, le nt, à 0,05 eV, soit 10 millions de fois plus petite que celle de l'électron ; celle du nm à 0,008 eV, celle du ne encore moins. Cette même analyse nous informe également sur les angles de mélange. Elle dit : a) l'oscillation à la fréquence déterminée par les neutrinos atmosphériques (fonction de leur énergie et la longueur parcourue) est maximale et le nm se transforme intégralement en nt ; l'oscillation à la fréquence déterminée par les neutrinos solaires est grande mais pas maximale et le ne se transforme assez souvent en nm ou nt ; c) le troisième angle de mélange est encore inconnu et l'expérience auprès du réacteur de Chooz a permis de mettre une limite supérieure. Une nouvelle collaboration internationale, Double Chooz, se met en place pour traquer ce dernier paramètre, simultanément avec des expériences auprès des accélérateurs.
Il est une propriété des neutrinos dont nous n'avons pas parlé. Le neutrino pourrait être sa propre antiparticule ? Pour étudier cette possibilité, passionnante sur le plan théorique, des expériences dites de « double désintégration b sans émission de neutrinos » se construisent à travers le monde. Une belle expérience, NEMO3, fonctionne actuellement dans le laboratoire souterrain de Modane à la recherche de ces trop rares événements. En cas de découverte, le résultat donnerait simultanément une information précieuse sur la masse des ne.
En résumé, nous pouvons dire que les neutrinos sont des messagers incontournables de phénomènes fondamentaux dans l'Univers. Au-delà de sa masse, qu'avons-nous appris ? Tout d'abord le Soleil fonctionne comme prévu, sa source d'énergie étant la réaction nucléaire de fusion entre deux protons. Ensuite la mort des étoiles massives en supernova émet des quantités phénoménales de neutrinos, et ils sont probablement acteurs de l'explosion. Les neutrinos sont les plus vieux fossiles de l'Univers, mais contribuent marginalement à la matière noire. L'astronomie neutrino à haute énergie, prometteuse, en est encore à ses balbutiements.
Les neutrinos nous ont gâtés ces dernières années. Ils nous réservent encore bien des surprises. Il suffit d'être curieux et ... patient.
[1] Les physiciens expriment l'énergie en électronvolts (eV), un électronvolt valant 1,6 10-19 joule. La masse est exprimée en eV/c2 et souvent par simplification en eV lorsque l'on prend la convention c=1. Une masse de 1 eV correspond à environ 10-33 g.
[2] La densité de l'Univers s'exprime en fonction de la densité critique. Si la densité est inférieure, l'Univers est ouvert ; si elle est supérieure, il est fermé et son volume est fini. Les mesures des paramètres cosmologiques laissent à penser aujourd'hui que la densité de l'Univers est exactement égale à la densité critique.
VIDEO canal U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Des machines enfin intelligentes ? |
|
|
| |
|
| |
Des machines enfin intelligentes ?
26.12.2017, par Yaroslav Pigenet
Beaucoup y voient la promesse d’une nouvelle révolution industrielle qui bouleversera notre rapport au travail et à la connaissance, d’autres les prémisses d’une intelligence «super-humaine». Depuis une dizaine d’années, l’intelligence artificielle connaît une renaissance : quelles en sont les raisons, les acteurs et les limites ? Cet article publié dans le dernier numéro de «Carnets de science» nous donne quelques éléments de réponse.
En moins d’une décennie, les ordinateurs, qui s’étaient jusque-là contentés de se substituer à nos matériels de bureau, dispositifs de communication, outils graphiques, lecteurs/éditeurs de médias et appareils de loisirs, se sont mis à disputer au cerveau humain la capacité de battre des champions de poker, traduire correctement des textes, reconnaître des visages, conduire des voitures, tenir une conversation (presque) sensée, voire anticiper nos désirs. Des progrès réels et fulgurants qui pourraient annoncer l’âge d’or maintes fois reporté de l’intelligence artificielle (IA), une discipline dont les déceptions semblaient à la mesure des espoirs suscités. Les Gafam, dont la valorisation est intimement liée à ces progrès, investissent aujourd’hui massivement dans les laboratoires d’intelligence artificielle. Ils nous promettent pour bientôt des machines non seulement capables de trier, d’analyser et d’interpréter, mieux que nous le pouvons, les masses de données que nous produisons en continu, mais aussi de nous aider à prendre nos décisions quand il s’agit de choisir un partenaire ou une musique, voire d’agir pour nous comme robots ou véhicules autonomes.
Mais d’où vient au juste cette brusque, soudaine et parfois inquiétante bouffée d’intelligence des machines ? « Les problématiques pratiques de l’IA actuelle sont les mêmes que celles définies il y a soixante ans : il s’agit de simuler, d’articuler des tâches d’apprentissage, de perception/classification, de raisonnement, de décision et finalement d’action, tempère Sébastien Konieczny, chercheur au Centre de recherche en informatique de Lens.1 C’est essentiellement à l’essor récent des méthodes d’apprentissage et de classification associées au deep learning que l’on doit la plupart des résultats actuels. Il y a eu une rupture technique, dont les résultats sont incontestables et spectaculaires. Mais les algorithmes sur lesquels ces progrès s’appuient – modélisation statistique, réseaux de neurones, apprentissage automatique, etc. – sont développés depuis une trentaine d’années. »
L’IA : des objectifs vieux de soixante ans
En effet, dès août 1955, à l’initiative de John McCarthy, un professeur de mathématiques spécialiste des machines de Turing, Claude Shannon, inventeur de la théorie de l’information, Marvin Minsky, futur cofondateur du laboratoire d’Intelligence artificielle du Massachussetts Institute of Technology (MIT), et Nathaniel Rochester, créateur de l’IBM 701 – le premier ordinateur commercial généraliste –, utilisaient pour la première fois les termes « intelligence artificielle » dans un appel à la communauté scientifique. Les principaux objectifs pratiques de l’IA étaient posés : robots autonomes, compréhension et traduction de l’écrit et de la parole, vision artificielle, aide à la décision et résolution de problèmes mathématiques.
Notre but est que des machines réalisent mieux que nous des tâches autrefois considérées comme intelligentes.
Dans les premiers temps, partant du constat que l’ordinateur est avant tout un système de manipulation de symboles, les chercheurs tentent de modéliser et d’émuler l’intelligence à partir des notions de symbole et de représentation interne du monde. Mobilisant les progrès de la logique mathématique et de la linguistique, cette approche symbolique reste dominante dans l’intelligence artificielle jusqu’aux années 2000.
Elle aboutit notamment à la mise au point des premiers systèmes experts de diagnostic médical, des premiers joueurs électroniques – la victoire de Deep Blue sur le champion du monde d’échecs Gary Kasparov en est l’apothéose – ainsi qu’à quelques tentatives peu convaincantes de traitement automatique du langage naturel.
Des méthodes symboliques aux méthodes numériques
L’un des gros inconvénients des approches symboliques est qu’elles gèrent très mal les données bruitées : il ne faut pas d’erreur dans les données qu’on présente au système. En fait, ce problème de l’apprentissage a été abordé et en partie résolu par un autre courant de recherche de l’IA baptisé connexionnisme. Celui-ci prend pour modèle le cerveau biologique et tente de reproduire certaines de ses facultés, notamment visuelles, en simulant numériquement le comportement de réseaux de neurones formels ; en s’inspirant également de la structure en couches hiérarchiques des neurones du cortex visuel humain, ce qui aboutira aux algorithmes de deep learning. Dès les années 1970, on savait comment entraîner un réseau de neurones à reconnaître les objets d’une image grâce l’algorithme de rétro-propagation d’erreur : une méthode numérique qui permettait d’améliorer le taux de bonnes reconnaissances du système en ajustant, à chaque erreur de classification, le poids des connexions entre chaque neurone du réseau.
Yann LeCun, aujourd’hui directeur du laboratoire d’intelligence artificielle de Facebook, l’avait démontré en développant dès 1989 un dispositif de reconnaissance des codes postaux manuscrits basé sur le deep learning : pour peu que l’on dispose d’un échantillon d’exemples suffisamment important à présenter à un réseau de neurones, celui-ci finit par égaler la performance d’un être humain, du moins en théorie…2
Le problème posé par ces dispositifs est qu’une fois entraînés, ils fonctionnent comme une boîte noire.
« On savait depuis les années 1980 que ces méthodes fonctionnaient, seulement elles réclamaient une puissance de calcul et une quantité de données considérables, qui sont restées longtemps hors de notre portée. Tout a changé au milieu des années 2000 : avec l’augmentation de la capacité des processeurs, il est devenu possible d’effectuer dans un temps raisonnable les calculs nécessités par les algorithmes de
deep learning, explique Jérôme Lang, directeur de recherche au Laboratoire d’analyse et modélisation des systèmes pour l’aide à la décision3 et médaille d’argent 2017 du CNRS. L’autre changement majeur, c’est Internet et l’accroissement exponentiel de la masse de données qu’il a rendue disponible. Par exemple, pour entraîner un système de reconnaissance visuelle, il faut lui présenter le plus grand nombre possible de photos annotées : tandis qu’il fallait se démener pour constituer des échantillons de quelques centaines de clichés indexés par des étudiants, on peut aujourd’hui assez facilement accéder à des centaines de millions de photographies annotées par les internautes via les captcha. »
L’irrationnelle efficacité des données
Les résultats les plus spectaculaires de l’intelligence artificielle, ceux qu’aucun spécialiste n’osait espérer au début des années 2000, ont été obtenus dans les domaines de la reconnaissance visuelle – de la reconnaissance de visage à l’analyse de scènes –, de la reconnaissance vocale ou musicale, et dans celui du traitement automatique des langues – de la traduction à l’extraction automatique de sens. Or le point commun de ces systèmes, c’est que leur « intelligence », ou du moins leur performance, croît avec la taille du corpus à partir duquel ils ont été entraînés. Le problème posé par ces dispositifs est qu’une fois entraînés, ils fonctionnent comme une boîte noire : ils donnent de bons résultats mais, contrairement à ce que permettent les systèmes symboliques, ne donnent aucune indication sur le « raisonnement » qu’ils ont suivi pour y arriver. Un phénomène que trois chercheurs employés par Google ont appelé dès 2009 « l’irrationnelle efficacité des données ».
Les algorithmes sur lesquels les progrès récents s’appuient sont développés depuis une trentaine d’années.
Cela explique l’avantage décisif qu’ont pris les Gafam dans ces domaines, ainsi que la frénésie qu’ont ces derniers à nous soutirer des données contre des promesses d’intelligence. Certains gourous technologiques extrapolent même l’émergence imminente d’une conscience artificielle, d’une intelligence superhumaine faite de machines qui inventeront et créeront d’elles-mêmes, pour nous… et éventuellement contre nous.
« Ces “prédictions” sont faites par des personnes éloignées de la recherche ou qui ont quelque chose à vendre, souligne Sébastien Konieczny. Les chercheurs en IA n’ont jamais prétendu recréer l’intelligence – dont il faudrait déjà qu’on donne une définition opérationnelle –, notre but est que des machines réalisent mieux que nous des tâches considérées comme intelligentes car nous seuls étions jusqu’alors capables de les réaliser, comme le classement de milliers de photos ou de morceaux de musique. Les seules choses que l’on maîtrise aujourd’hui, ce sont des tâches goal oriented ; une machine qui soit capable de définir ses buts, ça on ne sait pas faire. Alors la conscience… »
Notes
* 1.
Unité CNRS/Université d’Artois.
* 2.
Y. LeCun et al., « Backpropagation applied to handwritten zip code recognition », Neural Computation, 1989, 1(4):541-551.
* 3.
Unité CNRS/Université Paris-Dauphine.
DOCUMENT cnrs LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|