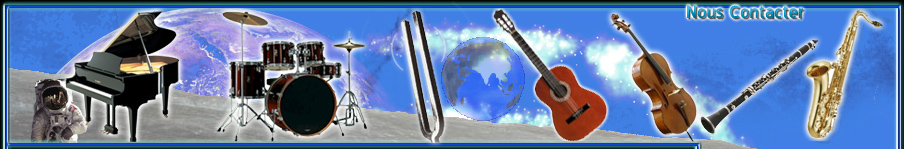|
|
|
|
 |
|
Edmund Husserl |
|
|
| |
|
| |

Edmund Husserl
Philosophe et logicien allemand (Prossnitz, aujourd'hui Prostějov, Moravie, 1859-Fribourg-en-Brisgau 1938).
Dans la lignée de Descartes, Edmund Husserl chercha à établir les conditions d’une connaissance rigoureuse. Il fut à l’origine de la phénoménologie, dont le but était de fonder la possibilité de l’objectivité scientifique. Selon lui, il n’était pas légitime de faire comme si la science de la nature était indépendante de la vie de l’esprit.
Un « fonctionnaire de l'humanité »
Fidèle à la définition qu'il donne du philosophe dans la Crise des sciences européennes, Husserl a su identifier la majeure partie de son existence aux principales étapes de sa recherche. Après des études d'astronomie, de physique et de mathématiques à Leipzig, il présente à Vienne sa thèse de doctorat Sur le calcul des variations (Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung, 1883) et devient privatdocent à l'université de Halle. En 1891 paraît le premier volume de la série inachevée Philosophie de l'arithmétique (Philosophie der Arithmetik). Le même esprit qui préside aux Recherches logiques (Logische Untersuchungen, 1900-1901) prend un tour plus définitivement husserlien dans les leçons sur la Phénoménologie de la conscience interne du temps (Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, publié en 1928) et dans le cours professé à Göttingen sur « l'Idée de la phénoménologie », que préciseront, en 1913, les Idées directrices pour une phénoménologie (Ideen zu einer reinen Phänomenologie). Nommé professeur à Fribourg-en-Brisgau (1916), il prend sa retraite en 1928. Ses conférences en Sorbonne (1929) formeront la matière des Méditations cartésiennes (Cartesianische Meditationen). En dépit de l'hostilité que lui manifeste le nazisme, Husserl tente une sorte de synthèse de sa pensée dans la Crise des sciences européennes (Die Krisis der europäischen Wissenschaften, 1936). Après sa mort, ses textes et manuscrits, recueillis par le R. P. H. L. Van Breda, seront réunis à l'université de Louvain, où ils constituent les « Archives Husserl ».
Connaissance de la vérité et vérité de la connaissance
Mathématicien avant de devenir philosophe, Husserl se propose de transformer la philosophie en science exacte et de dévoiler les fondements essentiels de toute réalité. Sa recherche passe par trois périodes successives, aussi distinctes qu'inséparables. S'interrogeant d'abord sur l'analyse mathématique, il en vient à reconnaître le primat de la logique sur l'ensemble des sciences, de même que sur les méthodes de la psychologie. Il constate ensuite que la logique pure est initialement phénoménologie, c'est-à-dire qu'elle se pose comme description des actes de la conscience, comme démarche pour saisir les significations et comme procédé pour accéder à la vision des essences. Enfin, il tente de traiter en termes d'historicité de la conscience les problèmes du monde des êtres et des choses, de la culture.
L'itinéraire de Husserl part donc de la crise des sciences et y aboutit de nouveau, mais en montrant qu'il s'agit là d'une crise de la conscience. La phénoménologie apparaît dès lors comme une méthode, dans le meilleur style cartésien, pour fonder sur des certitudes la réalité du monde et la réalité de l'homme dans le monde. Au niveau le plus simple, elle se veut l'étude des phénomènes, de ce qui surgit à la conscience, de ce qui est donné. Elle s'identifiera, en fin de compte, à la manière dont la conscience vit le monde et exprime cette vie.
L'intentionnalité
Où prend appui la connaissance scientifique ? Pour l'empiriste, la démarche logique s'explique par l'analyse psychologique du sujet qui raisonne. Or, constate Husserl, le sujet reste soumis à la contrainte des connexions et des enchaînements objectifs : les propriétés des nombres sont les mêmes pour un homme du xxe s. et pour un Grec de l'Antiquité.
Faut-il, en suivant Kant, distinguer le monde de l'expérience ou des phénomènes, seul connaissable, et celui de la « chose en soi », inaccessible ? Ce serait consacrer la rupture entre le sujet et le monde, entre la conscience qui perçoit et l'objet perçu. Au contraire, la notion de visée intentionnelle abolit une telle séparation.
Chez Husserl, l'intentionnalité est le mouvement où se résout la contradiction entre l'être et la conscience : elle scelle le pacte de la conscience et du monde. Il n'y a donc pas de monde qui ne soit pour une conscience et pas de conscience qui ne se détermine comme une façon d'appréhender le monde. Au noème (connaissance comme résultat) correspond une certaine noèse (acte de connaissance). Le phénomène est donc l'apparaître de la réalité, ce qui se donne au sujet ; sa connaissance ne consiste pas à le rejoindre mais à le dévoiler, à obtenir qu'il se donne directement tel qu'il est : unité de l'acte de conscience et de l'objet, unité réalisée par la visée intentionnelle.
Mais les actes de conscience ne visent pas leurs objets de la même manière et, simultanément, les objets ne se donnent pas de façon identique. C'est à la phénoménologie qu'il appartient de dégager les distinctions et la certitude logique en permettant la description du vécu, des actes de conscience et des essences qu'ils visent.
La réduction ou mise entre parenthèses
La perception ne nous livre le réel que par esquisses et profils successifs. Un objet reste soumis au déroulement indéfini des profils sans jamais permettre une exploration exhaustive ; l'essence de ce perçu est d'être inépuisable. Et pourtant, la perception a ceci de paradoxal qu'elle nous donne l'absolu d'un apparaître qui se développe sans cesse dans une synthèse toujours plus grande et toujours inachevée.
Mais, si la chose émerge ainsi à travers des retouches sans fin, au contraire le vécu est donné à lui-même dans une perception immanente ; la conscience de soi donne le vécu comme un absolu. Une analyse précise implique que soient pleinement dissociés le monde comme totalité de choses, d'une part, la conscience et le vécu, d'autre part. Cette opération qui, mettant le monde entre parenthèses, dégage le phénomène d'existence dans sa pureté, Husserl l'appelle la réduction, ou « épokhê ».
Au premier stade, la réduction phénoménologique distingue donc le monde et un sujet non mondain ; une analyse plus poussée conclut ensuite à la contingence de la chose (le modèle du mondain) et à la nécessité du moi pur, résidu de la réduction. C'est ce que Husserl exprime, dans les Idées directrices, par : « Toute chose donnée » en personne « peut aussi ne pas être, aucun vécu donné » en personne « ne peut pas ne pas être ».
Le moi pur n'a donc pas besoin du monde pour être. Grâce à la réduction, à la mise hors d'action du monde, le concret de la vie subjective se révèle dans son authenticité, la conscience réussit à être consciente d'elle-même. Autrement dit, le moi qui est dans le monde se double, par l'acte phénoménologique, d'un moi spectateur désintéressé. En somme, réduire, c'est transformer tout donné en phénomène et révéler du même coup les caractères essentiels (eidétiques) de l'ego : fondement radical, source de toute signification, lieu d'intentionnalité avec l'objet.
Ego radical et intersubjectivité
Puisque tout sens est fondé dans la conscience individuelle donatrice de sens, la démarche du philosophe ne va-t-elle pas aboutir fatalement au solipsisme ? Husserl tourne aisément l'objection. Pour lui, « autrui soi-même m'est donné dans une expérience absolument originale. L'altérité de l'autre est un moi pur, il est une existence absolue et un point de départ pour lui-même comme je le suis moi-même ».
Ainsi, l'analyse intentionnelle d'autrui fait passer la radicalité du moi dans l'intersubjectivité, c'est-à-dire dans l'histoire. Par ce biais, Husserl a beau jeu d'aborder la crise des sciences. Ce qui est en cause, ce ne sont plus les sciences en particulier, c'est l'objectivisme qui a prétendu les fonder. Leur crise se situe dans leur absence de signification pour la vie elle-même. Seul l'ego fondamental, donateur de sens, vivant d'une vie préobjective et immédiate, peut réconcilier, dans un rapport de vérité toujours précisé, le savoir abstrait et le vécu.
La vérité ne peut se définir que comme expérience vécue de la vérité, comme l'évidence que consacre le moment où la chose dont on parle se donne « en personne » à la conscience. Et Husserl précise : « Même une évidence qui se donne comme apodictique peut se dévoiler comme illusion, ce qui présuppose néanmoins une évidence du même genre, dans laquelle elle“ éclate ”. »
Ainsi, la vérité se corrige toujours dans une expérience actuelle, et si tel vécu se donne maintenant à moi comme une évidence passée et fausse, cette actualité même constitue un nouveau moment qui exprime dans le vécu à la fois l'erreur passée et la vérité présente qui la corrige.
La vérité selon Husserl n'est pas un objet mais un mouvement, et un mouvement qui n'existe que s'il est effectivement fait par moi. Seule l'analyse intentionnelle, revenant au monde au sein duquel le sujet reçoit les choses comme synthèses passives antérieures à tout savoir, dévoile le fondement radical de toute vérité.
De sorte que, après avoir écarté le monde par la réduction pour rendre à l'ego son authenticité de donateur de sens, Husserl le retrouve comme la réalité même du constituant. Bien entendu, il ne s'agit plus du monde où l'homme s'abandonne comme existant, objective naïvement la signification des objets et s'aliène, mais bien du monde primordial, matière initiale des expériences vécues sur lesquelles s'élève la vérité théorique.
D'une recherche sur les bases de la logique, le philosophe en vient à fonder toute rationalité et toute vérité sur le vécu immédiat d'une évidence par laquelle l'homme et le monde se trouvent originairement d'accord.
Sur l'anté-rationnel du subjectif, dont certains disciples et en particulier Heidegger vont faire abusivement un anti-rationnel, Husserl élabore une nouvelle objectivité. Son rationalisme « totalisant », qui tire du vécu le principe d'intelligibilité du monde, comme Descartes le tirait de Dieu, a quelque chance d'apparaître aujourd'hui, dans la crise de la culture, comme le dernier état de la bonne conscience philosophique. S'il est vrai que la catégorie existentielle, en sauvant ici la mise de l'abstraction pure, écarte à la fois la séduction du mysticisme et la dichotomie entre être et conscience, elle n'en reste pas moins étrangère à l'histoire concrète, telle que « les hommes la font dans certaines conditions ».
Quelques mots clés de la philosophie husserlienne
eidétique
Qui concerne l'essence.
intentionnalité
« Le mot intentionnalité ne signifie rien d'autre que cette particularité foncière qu'a la conscience d'être la conscience de quelque chose » (Husserl). Caractère propre à la pensée de tendre vers un objet de pensée.
intuition
Faculté qui permet de saisir directement les essences intemporelles. « Toute intuition qui nous donne son objet de façon immédiate et originelle est source de connaissance légitime » (Husserl).
noème (du grec noêma, objet pensé)
Objet intentionnel avec son sens, son caractère de réalité, ses modes d'apparaître, etc.
noèse (du grec noêsis, pensée)
Acte même de la connaissance, tourné vers l'objet.
phénoménologie
Méthode philosophique qui vise à saisir, par-delà les êtres empiriques et individuels, les essences absolues de tout ce qui est. C'est « la science descriptive des essences de la conscience et de ses actes » (Husserl).
réduction eidétique
Acte qui consiste à éliminer les éléments empiriques du donné pour n'en retenir que la pure essence.
réduction phénoménologique
Acte qui consiste à mettre entre parenthèses les existences empiriques.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
HUMANISME |
|
|
| |
|
| |
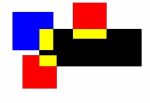
HUMANISME
PLAN
* HUMANISME
* HISTOIRE ET LITTÉRATURE
* 1. Un terme à la multiple et féconde ambiguïté
* 1.1. Le Moyen Âge
* 1.2. Le xvie siècle
* 1.3. xviie-xixe siècles
* 1.4. Tentative de définition
* 2. Histoire de l'humanisme français aux xve et xvie siècles
* 2.1. L'humanisme français héritier de l'humanisme italien ?
* 2.2. L'humanisme spiritualiste (1470-1547)
* Une passion pour les Anciens
* Le « divin Platon »
* Vogue du platonisme et triomphe de l'humanisme en français
* Rabelais
* Marguerite d'Angoulême (ou de Navarre)
* 2.3. L'humanisme esthétique (1547-1560)
* Une soif d'érudition
* La Pléiade
* 2.4. L'humanisme éthique et politique (fin du xvie siècle)
* Humanisme éthique
* Plutarque
* Humanisme politique
* Montaigne
* 3. Ailleurs en Europe
* 4. L'humanisme à l'œuvre
* 4.1. Humanisme et science
* 4.2. Humanisme et religion
* 4.3. Humanisme et vie civile
* Les « institutions du prince »
* Exhortation à la vie civile
* Incitation à la fierté nationale
* Néoplatonisme, éducation, amour et mariage
* Vie en société
* 5. xixe-xxe siècles : quelles formes
humanisme
Cet article fait partie du dossier consacré à la Renaissance.
Mouvement intellectuel qui s'épanouit surtout dans l'Europe du xvie siècle et qui tire ses méthodes et sa philosophie de l'étude des textes antiques.
HISTOIRE ET LITTÉRATURE
1. Un terme à la multiple et féconde ambiguïté
Le terme d'humanisme est l'un de ceux sur le sens desquels personne ou à peu près ne s'entend vraiment. C'est que le mot se trouve lié à l'évolution de la pensée occidentale, tout au long de plusieurs siècles de culture et d'histoire, comme en témoignent les emplois successifs des termes humanitas, humances, humain, humanité, humanisme, tous inséparablement liés.
En latin déjà, humanitas désigne ce qui distingue l'homme de toutes les autres créatures, ce qui, donc, est précisément le propre de l'homme, la culture.
1.1. Le Moyen Âge
Au Moyen Âge, on appelle humaniores litterae les connaissances profanes, telles qu'elles sont apprises dans les facultés des arts (notre actuel enseignement du second degré), qui ouvrent elles-mêmes accès aux facultés – de rang élevé – où l'on enseigne le droit ou la médecine. Elles se distinguent ainsi des diviniores litterae (lettres divines) : commentaires de la Bible, science de la religion chrétienne qui relèvent des éminentes facultés de théologie.
1.2. Le xvie siècle
Cette expression de lettres humaines se trouve encore employée au xvie siècle (Rabelais, Amyot) pour marquer la différence – qui n'implique pas opposition – entre la culture sacrée et un enseignement non religieux, dans lequel les littératures antiques sont venues s'ajouter à l'essentiel des disciplines scolastiques du curriculum médiéval.
Ce retour aux textes classiques, enseignés comme un complément nécessaire aux études de théologie qui, alors, sont les seules à compter vraiment, les écrivains du temps le nomment instauratio, restauratio, restitutio bonarum litterarum (établissement, rétablissement, remise en honneur des bonnes lettres). Certains, usant d'un style plus liturgique et plus imagé, parlent de reflorescentia (nouvelle floraison), renascentia (renaissance).
D'autres reprennent au latin le mot humanitas, que Rabelais traduit, en 1532, pour faire éclater dans le Pantagruel la fameuse formule lettres d'humanité, par laquelle il célèbre les littératures grecque et latine, envisagées comme un instrument d'éducation morale, à la fois philologie et philosophie, docte érudition et sagesse prudente. Aux érudits, nourris de ces lettres d'humanité, s'appliquera bientôt le nom d'humaniste (peu employé, il est vrai, en France au xvie siècle). Par leur culture littéraire et encyclopédique, ils se différencient des spécialistes étroits, ceux des questions juridiques, par exemple, et des théologiens, préoccupés des seules questions de la foi.
1.3. xviie-xixe siècles
Dès la fin du xviie siècle, avec l'organisation des collèges, on appelle humanités les classes qui font suite à celles de grammaire et dans lesquelles on enseigne les lettres antiques.
Humanisme, lui, se trouve essayé dans notre langue en 1765, au sens d'« amour général de l'humanité », signification qu'il a perdue au profit d'humanitarisme, apparu en 1837.
En fait, dans son sens historique et le plus précis, le mot humanisme désigne, depuis le dernier quart du xixe siècle, le courant littéraire et intellectuel qui, associé au réveil des langues et des littératures anciennes, porta, au xve et au xvie siècle, les érudits d'Europe à une connaissance passionnée, exacte et aussi complète que possible des textes authentiques et de la civilisation de l'Antiquité classique.
Dans une acception plus large, qui porte la marque du philosophe allemand du xixe siècle Hegel, humanisme s'entend de tout effort de l'esprit humain, qui, affirmant sa foi dans l'éminente dignité de l'homme, dans son incomparable valeur et dans l'étendue de ses capacités, vise à assurer la pleine réalisation de la personnalité humaine. Un tel effort peut, sans faire appel à aucune lumière, à aucune force surnaturelle, s'appuyer sur les seules ressources de l'homme. Il peut aussi postuler le secours de la grâce, d'une grâce qui ne détruit pas la nature, mais qui la restaure.
À la suite d'Érasme et de saint François de Sales (1567-1622) se développe un humanisme chrétien qui transcende et transfigure l'humanisme immanentiste en assignant un destin surnaturel à l'homme, corrompu, certes, mais racheté et appelé à collaborer, dans l'exercice même de ses devoirs d'homme, à l'œuvre de son salut.
Inséparable désormais d'un contexte historique, philosophique ou religieux, le mot humanisme, volontiers lié aujourd'hui à l'idée d'une civilisation aristocratique fondée et maintenue par les privilèges de l'intelligence, souvent associé aussi à la notion de culture de classe, prend presque toujours un sens polémique qui ajoute encore à sa multiple et féconde ambiguïté.
1.4. Tentative de définition
Par-delà ces querelles, peut-être pourrait-on s'accorder sur un essai de définition où n'apparaîtraient que les caractères essentiels de l'humanisme.
Dans cet esprit serait véritable humanisme toute philosophie de la vie humaine qui, prenant l'homme et ce qui le concerne comme le centre, la mesure et la fin supérieure de toutes choses, s'applique avec ferveur à connaître et à expliquer toujours plus largement la nature humaine dans ce qu'elle a d'universel et de permanent, à favoriser, dans un souci perpétuel de renouveau fondé sur la tradition, son plus harmonieux épanouissement, à défendre, enfin, au besoin, toutes les valeurs humaines là où elles peuvent se trouver, de quelque manière, menacées.
2. Histoire de l'humanisme français aux xve et xvie siècles
2.1. L'humanisme français héritier de l'humanisme italien ?
L'humanisme français et sa phase de plein achèvement, généralement appelée Renaissance, sont souvent présentés comme l'héritage direct de l'humanisme italien, qui, reprenant, prolongeant et amplifiant l'effort initiateur de Pétrarque (1304-1374), s'était développé au xve siècle, aussi bien dans les universités et les académies qu'auprès de papes comme Nicolas V et Pie II ou dans les cours princières de la péninsule, à Florence tout spécialement.
Il se dit volontiers que cette renaissance des lettres antiques, qu'avaient favorisée, en Italie, l'éveil du sentiment national, le culte fidèle de tout ce qui avait fait la grandeur de Rome, les appuis intelligents d'un brillant mécénat, l'afflux (après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453) de savants grecs chargés de précieux manuscrits, passa les Alpes ultérieurement, en modifiant plus ou moins ses caractères dans chaque pays d'Europe où elle pénétrait.
Pour la France, un tel schéma demande assurément retouche ou, tout au moins, nuance. D'une part, il peut conduire à faire superbement oublier l'humanisme d'Alcuin (vers 735-804) moine conseiller de Charlemagne rédacteur de nombreux traités de rhétorique, théologie, grammaire et dialectique celui de l'école de Chartres au xiie siècle et l'intégration de l'aristotélisme dans la pensée médiévale. Il fait fi, d'autre part, de l'apparition en France d'un humanisme authentique contemporain ou peu s'en faut de celui du quattrocento italien.
Sans doute n'est-il pas question ici de nier ni même de diminuer l'importance de l'humanisme italien, dont l'influence sur l'humanisme européen reste indiscutable : la présence de Pétrarque et de Boccace à la cour pontificale d’Avignon au xive siècle contribue assurément à la diffusion des principes de l’humanisme en France. Et Pétrarque, Boccace, mais aussi Coluccio Salutati (1331-1406) et le Pogge (1380-1459) ont découvert à peu près tout ce que nous connaissons de la littérature latine. À la fin du xve siècle, Jean Pic de La Mirandole (1463-1494) proclamera l'article fondamental du credo humaniste dans son Discours de la dignité de l'homme.
Mais il serait imprudent d'imaginer la Renaissance française sur le modèle de la Renaissance italienne et tout à fait inexact de continuer à parler, sauf peut-être sur le plan esthétique, d'un retard d'un siècle de l'humanisme français par rapport à l'humanisme du xve siècle italien. Aux environs de 1400 se rencontre en effet, à Paris, dont l'université reste un intense foyer de culture, un humanisme qui ne concerne, en vérité, que des milieux assez restreints (Jean de Gerson, théologien et chancelier de l’université, et ses amis du collège de la dite université, dit « collège de Navarre » à raison de sa fondation par testament de Jeanne de Navarre, reine de France) mais qui, au niveau qualitatif, n'est pas indigne d'être comparé à l'humanisme italien de l'époque, avec lequel il n'est d'ailleurs pas sans rapports. C'est le moment où l'on commence à s'intéresser à la langue grecque dans notre pays, où Nicolas de Gonesse traduit (d'après le latin) un opuscule moral de Plutarque, où s'instaure à Paris le culte de Cicéron. Et bientôt, sous l'influence de Gerson, que renforce celle du Pétrarque de la docta pietas, cet humanisme naissant va s'imprégner de spiritualité monastique.
2.2. L'humanisme spiritualiste (1470-1547)
Une passion pour les Anciens
Commence alors, vers 1470, date de l'installation à la Sorbonne de l'atelier d'imprimerie de Guillaume Fichet (1433-vers 1480), une longue période d'humanisme à tendance essentiellement religieuse, d'expression latine d'abord, puis française à partir de 1530 : période des grands espoirs, des combats contre l'enlisante tradition scolastique, des désirs plus ou moins confus d'harmonieuses synthèses. Les humanistes de l'époque sont avant tout des « philologues » passionnés par les langues, les textes littéraires, la civilisation des Anciens, domaines auxquels ils joignent l'étude de l'hébreu, nécessaire pour les « saintes Lettres ». Ainsi Johannes Reuchlin (1455-1522), qui restaure la langue et la littérature hébraïques et, surtout, Guillaume Budé (1467-1540), grand seigneur, avec Érasme, des études grecques et latines en Europe.
Les papes eux-mêmes encouragent toutes sortes de recherches sur les traditions textuelles et religieuses – y compris des audaces que les Églises locales censurent, comme à Cologne, où le tribunal ecclésiastique veut condamner Reuchlin, qui s'est opposé à l'autodafé de livres juifs, alors que le pape emploie des bibliothécaires juifs à la traduction de la kabbale. Mais, en pratiquant les lettres anciennes dans un commerce aussi assidu, ces humanistes se familiarisent avec les philosophies du paganisme.
Le « divin Platon »
Chrétiens qui n'entendent rien abandonner des enseignements de l'Église, les voici séduits par Platon, le « divin Platon », christianisé par l'académie de Florence, remis en honneur par les soins de Marsile Ficin (1433-1499).
Celui-ci rassemble les humanistes, parmi lesquels Bembo, Politien et Pic de La Mirandole, en une académie, avec la protection de Cosme de Médicis, dont le petit-fils Laurent fonde la Bibliothèque médicéenne ; sous leur égide, Marsile Ficin traduit Platon et les platoniciens tardifs. Ficin, par son commentaire du Banquet, par sa Théologie platonicienne, par l'importance de ses travaux sur les néoplatoniciens donne alors, de façon au moins indirecte, un essor immense à toutes les spéculations spiritualistes et mystiques de l'époque.
Pendant plus d'un demi-siècle, c'est à travers Ficin traduit en latin qu'en France les érudits – et pratiquement eux seuls en cette période – eurent accès à l'œuvre multiple de ce Platon dont la philosophie essaie d'« ordonner les choses entre Dieu comme principe et Dieu comme fin », un Platon, il est vrai, plus ou moins déformé par ses commentateurs.
À partir de 1490, le platonisme se répand grâce à des humanistes entreprenants, dont le plus important, en France, est l'évangéliste Jacques Lefèvre d'Etaples (vers 1450-1537), qui étudie l'hébreu dans la grammaire de Reuchlin, publie, outre des ouvrages d'Aristote, des textes de Ficin, puis, en 1530, la sainte Bible en français.
Vogue du platonisme et triomphe de l'humanisme en français
Après 1530 s'ouvre une deuxième phase de la période spiritualiste de l'humanisme, au cours de laquelle Platon continue de s'affirmer le grand maître des âmes éprises d'idéal. Phase triomphante, d'expression désormais française, caractérisée par la plus franche exaltation de l'homme et de sa nature, par l'enthousiasme général né de la découverte émerveillée de l'incomparable qualité humaine. Les savants philologues du début du siècle ont gagné à la cause de l'humanisme un certain nombre de parlementaires, de bourgeois cultivés, avocats ou médecins. Quelques villes de province, Orléans, Bourges, Poitiers, Toulouse, Lyon surtout, s'éveillent à l'humanisme.
Certes, la victoire n'est pas obtenue d'emblée, et les imprimeurs préfèrent encore éditer de la littérature de colportage, des romans adaptés des œuvres médiévales plutôt que de risquer l'impression de textes antiques. Mais la fondation en 1530 du Collège des lecteurs royaux (actuel Collège de France) par François Ier prend valeur de symbole. Témoignage de l'appui accordé à l'élite élargie des humanistes par le roi et par sa sœur Marguerite d'Angoulême (ou de Navarre), l'établissement – qui connut, dès ses débuts, un très vif succès – favorise, en dépit de la Sorbonne, la connaissance exacte des antiquités classiques, qu'assurera bientôt, pour des centaines d'années, l'ouverture, en 1561, du premier collège des Jésuites.
Près de deux siècles plus tôt, le roi Charles V (1364-1380) avait déjà demandé à des érudits de son entourage de traduire les principales œuvres historiques et morales de l'Antiquité. À son exemple, François Ier encourage les traductions en langue vulgaire, qui se multiplient en format commode, aux environs de 1530, et donnent, enfin, à l'humanisme le droit de cité attendu dans les lettres françaises. C'est en français qu'Étienne Dolet (1509-1546) veut illustrer l'honneur de son pays dans son traité sur la Manière de bien traduire d'une langue en autre (1540), dont six rééditions en dix ans attestent l'intérêt qu'on portait à la traduction, promue désormais au rang de genre littéraire. Passent ainsi en français, chez les Latins : César, Cicéron, Juvénal, Perse, Salluste ; chez les Grecs : Appien, Diodore, Épictète, Euripide, Homère, Isocrate, Plutarque, Platon surtout, qu'on interprète toujours d'après le texte latin de Ficin. La littérature des vingt dernières années du règne de François Ier révèle à l'évidence la vogue mondaine de ce platonisme, dont l'influence se retrouve partout.
Rabelais
Ainsi, le platonisme christianisé contribue, pour une large part, à ce mouvement de pensée humaniste qui, dans les quelque quarante premières années du xvie siècle, semblait, avec la consolidation du pouvoir royal, la prospérité économique du pays, l'élargissement de l'horizon intellectuel par la découverte du Nouveau Monde et la redécouverte du monde antique, promettre la réalisation d'un nouvel âge d'or. De cette confiance dans l'homme et dans son avenir, l'humanisme érasmien de Rabelais fournit, sous les inventions bouffonnes du Pantagruel (1532) et du Gargantua (1534), la plus géniale et la plus optimiste des preuves.
Marguerite d'Angoulême (ou de Navarre)
Avec Marguerite d'Angoulême (1492-1549) s'achève cette période religieuse de l'humanisme en France. Pour l'ondoyante Marguerite, le problème est d'insérer l'idéalisme platonicien dans une perspective authentiquement chrétienne, de réaliser la synthèse (devenue de plus en plus difficile par suite du durcissement des positions religieuses face à la Réforme) entre la philosophie antique et l'humanisme biblique. Sans doute Marguerite y parvient-elle en donnant à ce spiritualisme platonicien, qui la séduisait tant, le couronnement d'une mystique chrétienne du salut dans le ravissement.
Mais en fait, vers le milieu du siècle, devant les antagonismes violents où s'opposent Rome et la Réforme, devant les tentations paganisantes de la Renaissance et malgré l'influence persistante du platonisme sur les esprits et sur les âmes, s'assombrit, dans la tristesse des espoirs déçus, le visage d'un humanisme naguère encore éclatant, passionné, vigoureux comme Hercule qui le symbolisait si bien, avide des curiosités les plus diverses, ivre de tous ces pouvoirs merveilleux qu'il trouvait ou retrouvait à l'homme, saisi dans sa continuité à travers la variété des temps et la multiplicité des espaces.
En 1547, au bilan de victoire que croit encore pouvoir dresser l'antiaristotélicien Pierre de La Ramée, dit Ramus (1515-1572), répondent déjà les inquiétudes du Tiers Livre, où Rabelais ne peut plus proposer à la question du libre arbitre et de la volonté que la réponse provisoire d'une espérance prudente.
2.3. L'humanisme esthétique (1547-1560)
Une soif d'érudition
Au moment où, un peu avant 1550, la recherche religieuse qui avait animé l'humanisme de la période précédente se trouve engagée dans une impasse, alors que grandit dans la plupart des esprits la tentation du repli sur soi, du silence, voire de l'abandon, l'humanisme va s'épanouir de façon magnifique.
D'une part, l'érudition s'affirme plus vivante que jamais dans la fidélité à la vocation première de l'humanisme. L'édition d'Anacréon, d'Henri II Estienne (1531-1598), apporte aux Français, en 1554, des trésors inconnus.
À la même époque, Adrien Turnèbe (1512-1565) commente Cicéron, fournit les premières éditions de Philon, traduit Plutarque en latin ; Ramus multiplie les commentaires sur Aristote, Cicéron, Virgile, César, fait imprimer trois livres de mathématiques avant d'éditer bientôt deux grammaires du grec ou du latin, et Denis Lambin (1516-1572), autre lecteur royal, interprète, en ardent défenseur, les dix livres de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote.
La Pléiade
D'autre part, l'humanisme reçoit son expression la plus belle grâce à ce groupe poétique, jeune, audacieux et fécond : « la Pléiade ».
En 1547, quand meurt François Ier, l'humanisme spiritualiste reste marqué de l'empreinte qu'y ont mise ses pionniers : des clercs, des érudits, presque tous des bourgeois. Humanisme d'élévation morale, c'était essentiellement un humanisme en prose, auprès duquel l'humanisme d'un poète, fût-il des meilleurs, comme Clément Marot, ne pouvait guère mériter considération. Mais la même année 1547, les premières œuvres originales de Jacques Peletier du Mans (1517-1582) – qu'accompagnaient une ode de Ronsard et un dizain de Du Bellay, tous deux à leurs débuts – font entendre à plein la voix de la poésie, d'une poésie écrite souvent par des plumes nobles, soucieuses de faire œuvre de beauté et mues par l'impérieux désir de l'aristocratique exercice de la création poétique.
Humanistes, les poètes de la Pléiade, entre autres Ronsard, du Bellay, Jean Antoine de Baïf (1532-1589), Rémi Belleau (1528-1577), communient dans le même culte admiratif de l'Antiquité que les écrivains de la période précédente, mais, chez eux, la réflexion savante et religieuse inspirée par les pensées des Anciens fait place à la sensibilité et à l'imagination fondées sur l'« innutrition », assimilation personnelle des plus exquises vertus artistiques des poètes grecs et latins. Loin de rêver à quelque synthèse intellectuelle, ils proclament le dogme du génie individuel, mettant ainsi un accent nouveau sur l'une des caractéristiques majeures d'un humanisme bien compris : le développement de la personnalité. Leur but, c'est de réaliser en vers, pour leur propre gloire et pour l'illustration de leur pays, cette adaptation française des lettres antiques déjà assurée pour la prose.
À l'Antiquité gréco-latine, les poètes de la Pléiade empruntent d'abord une conception nouvelle de la poésie, tirée de la théorie platonicienne de l'enthousiasme, des ornements de style, des motifs artistiques, et un certain nombre de formes poétiques comme ces odes (horaciennes ou pindariques) par lesquelles s'effectue dans nos lettres la résurrection intégrale de l'art lyrique antique. Puis ils vont chanter le poème de l'homme situé dans cet univers dont leur poésie cosmologique vient précisément de révéler les secrets, de l'homme appréhendé dans son aventure et confronté avec le destin du monde : ainsi, Peletier dans son Uranie (1555), Ronsard à travers ses Hymnes (1555-1556) et, à un moindre degré, du Bellay dans ses Antiquités de Rome (1558).
2.4. L'humanisme éthique et politique (fin du xvie siècle)
La Pléiade n'avait donc, jusqu'en 1560, rien abandonné de la passion pour les œuvres antiques, ni de la curiosité de connaître des humanistes de la génération antérieure. À travers les œuvres de Ficin, les poètes avaient découvert les richesses de Platon, à qui ils avaient dû, jusqu'alors, outre l'idée que la poésie était le mode suprême de la connaissance, cette même foi dans l'homme qu'avait proclamée l'humanisme de 1530. Mais, à cette confiance qu'avaient déjà altérée la sinistre affaire des Placards (1534) et le massacre des Vaudois (1545), les conflits religieux, puis les guerres civiles allaient porter un coup fatal à partir de 1560, date à laquelle on serait tenté parfois de croire – bien à tort – que l'humanisme est mort.
Humanisme éthique
En fait débute alors pour l'humanisme du xvie siècle une ultime période, éthique et politique, à dominante stoïcienne et dont la fin peut se situer, sans qu'il soit possible de préciser davantage, dans la première moitié du xviie siècle. Il est incontestable que, avant 1560, les humanistes, tout occupés de platonisme, se sont peu intéressés au stoïcisme, pourtant déjà mise en partie à leur disposition par l'édition érasmienne des Œuvres de Sénèque parue en 1527. Leur intérêt ne s’affirme vraiment que plus tard, sous l'influence des circonstances historiques et politiques, avec la véritable tragédie que vont vivre les Français de 1560 après le début des guerres de Religion.
Paraissent alors bon nombre de traités, édités ou traduits séparément, et plusieurs commentaires où, face à tous les méfaits et à tous les maux engendrés par les luttes fratricides, les contemporains puisent résignation et courage. C'est dans les « jours mauvais pleins de désolations » que le Lillois Alexandre Le Blancq traduit, en 1571, la stoïcienne Consolation à Apollonius de Plutarque, comme c'est pendant les guerres dites « de Religion » que Robert Garnier s'inspire des tragédies de Sénèque pour composer des drames remplis d'allusions à nos malheurs nationaux, et que Guillaume Du Vair rédige, en 1590, pendant le siège de Paris, sa Constance et consolation ès calamités publiques.
Doctrine d'action et de résistance, ce stoïcisme moral, plus ou moins imprégné de christianisme, qui était celui d'un Étienne de La Boétie (1530-1563), marque d'une manière prédominante, mais non exclusive, l'humanisme du dernier tiers du xvie siècle, avant de prolonger son influence chez des auteurs comme Jean-Pierre Camus (Diversités, 1609) et Corneille, puis dans les Passions de l'âme de Descartes, pour intéresser encore la pensée religieuse jusqu'aux environs de 1660.
Avec lui, l'humanisme du temps, volontiers compréhensif, accueille toujours le platonisme, qui se survit dans quelques milieux mondains et à la Cour et aussi (mais de façon bien limitée) l'épicurisme, dont les thèmes ne parviennent pas à imposer l'idée – bien humaniste pourtant – de la retraite, du retour à soi, qui eût dû parfaitement convenir en ces temps de si profond désarroi.
Plutarque
Mais l'influence la plus nette sur l'époque est celle – tout éclectique – de Plutarque, que Jacques Amyot (1513-1593) vient précisément de traduire. Plutarque n'est pas seulement l'auteur des Vies parallèles, qui exaltent les vertus héroïques des païens et qui ont ainsi renforcé les tendances stoïciennes de l'époque ; c'est aussi celui d'opuscules moraux d'inspiration souvent platonicienne, parfois dirigés contre les stoïciens et les épicuriens. Avec le Plutarque d'Amyot se trouve favorisé à la fin du xvie siècle le syncrétisme philosophique qui donne un visage si complexe et si riche à l'humanisme éthique de cette période.
Humanisme politique
Éthique, l'humanisme d'alors est devenu aussi, par la force, politique. Bon nombre de poètes qui, en 1550, avaient allègrement chanté leur confiance dans le temps, ajoutent à leur lyre, une dizaine d'années plus tard, une corde d'airain ; témoin, parmi d'autres, Ronsard dans ses Discours (1562). Les horreurs des guerres civiles, dénoncées avec une éloquence grave et simple par l'humaniste et érasmique chancelier Michel de L'Hospital (1505 ou 1506-1573), sont aggravées par l'abaissement moral de bon nombre de Français, par la corruption particulière des princes que pervertit trop souvent le machiavélisme, cette doctrine détestable des courtisans et des tyrans. Contre les idées de Machiavel s'imprime sans doute une littérature qui emprunte à la fois à la tradition chrétienne et à l'ambiguïté païenne. L'illustrent, en dehors du Discours de la servitude volontaire de La Boétie, les œuvres de François de La Noue (1531-1591), d'Innocent Gentillet, de Jean Bodin (1530-1596). Certains passages aussi de Montaigne (1533-1592), dont il faut préciser ici la place singulière dans cet humanisme de la fin du xvie siècle
Montaigne
Humaniste, Montaigne l'est assurément par son admiration pour les écrivains de l'Antiquité (chez qui il « pillote », jusque dans ses dernières années, citations et exemples), par son souci constant de « bien faire l'homme et dument », par sa volonté de retrouver partout et toujours l'« universelle et commune liaison » entre les humains.
Mais, devant les œuvres, les héros et la civilisation des siècles antiques (il connaît, d'ailleurs, assez mal le grec), Montaigne garde un esprit critique acéré dont n'avaient pas fait preuve les humanistes précédents. L'homme, pour lui, n'est plus le centre ni la raison d'être de toute la création, encore moins cette « merveille des merveilles » dont parlait Sophocle et qu'avait exaltée l'humanisme optimiste de Pétrarque à François Rabelais : « Il n'est pas dit, déclare-t-il dans l'Apologie, que l'essence des choses se rapporte à l'homme seul. » Cependant, cet homme, même ramené à ses modestes dimensions dans l'univers copernicien, garde le droit – et a même l'impérieux devoir – d'atteindre à « cette absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être ».
À la réalisation de cette légitime ambition servira chez Montaigne l'exploration des divers systèmes philosophiques de l'Antiquité. Non pour que l'homme moderne y redécouvre quelque modèle idéal, mais parce que, par l'analyse critique, méthodique, méthodologique des affirmations avancées par ces systèmes, il se cherche et il se trouve lui-même, dans le consentement lucide à l'humaine condition, dans le sentiment profond du rapport de reconnaissance qui doit unir l'être créé à son créateur. Avec Montaigne, l'humanisme français du xvie siècle s'enrichit de ce qui reste le meilleur de tout humanisme : il s'humanise.
3. Ailleurs en Europe
Le mouvement humaniste ne se limite pas seulement à l'Italie et à la France. Il gagna les Pays-Bas, où l'université de Louvain avait été fondée en 1425, où Érasme le rencontre auprès de Rudolf Agricola et d'Alexander de Heek (Hegius). Érasme est le phare de la nouvelle culture, encore très liée à la religion : ses éditions des Pères de l'Église, ses Dialogues et ses Adages, son Éloge de la folie (1511), ses réflexions sur le christianisme, sur la formation des princes chrétiens le posèrent en maître à penser de l'Europe. Une abondante correspondance le relia aux lettrés de tous les pays.
L’humanisme brilla également en Angleterre dans l'entourage de John Colet (1467-1519) et de Thomas More (1478-1535) dont la célèbre Utopie (1516) prépara la voie à l'art élisabéthain.
L'Espagne (→ Juan Luis Vives, 1492-1540) connut de son côté un humanisme religieux et théologique. Le grand défenseur de l'humanisme y fut le cardinal Cisneros, qui fonda l'université trilingue d'Alcalá de Henares, d'où sortit la première Bible polyglotte. Mais, après une génération enthousiaste, les querelles religieuses envenimèrent le mouvement et les disciples d'Érasme furent pourchassés.
Reuchlin et Melanchthon (1497-1560) illustrèrent l'humanisme érudit allemand, dont la production littéraire demeure, au total, assez pauvre. En Hongrie, l'empereur Mathias Corvin (1440-1490) favorisa la renaissance des lettres antiques, dont Jan Kochanowski (1530-1584) est le meilleur représentant en Pologne. Partout, l'humanisme assura la restauration des études anciennes ; partout, il exerça une influence réelle sur la civilisation.
4. L'humanisme à l'œuvre
Rien ne serait plus faux, en effet, que d'imaginer l'humanisme comme un phénomène purement littéraire et rhétorique. Sans doute, les humanistes sont-ils, d'abord, de véritables savants, mais ces esprits curieux, acharnés au travail, ne vivent pas une vie ignorante du monde. Hommes pratiques, que rapprochent les uns des autres, dans la république des lettres, visites et échanges de correspondance, ils savent que les bonae artes doivent englober tous les domaines de l'existence. Mus par un sens très vif de l'histoire, que ne gêne point leur passion pour les sources antiques, ils entendent faire œuvre de philosophes, contribuer à la promotion d'une humanité libérée, capable, grâce à sa rénovation spirituelle, d'affronter, mieux qu'il n'était possible dans le passé, tous les problèmes de la vie, moraux, pratiques, intellectuels et philosophiques. Ainsi, la philosophie est, à l'image du macrocosme, dont l'homme est le microcosme, aussi vaste et aussi riche que l'Univers lui-même.
4.1. Humanisme et science
S'agissant de la science, à laquelle les Anciens avaient pourtant accordé une place importante, on ne peut dire que l'humanisme, nourri surtout de textes et d'auteurs, l'ait pleinement favorisée. Humanisme et science paraissent souvent se développer séparément et sans action directe réciproque. Les poètes dits « scientifiques » – Peletier, Ronsard, Maurice Scève, Baïf, Belleau, Du Bartas, d'Aubigné – sont tous de grands humanistes, mais ils demeurent, sauf de rares exceptions, étrangers à l'activité créatrice des sciences de leur temps.
En France, les vrais savants – comme Bernard Palissy (vers 1510-vers 1590), l'inventeur des émaux français, géologue et astronome, et, plus encore, le chirurgien Ambroise Paré (vers 1509-1590), qui ne savait ni le grec ni le latin – récusent l'autorité des Anciens, pour s'appuyer sur l'expérience, sur la pratique, sans laquelle il n'est pas, à leurs yeux, de véritable science. Cependant, cette pratique n'exclut pas forcément, chez tous les savants, le recours à la théorie, aux textes antiques oubliés, ceux d'Archimède par exemple, que l'humanisme précisément vient de remettre à jour et qu'un Copernic n'a peut-être pas méprisés, sachant, en humaniste accompli, que l'expérience du passé est nécessaire à la découverte de demain.
4.2. Humanisme et religion
Dans le domaine religieux, l'humanisme n'entraîne, au total, de paganisme que littéraire. Et mis à part quelques libertins, quelques rationalistes isolés, il n'affecte pas essentiellement la mentalité d'une époque qui voulut croire. Évangélique, l'humanisme est, d'abord, au service de la foi. Par la suite, bien peu d'humanistes passèrent à la Réforme, dont ils appréciaient l'effort philosophique et philologique d'épuration de la doctrine chrétienne, mais à laquelle ils se sentaient plus encore opposés, et dans le problème de la justification par la foi et dans la conception de la vie morale, où les réformés se plaisaient trop à leur gré à insister sur le néant de l'homme.
Sans doute un puissant mouvement sceptique traverse-t-il la seconde moitié du xvie siècle. Encore n'a-t-il pour conséquence que de séparer les domaines de la raison et de la foi. L'humanisme, pour Montaigne, ne suppose pas la croyance, il ne l'exclut pas davantage et il conduit, chez lui, tout naturellement au respect de la tradition religieuse. De quoi sera garante, lors de la Contre-Réforme française, l'alliance des catholiques les plus orthodoxes avec les disciples les plus sceptiques de Montaigne dans une croisade commune contre le calvinisme.
4.3. Humanisme et vie civile
Les « institutions du prince »
L'humanisme inspire également les attitudes de l'homme dans la cité. Pour les esprits du xve siècle ou du xvie siècle, l'organisation de l'État revêt une telle importance qu'on ne saurait mieux la comparer qu'à celle de l'Univers, la « court et l'estat d'ung prince terrien » pouvant être « apparagés [assimilés] », comme l'écrit Antoine Du Saix (1505 ?-1579), « à la ronde concavité et forme sphérique du firmament ». De ce cosmos politique, le prince est le soleil, par la sagesse de qui passe obligatoirement le bonheur du peuple. D'où ces multiples « institutions du prince », où la leçon antique renforce les instructions de la Bible pour prôner l'exercice d'une pieuse sagesse fondée sur les vertus cardinales, pour mettre le prince en garde contre les flatteurs et les médisants, pour lui rappeler sans cesse ses devoirs envers Dieu, envers son peuple, envers lui-même
Exhortation à la vie civile
D'où aussi ces appels à une active participation des citoyens aux affaires publiques comme Montaigne les entend lorsqu'il accepte, sur les ordres du roi, la mairie de Bordeaux. Exhortation à la vie civile qui s'accompagne souvent d'une incitation à la fierté nationale.
Incitation à la fierté nationale
Par nature, l'humanisme se colorait volontiers de cosmopolitisme, mais les œuvres antiques abondaient, par ailleurs, en exemples prestigieux d'amour pour la patrie. S'autorisant de ces vénérables précédents, les humanistes affirment avec force l'originalité de la pensée nationale. En France, où se développe le mythe nationaliste des Celtes et des Gaulois, des historiens érudits, comme Étienne Pasquier (1529-1615) dans ses Recherches de la France et Claude Fauchet (1530-1602) tout au long des Antiquités gauloises et françaises, étudient les origines de leur pays, que chante aussi Ronsard dans l'Hymne de France, que célébreront tous ceux qui, comme Marot ou du Bellay, sont sensibles aux charmes de leurs petites provinces natales.
Néoplatonisme, éducation, amour et mariage
Parallèlement, l'humanisme suscite un véritable renouvellement dans l'inspiration amoureuse : avec le néoplatonisme, l'amour que le courant courtois du Moyen Âge avait déjà spiritualisé prend une teinte nettement mystique. Y seront sensibles beaucoup d'hommes et surtout de femmes, qui répugnent aux platitudes et aux grossièretés de l'amour vulgaire.
L'humanisme, enfin, apporte ses secours dans de multiples circonstances ; ainsi, dans les problèmes de l'éducation, qui préoccupent, d'Érasme à Montaigne, tant d'auteurs d'« institutions puériles », soucieux d'assurer aux enfants, dès leur plus jeune âge, les rudiments du savoir et du savoir-vivre afin de les humaniser progressivement. Et aussi dans la question, sans cesse reprise, des rapports entre l'amour et le mariage, réalités que Montaigne (Essais, III, V) trouve sinon conciliables, du moins orientées de façon tout à fait différente, mais que tout un mouvement, qui va du platonisme chrétien de Marguerite de Navarre à l'humanisme dévot de saint François de Sales, veut absolument associer pour le plus grand bonheur de l'homme et de la femme, sur terre et dans le ciel.
Vie en société
Enfin, dans les diverses difficultés que soulèvent à chaque instant les nécessités de la vie en société. Dans ces domaines si variés, les Œuvres morales de Plutarque, synthèse complète de l'acquis d'une civilisation prestigieuse, apportaient à chacun réponse à sa mesure. Traduites par Amyot en 1572, elles connurent le plus vif des succès. Présentées dans l'habit seyant que leur avait taillé Amyot, les Œuvres morales ne parurent plus une œuvre traduite de l'Antiquité. Plutarque devint rapidement « familier par l'air françois qu'on lui avoit donné, si perfect et si plaisant » notait Montaigne (Essais, II, VII), qui ajoutait : « C'est nostre bréviaire. » De fait, les lecteurs pouvaient y apprendre comment distinguer l'ami du flatteur, quels remèdes trouver contre l'irascibilité, sur quels principes fonder l'éducation des enfants. Les jeunes mariés y recevaient d'utiles conseils pour la vie conjugale ; les citoyens, de sages indications sur l'administration des affaires publiques.
Plutarque apportait également le témoignage des vertueux faits de tant de femmes héroïques de l'Antiquité : parmi elles, la Gauloise Camma, dont la fidélité conjugale devait longtemps inspirer dramaturges et moralistes. Par là se trouvait fournie la solution au problème fondamental de l'humanisme, celui de savoir comment l'apport de l'Antiquité pouvait servir à l'éducation d'une pensée qui se savait chrétienne et se voulait moderne.
Ainsi, l'humanisme fut, en même temps que passion de connaître et culte de beauté, une attitude expérimentale et psychologique de l'homme, une « épreuve » de toutes ses forces, une véritable école de vie.
Sur le plan littéraire, son importance n'est pas moindre. Il donna leur pleine ampleur à des thèmes essentiels de notre littérature : nature, vertu, gloire, amour. Il favorisa le développement du genre du dialogue, dans lequel on voyait comme une manière d'« humaniser » un traité, et c'est sous l'influence de la littérature antique que naquit la tragédie française régulière, avec, notamment, la Cléopâtre captive de Jodelle (1532-1573). Il fut enfin l'occasion d'un enrichissement remarquable du vocabulaire et, s'agissant du style, il constitua une étape décisive dans la conquête de la précision et de l'harmonie.
Au-delà de sa définition la plus précise, lié au courant littéraire et intellectuelle qui marqua l’histoire européenne des xve et xvie siècles, l'humanisme est une philosophie qui se donne pour fin l'épanouissement de l'homme.
5. xixe-xxe siècles : quelles formes d'humanisme ?
Le xixe siècle, qui « invente » le terme d'humanisme, lui donne en fait des significations plus intéressantes que sa définition, puisque le terme naît chez Proudhon. « Homme » désigne alors plutôt l'individu, opposé à des systèmes ou à des régimes (politiques, économiques, sociaux) ; rien d'étonnant dès lors si, au nom de la révolte ou du progrès, les historiens appellent « humanisme » le mouvement d'idées du début de la Renaissance qui, d'une certaine manière, faisait de l'esprit critique individuel, de la promotion des individus hors de leur champ social selon leurs capacités, de l'inventivité des valeurs, de la pensée libre un instrument de lutte contre ce que le xixe siècle considère comme un obscurantisme médiéval religieux. On y oublie le rôle indéniable des langues anciennes, la religiosité platonicienne et l'appui aux princes.
Les aspects combatifs d'un socialisme utopique se diluent ensuite, le terme est repris hors de son contexte, et peut se retourner contre ses auteurs, taxé de matérialisme, de tyrannie au nom de systèmes.
Concrètement, « humanisme » peut finir par s'appliquer à toutes les opinions où chacun défend l'homme à partir de définitions différentes de ce qu'il est et devrait être. C'est ainsi qu'on a pu opposer Camus l'humaniste à Sartre le théoricien, et poser la question de savoir si l'existentialisme était un humanisme, ou encore s'il pouvait exister un humanisme marxiste.
Quelle que puisse être la vanité de telles questions, l'emploi actuel le plus fréquent du terme « humanisme » évoque souvent un contexte passéiste, quelque ennuyeuse vertu, et une certaine désuétude, même et surtout sous l'étiquette d'« humanisme moderne ». Mais il est vrai que le xxe siècle, à travers guerres et holocaustes, camps et goulags, idéologies massives et esthétiques de la « défiguration », a tout fait pour effacer la « nature humaine ».
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
SOCRATE |
|
|
| |
|
| |
Socrate
Philosophe grec (Alôpekê, Attique, 470-Athènes 399 avant J.-C.).
Homme de la parole philosophique en cette époque du « siècle de Périclès » féconde entre toutes pour l’histoire de la pensée en Occident, Socrate fit de l’intelligence l’instrument d’une quête méthodique de la vérité. Son enseignement, propagé par les dialogues de Platon, fut si déterminant que la vie de l’esprit en fut à jamais transformée.
1. La vie de Socrate : le maître de l'agora
Né dans un milieu modeste, Socrate a pour père Sophronisque, un simple sculpteur, et pour mère Phainarète, qui exerce la profession de sage-femme. Voué lui-même au métier de sculpteur, il l’abandonne pour se consacrer à la philosophie. Sa vie consiste alors à discuter avec ses concitoyens, en déambulant où que ce soit dans Athènes, mais de préférence sur l’agora (centre religieux, politique et commercial de la ville grecque antique).
De la vie de Socrate peu de choses nous sont parvenues. On sait qu’il a eu trois enfants (Lamproclès, Sophonisque et Ménéxène) d’un ou de trois mariages. On sait aussi qu’il n’est sorti que quatre fois d’Athènes : en 432-429 avant J.-C. pour la bataille de Potidée, en 424 pour la bataille de Délium, en 422 pour l'expédition d'Amphipolis et à une date incertaine pour aller consulter l'oracle de Delphes.
Un curieux professeur
À une époque où fleurissent les « maîtres de savoir » professionnels, il ne se prétend pas fondateur d’école et, s’il a des disciples, jeunes gens fortunés – Platon, Alcibiade, Xénophon – ou simples artisans, c’est qu’ils viennent spontanément s’entretenir avec lui. Il n'écrit rien mais il le dit lui-même : « Si on me pose des questions, j’y réponds ; si on préfère que j’en pose, je m’exécute. »
À la différence des sophistes, professeurs itinérants, Socrate ne fait pas payer ses leçons. Il a la réputation de vivre dans la pauvreté. Mais, pendant la guerre du Péloponnèse, il sert comme hoplite (fantassin lourdement armé), ce qui sous-entend qu’il dispose d’un minimum de bien. À la guerre, il fait preuve de sa valeur mais aussi de son endurance. Alcibiade en témoigne : « Il ne ressemble à aucun homme, ni des temps anciens, ni des temps actuels. » Il peut aussi, de l’aube d’un jour à l’aube du jour suivant, rester « planté comme une souche » afin de trouver la solution au problème qu’il se pose.
Alcibiade, l'élève préféré de Socrate
Pupille de Périclès, Alcibiade faisait partie de la jeunesse dorée d’Athènes qui n’avait que vénération pour Socrate – un homme aux traits disgracieux (d’un avis unanime) mais à l’esprit supérieur. Durant la guerre du Péloponnèse, il fut deux fois son compagnon d’armes, lors de la bataille de Potidée, où Socrate lui sauva la vie, puis lors de la bataille de Délium, où c’est lui qui se porta au secours de Socrate.
Pour Socrate comme pour Platon, qui fit d’Alcibiade l’un des protagonistes du Banquet et le héros de tout un dialogue (Alcibiade, sous-titré De la nature de l’homme), le jeune aristocrate incarnait l’idéal grec du kalos kagathos, selon lequel la beauté du corps était le reflet de la noblesse de l’âme. Hélas ! L’arriviste qui sommeillait en lui précipita la ruine d’Athènes en provoquant l’expédition de Sicile de 415 avant J.-C., devenant ainsi, selon le mot de Jacqueline de Romilly, le « beau fossoyeur » de sa patrie.
Socrate vu par ses contemporains
Trois de ses contemporains parlent de Socrate. Aristophane le ridiculise dans les Nuées (423 avant J.-C.). Platon a vingt ans quand il rencontre Socrate. Des huit années qu'il passe auprès de lui, tous les dialogues portent sans doute la trace, mais les premiers sont plus riches en informations (Apologie de Socrate, Criton, le Banquet, Phédon, Théétète). Quant à Xénophon (auteur également d'une Apologie de Socrate), il a fréquenté Socrate à la même époque, mais semble-t-il moins assidûment ; l'intérêt de ses Mémorables s'en ressent. Entre les trois portraits que font ces auteurs, l'accord est loin de régner.
Sans doute le Socrate d'Aristophane est-il plus jeune, mais, pour avoir le même âge, celui de Platon et celui de Xénophon ne se ressemblent pas. Qu'y a-t-il de commun entre le personnage quelconque évoqué par ce dernier et la figure qui, à travers les dialogues de Platon, dominera toute la philosophie ?
2. La philosophie de Socrate
Une attitude : l'ironie
Socrate n’a pas toujours la philosophie facile. Face aux esprits exigeants que sont ses interlocuteurs, il doit batailler dur ; s’il se trouve à court d’argument, il s’en veut et parle d’un « démon intérieur » comme d’un contradicteur qui le rappelle à l’ordre. La plupart du temps, il est vrai, c’est lui qui s’amuse de ceux qui l’approchent (l’« ironie socratique ») et, s’il le faut, qui les malmène en les poussant dans leurs retranchements. L’enjeu, en effet, dépasse leur personne : c’est l’homme en général que Socrate s’efforce de changer en homo philosophicus. Il faut donc que son raisonnement soit sans défaut pour que sa pensée soit la plus universelle possible, et pour que lui-même ne soit pas seulement un grand homme d’Athènes, « mais du monde », comme le dira Montaigne.
« Connais-toi toi-même »
Lors de son voyage à Delphes, Socrate découvre l’injonction inscrite au fronton du temple d’Apollon : « Connais-toi toi-même » (gnôthi seauton). Il en fera la maxime de sa vie, tout entière consacrée à révéler aux consciences ce qu’elles sont au fond d’elles-mêmes et à les faire passer du savoir apparent au savoir vrai.
La première chose à savoir sur soi-même est en effet l’état d’ignorance où l’on se trouve : « Je sais que je ne sais rien. » Aussi Socrate, comparant sa « sagesse » à celle d’un autre Athénien, déclare-t-il : « Il y a cette différence que, lui, il croit savoir, quoiqu’il ne sache rien ; et que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu’en cela du moins je suis un peu plus sage – je ne crois pas savoir ce que je ne sais point » (Apologie de Socrate).
Une méthode : la dialectique et la maïeutique
Pour conduire la jeunesse d’Athènes sur la voie du Vrai, du Beau et du Juste, Socrate met en application une méthode qui repose sur l’art du dialogue contradictoire – la dialectique – et, comme le confirmera Aristote, sur l’« art d’accoucher les esprits » – la maïeutique. C’est ainsi qu’au jeune Théétète médusé, il apprend que son âme (son esprit) est « en butte aux douleurs de l’enfantement » au moment d’accoucher de ses opinions sur la nature de la science. Socrate présidera au « travail » de son âme afin que, de question en question, celle-ci donne naissance à l’opinion vraie – la seule qui ait le droit d’exister.
PUBLICITÉ
3. Le procès et la mort de Socrate
Au lendemain du régime des Trente, qui avait mis à bas la démocratie, celle-ci est restaurée par Thrasybule revenu d’exil. À Athènes, cependant, le climat reste tendu. Indifférent aux honneurs et aux compromissions, Socrate irrite. Par surcroît, son admiration pour Sparte, la cité rivale d'Athènes, le rend suspect. Surtout, il est celui qui, ayant toute sa vie pris le parti de la raison, a ébranlé au moins autant les certitudes que les traditions de ses compatriotes.
C’est alors que trois citoyens d’Athènes, le tailleur Anytos flanqué du poète Mélétos et du rhéteur Lycon, accusent Socrate d’« avoir honoré d’autres dieux que ceux de la cité et tenté de corrompre la jeunesse », sous le prétexte qu’il y avait parmi les Trente plusieurs de ses anciens élèves.
Son procès sera celui de la conscience individuelle en butte à l’abus de pouvoir et à la démagogie.
Se chargeant lui-même de sa défense (qu’exposent en détail les deux textes dits Apologie de Socrate) mais se refusant à invoquer la pitié de ses juges, Socrate est condamné à mort par 281 voix contre 278. À ses amis qui le pressent de s’enfuir, il répond qu’il préfère « subir l’injustice plutôt que de la commettre » : il détruirait la cité s’il ne respectait pas son jugement. Alors, il accepte la coupe de ciguë qui va lui ôter la vie. En ce soir de mars 399 avant J.-C., il aura ces derniers mots : « Je tiens d’une noble tradition qu’il faut en quittant la vie se garder de paroles funestes. »
Dans l’histoire de la philosophie, la rupture est faite. Il y aura les « présocratiques » et les « postsocratiques ». La science de l’homme qui commence avec Socrate trouvera en Platon puis en Aristote ses féconds continuateurs. Et, plus de 2000 ans après sa mort, Paul Valéry pourra écrire : « Grand Socrate, adorable laideur, toute-puissante pensée, qui changes le poison en un breuvage d’immortalité »(Eupalinos ou l’Architecte).
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
STOÃCISME |
|
|
| |
|
| |
stoïcisme
École philosophique fondée au iiie s. avant J.-C. par Zénon de Cition, le stoïcisme se prolonge à travers toute l'Antiquité, tant en Grèce que dans l'Empire romain, et reste influent jusqu'à notre époque. Pour cette philosophie de l'acceptation et du courage, à la fois fataliste (pour ce qui ne dépend pas de nous) et volontariste (pour ce qui en dépend), qui dit oui à tout ce qui arrive et à tout ce que la situation donnée, la vertu ou la raison exigent de nous, le bonheur est le souverain bien et la vertu, le seul bonheur.
Les œuvres des premiers stoïciens ne sont pas parvenues jusqu'à nous : outre quelques fragments et le fameux Hymne à Zeus de Cléanthe, nous ne les connaissons que par les citations qu'en ont fait les doxographes ou commentateurs, notamment Diogène Laërce, Sextus Empiricus et Cicéron. En revanche, nous disposons de beaucoup d'œuvres du stoïcisme impérial, parmi lesquelles les traités et les Lettres à Lucilius de Sénèque, le Manuel et les Entretiens d'Épictète, enfin les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle.
Une longue histoire
Le stoïcisme n'est pas né de rien, ni du seul cerveau de Zénon. Outre une éventuelle influence de la pensée orientale, qui reste difficile à établir, les stoïciens se nourrissent de trois sources principales : Héraclite d'Éphèse, qui marquera surtout leur physique ; les philosophes de l'école de Mégare, qui influenceront surtout leur logique ; enfin ceux de l'école des cyniques – et, par eux, Socrate –, qui inspirent bien des traits de leur morale.
Si le stoïcisme est un « système » (les stoïciens inventèrent d'ailleurs le mot), il sut aussi s'adapter à travers l'histoire et intégrer les importantes variations proposées par ses disciples. On distingue traditionnellement trois périodes : l'ancien stoïcisme (Zénon, Cléanthe et surtout Chrysippe), qui couvre tout le iiie s. avant J.-C. ; le moyen stoïcisme (Panaitios de Rhodes, Posidonios), qui traverse les iie et ier s. ; enfin le stoïcisme impérial, le mieux connu, qui s'épanouit durant les deux premiers siècles après J.-C., grâce aux œuvres de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces œuvres sont, pour le stoïcisme en général, notre source principale.
Malgré certaines évolutions ou divergences, les stoïciens resteront fidèles, durant ces cinq siècles, aux inspirations premières du Portique (stoa, en grec), comme on désignait alors l'école de Zénon, qui enseignait sous un portique d'Athènes. Cette constance bien rare doit beaucoup à la force intrinsèque du système, et c'est elle qu'il faut essayer de comprendre.
Une logique de l'événement
Les stoïciens divisaient traditionnellement leur philosophie en trois parties : la logique, la physique et l'éthique. Ces trois parties forment un tout, qui est le stoïcisme même, et doivent donc être prises ensemble. En revanche, dans l'exposition, elles doivent être nettement séparées. Pour des raisons surtout pédagogiques, les penseurs stoïciens avaient coutume de commencer leur enseignement par la logique.
Cette logique, c'est tout ce qui concerne le logos, c'est-à-dire, indissolublement, le discours et la raison. Elle inclut donc une théorie de la connaissance, qui est d'inspiration à la fois sensualiste (les sensations, pour les stoïciens, sont toutes vraies), rationaliste (la science est « fondée sur la raison ») et volontariste (toute connaissance suppose un jugement volontaire) : les stoïciens appellent « assentiment » le mouvement, à la fois nécessaire et volontaire, de l'esprit par lequel il adhère au vrai et au bien. Ce dernier point est sans doute le plus original, et domine tous les autres : connaître, c'est juger ; et juger, c'est vouloir. On comprend dès lors que la volonté ne peut pas vouloir n'importe quoi (car alors il n'y aurait plus de connaissance), mais uniquement ce qu'elle perçoit comme vrai ou bien.
Les attributs de l'âme
Les stoïciens nommaient « représentation » (phantasia) l'empreinte ou la modification produite dans l'âme par les objets qu'elle représente ; l'empreinte reproduit ce dont elle provient. La représentation est « compréhensive », elle est l'image d'un objet existant – dont elle porte « la marque et l'empreinte » – ; quand on ne peut douter de son exactitude, c'est alors une image claire et distincte, et le critère de la vérité : il s'agit de l'évidence première, sans laquelle aucune certitude ne serait possible. Les sensations et les prénotions (prolêpsis, notions communes ou idées générales) en résultent ; plus exactement, elles ne sont que des représentations compréhensives spécifiques, saisissant des objets sensibles (sensations) ou rationnels (prénotions). La représentation compréhensive, même si elle est un pathos (une affection), suppose toujours une activité du sujet, de même que l'assentiment qui lui est accordé, quoique nécessaire (on ne peut douter du vrai qu'on comprend), reste indubitablement un mouvement volontaire de l'âme.
La figure du sage
La liberté de l'esprit n'est donc pas un libre arbitre (qui pourrait choisir indifféremment ceci ou cela), mais une libre nécessité (qui adhère spontanément et nécessairement à ce qui lui paraît vrai ou bien). Elle n'est donc pas autre chose que la raison : c'est en quoi le sage seul est libre, ou l'est absolument, puisque lui seul sait ce que c'est que savoir. « Sauf le sage, rapporte Cicéron, personne ne sait quoi que ce soit; et cela Zénon le montrait par un geste. Il montrait sa main ouverte, les doigts étendus : c'est là la représentation, disait-il ; puis il repliait un peu les doigts : c'est là l'assentiment ; ensuite, quand il avait complètement fermé la main et qu'il montrait le poing serré, il déclarait que c'était là la compréhension. Enfin, il approchait la main gauche du poing fermé et il le serrait étroitement et avec force : il disait que c'était là la science, que personne ne possède sauf le sage » (Académiques I).
Linguistique et logique
La logique stoïcienne, comme théorie du logos, comporte aussi une rhétorique (ou art du discours) et une dialectique (ou art du raisonnement : c'est l'équivalent de notre logique formelle). Sur ces deux plans, les stoïciens sont allés très loin : ils anticipent de manière surprenante notre linguistique, notamment par la distinction entre signifiant (sêmainon), signifié (sêmainomênon) et référent (tunkhanon). Ils sont également les précurseurs de notre logique, par l'invention d'une logique des propositions ou des événements – qui se différencie de la logique aristotélicienne des noms ou des prédicats. Convaincus qu'il n'existe que des individus (ce qu'on peut appeler leur « nominalisme », qu'ils héritent des cyniques) et que tout est toujours en devenir (ce qu'on peut appeler leur « héraclitéisme »), les stoïciens se sont donné la logique nécessaire pour que soit possible – contrairement à ce que prétendait Aristote – une science de l'individuel : la physique.
Une physique des corps
Pour les stoïciens, il n'existe que des corps. On peut qualifier leur philosophie de matérialiste. Mais l'esprit n'en existe pas moins : l'âme est un corps, une partie du feu divin, qui anime les vivants de l'intérieur et qui, en l'homme, est raison. La totalité des corps est le monde, qui est unique, fini et plein dans un vide infini. Ce monde est vivant, rationnel, harmonieux, parfait (« puisqu'il comprend la totalité des êtres et que rien n'existe en dehors de lui »), et c'est pourquoi il est Dieu.
La physique stoïcienne est donc aussi une théologie, d'inspiration panthéiste. Dieu « n'a pas la forme humaine » : sa substance est « le monde tout entier et le ciel », et il fait régner sa providence dans « tout ce qui s'y trouve ». C'est pourquoi cette physique est fataliste : toutes les causes se tiennent et forment « un ordre et une connexion qui ne peuvent jamais être forcés ni transgressés ». Cette « chaîne des causes » (à laquelle correspond, dans la logique, la chaîne des propositions) est appelée par les stoïciens le destin, lequel est « une disposition du tout, depuis l'éternité, de chaque chose suivant et accompagnant chaque autre chose, disposition qui est inviolable » ; la chaîne des causes est ce à quoi tout est soumis et le destin – les stoïciens disent aussi l'« ordre du monde » – n'est pas autre chose que l'ensemble de tout ce qui arrive, considéré dans son éternelle Vérité : « tout arrive selon le destin ».
Il n'y a ni hasard ni contingence. car l'un des grands thèmes stoïciens est aussi la destruction et le recommencement périodiques de l'univers (éternel retour ou palingénésie) : c'est en quoi la connaissance de l'avenir, ou divination, est possible.
Les « incorporels »
Dans ce monde de corps, les stoïciens laissaient pourtant une place à ce qu'ils appelaient les « incorporels ». Ce n'est pas contradictoire avec l'ensemble de leur théorie. Certes, « les corps sont les seules réalités et la seule substance » ; eux seuls existent, absolument, eux seuls agissent et pâtissent. Mais la pensée rencontre aussi des pseudoréalités, qui ne sont pas vraiment des êtres, qui n'agissent ni ne pâtissent, mais qui ne sont pas non plus de purs néants et dont la pensée ne peut se passer.
Les incorporels sont au nombre de quatre : l'exprimable (lekton, le contenu du discours), le vide, le lieu et le temps. On ne saurait pourtant les prendre pour des êtres véritables, et c'est en quoi les stoïciens ne seront dupes ni du discours ni du temps : le sage vit au présent et, sinon toujours en silence, du moins sans bavardage. Il s'agit de ne rien ajouter au monde : ni regrets ni craintes, ni erreurs ni mensonges. La vérité suffit, et doit suffire.
Une éthique de la volonté
Cela nous conduit à l'éthique. Contre les épicuriens (→ Épicure), leurs contemporains et adversaires, les stoïciens refusent de considérer que le plaisir soit un bien. « En effet, disaient-ils, il y a des plaisirs honteux, et rien de ce qui est honteux n'est un bien. » Pour la même raison, la douleur n'est pas un mal, puisqu'il n'y a « d'autre mal que ce qui est honteux », ce que la douleur n'est pas. Il en résulte que « le seul bien, c'est ce qui est moral (honestum) ; et avoir une vie heureuse, c'est vivre moralement, c'est-à-dire avec vertu » (Cicéron, De finibus).
Ce qu'on peut appeler le moralisme des stoïciens est indissociable du naturalisme de ces philosophes. Le souverain bien consiste en effet à « vivre en accord avec la nature » : « en accord », c'est-à-dire homologoumenôs, « d'une même raison ». C'est en quoi la vie naturelle est aussi une vie raisonnable et, par là, une vie vertueuse : la vertu est « conformité de l'âme avec elle-même », de la raison en moi avec la raison en tout.
La soumission volontaire au destin
Naturalisme, rationalisme et moralisme vont donc ensemble : « La fin suprême est de vivre selon la nature, c'est-à-dire selon sa nature et celle du tout, en ne faisant rien de ce qui est défendu par la loi commune, la droite raison répandue à travers toutes choses, laquelle est identique à Zeus et gouverne tout l'univers. » Il en découle aussi une vision politique : le sage est citoyen du monde (kosmopolitês) et sujet seulement de son ordre divin.
Il n'y a là aucune passivité. S'il est vrai qu'il faut se soumettre au destin, cette soumission est elle-même un acte volontaire, qui en inclut beaucoup d'autres. Nous soumettre au destin, c'est certes accepter tout ce qui arrive ; mais c'est aussi y jouer notre rôle, du mieux que nous pouvons. Entre liberté et fatalité, il n'y a aucune opposition. Toute action est fatale, qu'elle soit libre ou serve ; l'action libre n'est pas celle qui échappe au destin (c'est évidemment impossible), mais celle qui s'y soumet en connaissance de cause et qui y participe activement. « Le destin conduit celui qui y consent, disait Sénèque, il entraîne celui qui lui résiste » (Lettre à Lucilius, 107).
L'apatheia stoïcienne est le contraire d'une apathie, au sens moderne du terme : loin d'être absence d'action, elle correspond à l'inverse à l'absence de passion (de pathos), et c'est précisément en quoi le sage stoïcien est un homme d'action. Marc Aurèle dira: « Ne rien attendre, ne rien fuir, mais te contenter de l'action présente » (Pensées, III, 12). Soit : « Aide-toi toi-même, tant que tu le pourras » (III, 14), fais tout ce qui t'incombe, fais-le « immédiatement » (VIII, 5), et laisse le reste au Dieu ou au destin.
La recherche de la vérité
Cela suppose qu'on sache distinguer, comme disait Épictète, « ce qui dépend » de nous et « ce qui n'en dépend pas » : « Les choses qui dépendent de nous sont naturellement libres, sans empêchement, sans entrave ; celles qui ne dépendent pas de nous sont fragiles, serves, facilement empêchées, propres à autrui » (Manuel, I). L'homme libre, c'est en effet celui à qui tout arrive selon sa volonté – mais comment serait-ce possible s'il veut ce qui n'en dépend pas ? Le sage cessera donc d'espérer quoi que ce soit qui ne dépende pas de lui (c'est-à-dire d'espérer tout court), et se contentera de vouloir ce qui en dépend (ce qui est, exactement, vouloir). Il sera donc toujours parfaitement libre, car « est libre celui qui vit comme il veut » (Épictète, Entretiens, IV, 1) et parfaitement heureux, puisque tous ses désirs seront comblés. Le sage ne connaît « ni l'espoir ni la crainte », disait Sénèque (De la constance du sage, 9), et c'est à quoi sans doute il se reconnaît : la vérité et la volonté lui suffisent.
Telle est, encore aujourd'hui, la leçon du stoïcisme : la vérité et la volonté sont nécessaires l'une et l'autre. Le message du stoïcisme, d'une rare grandeur spirituelle, a su éclairer toutes les couches de la société antique, depuis l'esclave Épictète jusqu'à l'empereur Marc Aurèle, puis féconder toute la pensée occidentale moderne, de Montaigne ou Descartes jusqu'à Alain, Simone Weil ou Vladimir Jankélévitch.
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|