| |
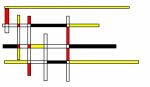
métabolisme
(grec metabolê, de metaballein, transformer)
Consulter aussi dans le dictionnaire : métabolisme
Cet article fait partie du dossier consacré à la
nutrition
et du dossier consacré à la
respiration
.
Ensemble des processus complexes et incessants de transformation de matière et d'énergie par la cellule ou l'organisme, au cours des phénomènes d'édification (anabolisme) et de dégradation (catabolisme) organiques.
BIOCHIMIE
Au cours des diverses réactions physico-chimiques qui constituent la base des différentes fonctions organiques, et qui comportent nécessairement des oxydations (sources d'énergie), l'être vivant puise dans les aliments ou dans les substances de réserve le matériel et l'énergie nécessaire au maintien de son équilibre, et supplée aux dépenses de matière et d'énergie de chaque cellule. L'apport continu d'énergie dans chaque cellule d'un organisme sert à l'entretien, à la réparation et au renouvellement des structures devenues inutilisables, mais assure aussi le bon déroulement d'activités cellulaires telles que la croissance ou la division.
L'énergie dont les cellules ont besoin leur est fournie par les réactions chimiques.
Le métabolisme des glucides, des lipides, des protides est le métabolisme le plus important. Ces substances chimiques constitutives des aliments, après modifications subies dans le tube digestif (→ digestion), passent dans le milieu intérieur de l'organisme. Elles subissent alors de nouvelles modifications et peuvent prendre part à des synthèses de la matière vivante, à la constitution de réserves, ou être oxydées, et fournir ainsi leur énergie à l'organisme. Les métabolismes intermédiaires se font, pour chaque corps, sous l'action d'enzymes nombreuses, dans les tissus et les humeurs, avec spécialisation de certains organes comme le foie, le rein, les glandes à sécrétion interne.
L’anabolisme et le catabolisme
Les réactions du métabolisme se répartissent en deux grandes catégories : l’anabolisme rassemble les processus de synthèse de nouvelles molécules ; le catabolisme correspond à la dégradation de structures devenues inutiles en molécules plus petites qui sont soit « recyclées » par la cellule, soit éliminées par l’organisme.
Le catabolisme permet à la cellule de récupérer de l'énergie, qu'elle stocke dans des composés particuliers – le plus souvent l’ATP, ou adénosine triphosphate. Ces réserves énergétiques sont utilisées ultérieurement pour la contraction musculaire, la production d'influx nerveux, mais aussi à l'occasion de la synthèse de nouvelles molécules. L'anabolisme et le catabolisme nécessitent, dans la plupart des cas, la présence d'enzymes.
Chez tous les organismes, l’anabolisme et le catabolisme sont interdépendants : l’énergie de dégradation du catabolisme est nécessaire à l’élaboration des macromolécules (protéines, acides nucléiques, etc.) produites par l’anabolisme. Ces nouveaux composés peuvent à leur tour entrer dans la chaîne de réactions du catabolisme.
Réactions biochimiques et niveaux d’énergie
Les réactions spontanées
Si les réactifs initiaux possèdent un niveau d'énergie plus élevé que les produits finaux, la réaction chimique peut se déclencher spontanément. Elle s'amorce d'elle-même, tout comme une balle roule jusqu'au pied d'une colline et ne peut remonter que si elle est poussée ou portée jusqu'au sommet, autrement dit, si on lui fournit une quantité d'énergie suffisante.
La différence entre les niveaux énergétiques de l'état initial et de l'état final correspond à l'énergie dissipée dans le milieu ambiant sous forme de chaleur et de travail. Quel que soit le rendement d'une réaction chimique, seul un certain pourcentage de l'énergie libérée au cours de cette réaction est effectivement utilisé pour produire du travail.
Les réactions couplées
Les réactions dites « ascendantes » donnent naissance à des produits dont le niveau énergétique est plus élevé que celui des matériaux de départ ; elles ne peuvent avoir lieu que grâce à un apport énergétique. La cellule fournit cette énergie en synthétisant dans un premier temps un composé à niveau énergétique élevé qui, lorsqu'il est dégradé, libère plus d'énergie qu'il n'en faut pour la réaction ascendante. Le composé le plus fréquemment utilisé est l'ATP.
La synthèse du matériau désiré et la dégradation de l'ATP sont étroitement liées, de sorte que la réaction globale est une réaction « descendante », laquelle est réalisable sur le plan énergétique.
Ce couplage peut avoir lieu grâce à divers mécanismes : supposons que deux substances, A et B, réagissent pour former deux produits, C et D ; si le niveau énergétique de ces produits est plus élevé que celui des substances, la réaction ne peut se déclencher spontanément. Toutefois, si le produit D a la faculté de réagir avec une substance E pour former des substances F et G à un niveau d'énergie bien moindre – c'est-à-dire au cours d'une réaction spontanée –, la quantité d'énergie produite par la deuxième réaction dépasse les besoins énergétiques de la première ; les deux réactions couplées peuvent ainsi se dérouler sans difficulté.
Un système biochimique, quel qu'il soit, évolue naturellement vers un niveau de plus faible énergie. Cette notion a d'ailleurs valeur de généralité et peut être appliquée à n'importe quel système, comme l'expriment les lois de la thermodynamique.
La production d’énergie
Les glucides constituent la principale source d’énergie des cellules, mais les acides gras (principaux constituants des lipides) et les protides peuvent également jour un rôle énergétique important. Trois étapes principales, communes à tous les êtres vivants, conduisent à la production d’énergie : la glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative, couplée à la chaîne respiratoire. Chez les eucaryotes, la première se produit dans le cytosol de la cellule, les suivantes dans les mitochondries ; chez les procaryotes (bactéries), les composants et enzymes de ces différentes voies sont plus dispersés dans la cellule.
Le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative constituent la voie aérobie (qui a lieu en la présence d’oxygène) de production d’énergie dans les cellules. Si l’oxygène vient à manquer, se mettent en place des réactions de fermentations (voie anaérobie).
Les molécules organiques nécessaires à la production d’énergie (dont l’apport continuel est indispensable au maintien de la vie) sont produites par les végétaux grâce à la photosynthèse. Ces derniers fournissent aux animaux qui s’en nourrissent à la fois leurs matériaux de construction et leur carburant.
La glycolyse et la voie des pentoses phosphates
La glycolyse (ou voie Embden-Meyerhof, du nom des scientifiques qui l’ont mise en évidence) est un ensemble de réactions qui permettent la transformation du glucose (ou d’un autre hexose, glucide en C6, à 6 atomes de carbone) en acide pyruvique, ou pyruvate. Ce dernier produit entre ensuite dans la mitochondrie pour y être transformé en acétyl-CoA, incorporé dans le cycle de Krebs, ou bien être utilisé dans des réactions de fermentation anaérobie. Le bilan énergétique de la glycolyse est positif, car il produit deux molécules d'ATP pour une molécule de glucose dégradé en deux molécules d'acide pyruvique.
Les hexoses peuvent également être partiellement décomposés en entrant dans le cycle des pentoses (sucres en C5, comme le ribose, qui joue un rôle dans le métabolisme des glucides). Ce cycle permet, en outre, de produire ou de dégrader les oses (sucres) à cinq carbones dont la cellule a besoin, notamment lors de la synthèse des acides nucléiques.
Le cycle de Krebs
Appelé aussi cycle de l’acide citrique, le cycle de Krebs, mis en évidence en 1937 par le biochimiste britannique sir Hans Adolf Krebs, est la principale source de molécules d’hydrogène.
Le cycle de Krebs comprend neuf constituants, chacun d'eux pouvant en donner un suivant jusqu'à revenir au composé initial (cycle biochimique). Le dernier, une molécule d'oxaloacétate (à quatre atomes de carbone), se condense avec le groupement acétyle (à deux atomes de carbone) de l'acétyl-CoA (produit par la transformation de l’acide pyruvique dans la matrice de la mitochondrie), pour donner naissance au premier constituant du cycle, l'acide citrique (six atomes de carbone).
L'oxaloacétate est régénéré à chaque fin de cycle, prêt à en enchaîner un nouveau. Chaque réaction du cycle de Krebs est catalysée par une enzyme spécifique. À chaque nouveau « tour », les composés à six atomes de carbone donnent des composés à quatre atomes de carbone.
Au cours de cette opération, plusieurs atomes d'hydrogène sont transférés sur un dérivé vitaminique, le NAD, et les deux atomes de carbone éliminés sous forme de dioxyde se retrouvent dans l'air expiré par l'organisme.
Les intermédiaires intervenant dans le cycle de Krebs sont formés soit à partir du glucose, soit à partir de divers acides aminés. Les radicaux acétyles, qui doivent alimenter sans discontinuer le cycle de Krebs, sont obtenus à partir des acides gras ou du glucose. Ainsi, protides, glucides et lipides peuvent être indirectement utilisés dans les réactions du cycle de Krebs aux fins de produire des composés à niveau énergétique élevé. La cellule parvient sans difficulté à maintenir la concentration des métabolites intermédiaires parce qu'ils participent à de nombreuses autres réactions du métabolisme.
La chaîne respiratoire
Certaines réactions chimiques du métabolisme permettent la constitution de composés hydrogénés ayant un très haut niveau énergétique ; c'est le cas des réactions de décarboxylation et de déshydrogénation – qui ont lieu au cours du cycle de Krebs –, de la glycolyse ou de la β-oxydation. Ces transporteurs d'hydrogène, principalement le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD, ou NADH2 dans sa forme hydrogénée) et la flavine adénine dinucléotide (FAD, ou FADH2 dans sa forme hydrogénée), sont susceptibles d'entrer dans un système oxydatif, la « chaîne respiratoire » – qui consomme de l’oxygène –, et de libérer une grande quantité d'énergie.
On trouve sur la membrane intérieure des mitochondries (organites cellulaires dans lesquels a lieu la respiration cellulaire) et en son sein de grosses molécules qui ont la faculté d'alterner rapidement oxydations et réductions. Chaque molécule de NAD, transporteur d'hydrogène, fournit deux électrons et un proton. Le système prend en charge le transfert des électrons tout au long des réactions qui se succèdent ; les protons sont transférés dans la matrice de la mitochondrie avec les premiers composés (la vitamine riboflavine, de nombreux composés à base de fer et de soufre, et une quinone appelée coenzyme Q). Les électrons traversent ensuite une série de cytochromes (molécules structurellement très proches de l'hémoglobine), dont le dernier catalyse la synthèse de molécules d'eau à partir des électrons, des protons et de l'oxygène provenant de l'air respiré par l'organisme (→ respiration). Ces cytochromes ont une affinité croissante pour les électrons, de sorte que les réactions qui se suivent sont toutes descendantes et qu'il y a libération d'une très grande quantité d'énergie.
La phosphorylation oxydative
L'énergie produite le long de la chaîne respiratoire sert à l'établissement d'une liaison chimique entre l'adénosine diphosphate (ADP) et un phosphate non organique (Pi) pour former de l'ATP. En fait, lorsqu'une paire d'électrons parcourt le système de transport d'une extrémité à l'autre, pour être finalement fixée par l'oxygène, la quantité d'énergie captée est assez importante pour permettre la synthèse de trois molécules d'ATP.
Dans les cellules capables d'assurer pleinement leurs fonctions, le transport des électrons est étroitement lié à la phosphorylation oxydative. Ainsi, quand la synthèse d'ATP est inhibée (ce qui peut arriver en cas de carence en Pi, en ADP ou en oxygène), le transport des électrons ne peut avoir lieu. L'ATP synthétisé est utilisé dans toute la cellule pour permettre la plupart des réactions qui consomment de l'énergie.
Chez les vertébrés, certains tissus, notamment les muscles du squelette et le cerveau, disposent d'un stock d'énergie supplémentaire ; il est maintenu en permanence grâce à l'excès d'ATP, utilisé pour former, à partir de la créatine, un autre composé à niveau énergétique élevé, la phosphocréatine (appelée aussi créatine phosphate ou phosphagène). Lorsque le besoin d'ATP apparaît, la phosphocréatine a la faculté de transférer rapidement son groupement phosphate sur l'ADP, reformant ainsi de l'ATP. Les invertébrés procèdent de même à partir de la phosphoarginine.
Les réactions anaérobies
Toutes les cellules ont la faculté de synthétiser de l'ATP en l'absence d'oxygène (réactions anaérobies), par le biais de réactions de fermentation. On désigne le plus souvent les fermentations par le nom des produits terminaux ainsi formés : alcoolique, butyrique, lactique, malolactique, etc.
Comme dans la voie aérobie, le glucose est transformé en acide pyruvique par la glycolyse. L’acide pyruvique est ensuite dégradé sous l’action d’une enzyme, en un produit éliminé par la cellule : acide lactique (ou lactate) dans la fermentation lactique (l’enzyme est la lactate déshydrogénase), éthanol dans la fermentation alcoolique (enzyme : alcool déshydrogénase), etc.
Ainsi, les bactéries du lait en absorbent le sucre et le transforment en acide lactique, au cours d'un processus métabolique qui produit assez d'ATP pour satisfaire les besoins des bactéries. L'acide lactique, éliminé par les cellules bactériennes, rend le lait aigre.
De même, chez les animaux, l'activité musculaire peut se poursuivre, pendant un laps de temps assez court, sans apport d'oxygène ; l'acide lactique produit par la fermentation lactique passe dans le sang. Si la privation d'oxygène dure longtemps, l'acidité bloque toute activité métabolique et la cellule musculaire meurt.
BOTANIQUE
Le métabolisme des végétaux
Contrairement aux animaux, qui tirent de leur alimentation les nutriments et l'énergie dont ils ont besoin, les végétaux fabriquent eux-mêmes, à partir du dioxyde de carbone atmosphérique (CO2), les composés nécessaires à leurs biosynthèses. Ils absorbent dans le sol l'eau, les sels minéraux, l'azote et le phosphore.
La photosynthèse
La photosynthèse est un processus qui utilise l'énergie solaire pour produire des composés organiques, les glucides, et de l'oxygène à partir du gaz carbonique et de l'eau. Chez les plantes vertes, la photosynthèse a lieu dans les chloroplastes, organites situés dans les cellules des feuilles. C’est le pigment qu’ils contiennent, la chlorophylle, qui permet de capter l’énergie lumineuse du soleil.
Les glucides synthétisés par les chloroplastes sont les éléments de base utilisés pour la production des composés de la cellule. Le catabolisme (dégradation) du sucre fournit l'énergie nécessaire au métabolisme des végétaux. (→ photosynthèse.)
Les substances produites par les végétaux
La quasi-totalité des composés végétaux est dérivée, d'une manière ou d'une autre, du glucose produit par photosynthèse. Un végétal est constitué pour l'essentiel de sucres modifiés ou de leurs composés : polysaccharides (cellulose), polysaccharides non cellulosiques (xylanes, mannanes), hémicellulose, pectines, ou lignine des plantes ligneuses.
L'azote végétal provient généralement des nitrates absorbés par les racines. Les nitrates doivent être transformés en ammoniac pour que l'azote soit utilisable lors de la synthèse des protéines. Cette transformation repose sur des réactions déclenchées par le processus oxydant de la respiration.
Les réserves énergétiques
De nombreux végétaux emmagasinent le sucre sous forme de saccharose, mais la plupart d'entre eux le stockent sous forme d'amidon – grosse molécule, moins soluble mais plus stable que le saccharose. Par ailleurs, l'amidon est mis en réserve dans certains types de graines, qui l'utilisent comme nutriment au cours de la germination, dans les jeunes branches, où il fournit l'énergie nécessaire à la croissance des bourgeons, ainsi que dans des tubercules et des racines, pour alimenter la nouvelle pousse.
L'amidon se forme à l'issue d'une série de réactions analogues à celles qui conduisent à la synthèse du glycogène chez les animaux.
Quand les besoins en glucose atteignent un seuil donné, le processus de reconversion de l'amidon végétal en glucose (qui est alors catabolisé par la respiration) s'effectue. Les graisses sont également stockées sous forme de réserves provisionnelles, en particulier dans les fruits et les graines.
PHYSIOLOGIE HUMAINE
Chez l’homme, le métabolisme de base est évalué en mesurant la consommation d’oxygène d’un sujet à jeun, au repos et allongé, à une température « neutre » (18 à 20° pour un sujet habillé). Dans ces conditions, elle est en moyenne de 6 700 kJ (1 600 kcal) par 24 h pour un adulte de 70 kg. Les besoins énergétiques d’un adulte sont variables en fonction de son âge, de son activité physique, de la température extérieure, etc. En moyenne, on estime que les besoins par 24 h sont de 11 000 kJ (2 600 kcal) pour un homme adulte et de 8 500 kJ (2 000 kcal) pour une femme adulte. Les réserves de graisse d’un homme adulte lui permettent de soutenir un jeûne de plusieurs semaines.
Pour en savoir plus, voir l'article dépense énergétique [médecine].
ZOOLOGIE
Le métabolisme des animaux
Les besoins en énergie des animaux sont couverts par l’alimentation : la dégradation des molécules organiques qui constituent les aliments fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’organisme et au renouvellement de ses cellules. Le métabolisme est un processus continu dans la mesure où la brièveté de l'existence des molécules ou des cellules du corps demande leur renouvellement constant, tout en préservant la structure propre du tissu. Ce processus ininterrompu, sans variation sensible de la quantité d'un constituant cellulaire, est connu sous le nom d'« état stationnaire dynamique ».
Besoins et dépenses
Les matériaux de construction essentiels au métabolisme sont le glucose (provenant de la digestion d'hydrates de carbone alimentaires), les acides aminés (cédés par les protéines alimentaires), ainsi que les acides gras et le glycérol (dérivés des graisses). Si la plupart des cellules utilisent en premier lieu les réserves disponibles de glucose, notamment peu après le repas, elles se servent des graisses comme principale source énergétique, quelques heures plus tard ; elles puisent dans les réserves en protéines des tissus du corps à mesure que le jeûne se prolonge.
Le métabolisme de base
Un organisme a besoin d’un minimum d’énergie pour assurer le maintien des fonctions essentielles assurant la vie (respiration, circulation, entretien des cellules, tonus musculaire, activité électrique du cerveau, etc.), en-dehors de toute autre activité. Cette dépense énergétique minimale indispensable représente le métabolisme de base, ou métabolisme basal.
Le terme « métabolisme de base » ne saurait être appliqué aux animaux « à sang froid » (poïkilothermes), du fait du caractère particulier de leur métabolisme. En effet, le métabolisme varie avec la température du corps, or la température de ces animaux (reptiles, amphibiens) dépend de la température ambiante. On parle, à propos de ces animaux, de « métabolisme standard » pour évoquer le métabolisme minimal des sujets en période de jeûne, placés dans des conditions de température déterminées.
Des besoins variables
Le métabolisme d'un animal donné, et ses besoins énergétiques, connaissent des variations importantes dans le temps, et ce en fonction de divers facteurs : l'intensité de l'activité musculaire ; la nature du comportement alimentaire ; la température ; la digestion, la gestation ou la lactation ; le moment de la journée ou la période de l'année ; la période du cycle ovarien chez les mammifères ; ou encore la situation émotionnelle.
La régulation du métabolisme chez les animaux
Chez les animaux, le métabolisme cellulaire, qui maintient les fonctions vitales, doit présenter deux caractéristiques tout aussi importantes : globalité et coordination. Cette dernière condition est satisfaite grâce aux échanges intercellulaires, même entre les cellules situées en deux points du corps éloignés l'un de l'autre.
Chez la plupart des animaux supérieurs, cette communication s'effectue grâce au système nerveux et aux diverses substances messagères. Les plus connues sont les hormones qui, sécrétées dans le sang par les glandes endocrines, circulent dans tout l'organisme. Chaque hormone affecte le métabolisme des cellules possédant les récepteurs spécifiques de cette hormone. Il arrive que les cellules cibles soient celles d'une autre glande endocrine, qui sécrète à son tour une hormone affectant d'autres cellules. Les sécrétions endocrines sont à l'origine de changements métaboliques en de nombreuses régions du corps.
Formant un autre groupe, certaines substances chimiques messagères ont une action spécifiquement locale. Il s'agit des prostaglandines, que l'on rencontre dans tout le corps, mais qui n'affectent généralement que les cellules de la région dans laquelle elles sont déversées.
D'autres messagers locaux exercent une action sur les tissus nerveux, et certaines substances chimiques sont si localisées qu'elles affectent les enzymes de la cellule même dans laquelle elles sont sécrétées.
Les réserves énergétiques
Les nutriments en excès, qui ne sont pas immédiatement utilisés pour répondre aux besoins énergétiques, sont mis en réserve sous forme de glycogène (dans le foie et les muscles squelettiques) et de triglycérides (graisses) dans les tissus adipeux. Chez les vertébrés, les sucres en excès peuvent être convertis rapidement en graisses, mais l'inverse n'est pas possible.
Chez les mammifères, près de 50 % du glucose sont généralement complètement dégradés en dioxyde de carbone et en eau (oxydation), tandis que 5 % deviennent du glycogène et que 30 à 40 % sont convertis en graisses. Les hydrates de carbone emmagasinés sous forme de glycogène suffisent pour répondre aux besoins énergétiques pendant quelques heures seulement, tandis que les réserves de graisse permettent de pallier une absence de nourriture pouvant se compter en jours ou en semaine selon l’espèce.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
