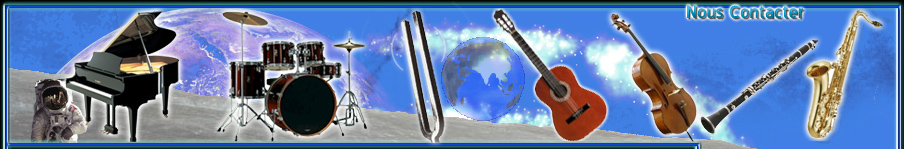|
|
|
|
 |
|
LES SOLS |
|
|
| |
|
| |
sol
Couche superficielle de l'écorce terrestre considérée quant à sa nature ou à ses qualités productives.
Formation naturelle de surface, meuble, résultant de la transformation, au contact de l'atmosphère, de la roche mère sous-jacente, sous l'influence des processus physiques, chimiques et biologiques.
Le sol se caractérise par un ensemble de couches, ou horizons, qui traduisent la dynamique de sa formation.
1. Les types de sols et leur répartition
De par le monde, il existe de très nombreuses variétés de sols, plus ou moins fertiles, que l'on regroupe en grandes classes fondées sur la prédominance d'un ou de plusieurs processus génétiques.
À l'échelle de la planète, la répartition des zones de sols suit assez bien celle des climats. Les principaux facteurs qui président à la formation d'un sol à partir d'une roche mère étant l'eau et la chaleur, les différents types de sols vont donc suivre une zonation thermique (péripolaire), sensiblement latitudinale, et une zonation hydrique (péridésertique), qui dessine des auréoles centrées sur les déserts. Ainsi, les régions froides et les régions sèches sont celles qui possèdent les sols les moins évolués.1.1. Sols peu ou pas évolués
Cette classe regroupe tous les sols caractérisés par un faible degré d'évolution et d'altération et un taux de matière organique limité. Elle comprend d'une part des sols dont le climat, trop sec ou trop froid, ne permet qu'une désagrégation mécanique de la roche, et d'autre part les stades initiaux de certains types de pédogenèse en climat plus chaud ou plus humide.
Les sols de désert sont pratiquement dépourvus de matière organique. La forte amplitude thermique entre le jour et la nuit conduit à une fragmentation extrême et le vent trie les particules :
roche [réaction] = sol caillouteux (reg) [réaction] = sol sableux (erg) [réaction] = sol à texture argileuse (takyr).
Les sols de régions polaires (sols de toundra) se caractérisent par un horizon plus ou moins profond, gelé en permanence ; la fragmentation et le tri s'effectuent sur place sous l'action du gel.
Les sols peu évolués des zones plus chaudes ou plus humides (alluviaux, glaciaires, éoliens de type loess, etc.) résultent généralement d'apports de matériaux par l'eau, la glace ou le vent.
1.2. Sols bruns et sols bruns lessivés
Ce sont notamment les sols des forêts et des prairies des régions tempérées. Ils offrent un profil constitué de trois horizons bien différenciés (A, B et C). L'humus de l'horizon superficiel (A) est bien minéralisé (mull), et l'horizon intermédiaire (B) est coloré en brun par des oxydes de fer. Dans le cas de sols lessivés, cet horizon se scinde en deux : un niveau plus clair, appauvri, surmonte un niveau beaucoup plus coloré, enrichi. L'horizon C, le plus profond, présente une faible altération de la roche brute. Ces sols se forment sur n'importe quelle roche à condition que leur composition soit favorable à la « brunification ». Certains se révèlent très propices au développement de l'agriculture, d'autres pas, qui renferment des éléments toxiques (aluminium, manganèse) et dont les cycles de l'azote et du phosphore sont défectueux.
1.3. Sols isohumiques, ou tchernozems
Ils sont très développés dans les steppes semi-arides à climat continental (Roumanie, Ukraine, Chine, Argentine), où les précipitations, quoique peu abondantes, sont relativement régulières : l'alternance du lessivage en période de pluie et des remontées capillaires en périodes sèches interdit la formation d'horizons d'accumulation. Le profil du sol est envahi de façon homogène par de l'humus bien minéralisé de type mull. Lorsque ces sols sont irrigués, les cultures y sont très riches.
1.4. Sols à humus brut, ou podzols
En présence d'eau, la matière organique, non minéralisée, fortement acide, attaque et détruit les argiles. L'alumine et le fer entraînés, il reste un horizon noir cendreux, purement siliceux, surmontant un horizon d'accumulation humique et ferrugineux. Les podzols sont surtout développés sur des roches siliceuses et se rencontrent là où la température moyenne est comprise entre 0 et 8 °C et où les précipitations sont supérieures à 500 mm par an (Russie, Suède, Pologne). Les cultures sont d'autant meilleures que le degré de lessivage est faible ; ce sont donc essentiellement des sols à vocation forestière.
1.5. Sols rouges à oxydes
Ce sont les sols rouges méditerranéens, les sols fersiallitiques tropicaux et les sols ferrallitiques. Ils se développent sur n'importe quelle roche suffisamment riche en fer (d'où leur coloration) et dans un milieu bien drainé. Naturellement peuplés de forêts (méditerranéenne, tropicale ou équatoriale) ou de prairies, ils caractérisent les régions à température et pluviométrie élevées, avec une alternance très marquée des saisons humides et sèches. Les processus d'hydrolyse et d'oxydation sont poussés à l'extrême. Ce sont généralement des sols anciens, au profil très épais (de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres de profondeur), fertiles mais très sensibles à la dégradation anthropique (autrement dit, due à l'activité humaine), au feu et à l'érosion.
La déforestation des sols ferrallitiques provoque une induration de la surface (croûte latéritique, ou cuirasse, riche en fer et en alumine) qui peut atteindre plusieurs mètres et sur laquelle rien ne pousse. En revanche, les cuirasses constituées de minerai d'aluminium (bauxite) offrent un intérêt industriel. En bas de pente et dans les dépressions mal drainées, les sols rouges cèdent le pas à des vertisols, caractérisés par l'abondance d'argiles gonflantes (montmorillonites), une faible quantité d'humus et une coloration noire, sur lesquels la culture est difficile car ils se rétractent en saison sèche et durcissent énormément.
1.6. Des sols particuliers
Les sols décrits ci-après ne se répartissent pas suivant une zone climatique à proprement parler, mais dépendent de conditions locales bien spécifiques.
1.6.1. Sols calcimorphes, ou rendzines
Bien qu'on ne rencontre ces sols qu'en région tempérée (au sens large), leur répartition suit celle de leur roche mère. Ils présentent un profil à deux horizons (A et C) et se forment à partir d'un substratum calcaire. Celui-ci subsiste à l'état de fragments dans une matière argileuse, sombre à rougeâtre, suivant le climat, et bien structurée. L'horizon A est abondamment colonisé par les racines des végétaux (forêts, arbustes calcicoles et « pelouses calcaires »). La faible épaisseur de ces sols les rend impropres à la culture, mais on peut les mettre en valeur par des plantations de conifères qui, par leur humus acide, favorisent l'approfondissement du profil (cas des Landes en France).
1.6.2. Sols hydromorphes, ou sols aqueux
On les rencontre dans les zones saturées d'eau en permanence ou presque. Des phénomènes de ségrégation locale et de réduction (sulfates en sulfures, fer ferrique en fer ferreux), liés à la saturation qui entraîne un déficit en oxygène, y sont observés. Les sols hydromorphes se divisent en deux groupes : les tourbes, issues d'une dégradation très lente des végétaux hydrophiles qui les colonisent, et les gleys, plus ou moins humifères, à trois horizons (A, B, C), de structure généralement massive. Ils sont constitués d'argiles gris-vert ou vert-bleu, colorées par des dépôts de fer ou présentant un horizon noirâtre (concentration de fer insoluble) sous l'horizon de surface. Dans tous les cas, ce sont des sols peu favorables aux cultures, et leur mise en valeur par drainage est délicate.
1.6.3. Sols halomorphes, ou sols salins
Ils se développent dans les régions salées, en bordure des mers actuelles (Camargue) ou anciennes (Russie méridionale) et dans les endroits où s'accumulent des alluvions apportées par les rivières traversant des zones salées (chotts). En général, le sel entraîne les argiles. Le sol est massif, mal drainé, et supporte une végétation halophile, ou bien de type mangrove quand le milieu est plus humide et plus chaud. Dans certains cas, un bon drainage ou des endiguements (polders) permettent de livrer les sols faiblement salés à l'agriculture.
2. Le sol, l'eau et les plantes
Le sol, l'eau et la végétation sont étroitement liés. De fait, l'eau que reçoit le sol conditionne la plupart des processus de pédogenèse. Et le sol sert de zone de transition à l'eau de pluie avant de rejoindre les nappes aquifères ou les cours d'eau. Enfin, l'eau stockée intervient dans la nutrition des plantes.
2.1. L'importance de l'eau dans les sols
Lorsque la pluie pénètre dans le sol, elle échange avec le milieu des éléments minéraux et organiques (calcium, potassium, sodium, magnésium, aluminium, sulfates, chlorures, composés azotés, phosphates, fluor, silice, acides humiques et fulviques, gaz carbonique et oxygène dissous). En fait, comme la pluie est généralement beaucoup plus pauvre que la matrice du sol, l'eau s'enrichit au détriment du milieu. L'importance de cet enrichissement dépend du temps de résidence de l'eau.
À la faveur des pentes ou lorsque le milieu est saturé, l'eau devient mobile et circule dans les pores grossiers et moyens, interconnectés.
On distingue deux grands types de circulation. La première suit une direction transversale et parallèle à la surface du sol. L'eau chemine à travers les horizons superficiels et rejoint finalement les cours d'eau. Dans la seconde, l'eau est entraînée verticalement par la pesanteur (eau libre ou eau de gravité) et alimente les nappes aquifères. Cependant, toute l'eau ne s'écoule pas : une partie reste piégée par les pores fins, grâce aux forces capillaires (forces de rétention, ou de succion) qui s'opposent aux forces de gravité. Or cette quantité d'eau, dénommée « eau hygroscopique » ou « eau adsorbée », est, dans les conditions naturelles, très difficile à extraire, et les racines ne peuvent utiliser que l'eau non adsorbée contenue dans les pores fins.
2.2. Les nutriments
L'eau du sol fournit donc aux végétaux les nutriments dont ils ont besoin sous forme de solutions minérales. On distingue les nutriments de base, que les végétaux consomment en quantités importantes (azote, phosphore, soufre, calcium, magnésium, potassium) et les nutriments secondaires, éléments-traces (ou oligoéléments) indispensables à faible dose (fer, manganèse, cuivre, zinc, bore, molybdène), mais qui peuvent se révéler toxiques lorsqu'ils sont trop abondants. La silice, souvent absorbée en forte quantité, n'est pas considérée comme un nutriment car elle n'est pas indispensable à la vie végétale. Par ailleurs, les processus de minéralisation et de dissolution s'exercent sans distinction entre les éléments favorables ou indispensables à la vie d'une plante et ceux qui ne le sont pas. De plus, les racines ne sont pas capables de sélectionner puis d'éliminer ceux qui ont une action négative. L'eau du sol peut donc apporter aussi aux plantes des substances toxiques, tels l'aluminium des sols acides ou certains éléments provenant de déchets industriels, comme le plomb, le mercure, le cadmium. Les conséquences diffèrent selon la concentration et le degré de toxicité des substances. Les éléments nocifs peuvent tuer la plante, ou simplement ralentir sa croissance, gêner son développement, ou encore n'avoir aucune influence. La plante les emmagasine alors dans ses tissus, et la toxicité se propage aux êtres vivants qui consomment les végétaux ou à d'autres situés plus loin encore dans les chaînes alimentaires.
3. Les sols sont fragiles
Le sol est fragile et ne se reconstitue pas facilement. S'il faut un siècle au moins pour former 1 cm de sol à partir de la roche mère, sa dégradation, en revanche, est très rapide. Les activités humaines entraînent bien souvent une détérioration des propriétés physiques des sols et un accroissement de l'érosion naturelle.
3.1. La dégradation des sols
La dégradation rapide intervient souvent après le défrichement ou le déboisement et la mise en culture. Certaines pratiques comme les cultures de pentes sans aménagement, le surpâturage, la surexploitation, la suppression des haies et du couvert forestier, ou bien encore une mauvaise irrigation, sont causes de désertification à plus ou moins longue échéance.
La dégradation commence par la structure du sol et se poursuit par des processus d'érosion. Les agrégats du sol sont détruits par un émiettement très poussé (provoqué par les engins mécaniques), par le piétinement du bétail (tassement de l'horizon de surface), par un mauvais travail du sol, qui accélère la minéralisation et le départ de la matière organique – toujours accompagné d'une diminution de la stabilité de la structure –, ou par l'action de pluies violentes succédant à une période sèche. Souvent ces causes cumulent leurs effets. Parfois, l'intégralité du profil est affectée par une « prise en masse » (perte de porosité et de matière organique).
3.2. L'érosion des sols
Un sol fragilisé offre alors une prise à une érosion pluviale ou à une érosion éolienne (ou aux deux), selon les conditions climatiques. Il se produit un décapage des horizons de surface et parfois même de la totalité du profil. La matière organique et les particules fines sont entraînées les premières. En conséquence, la faune et la microflore disparaissent. La structure du sol devenant de plus en plus compacte, les pluies ne parviennent plus à reconstituer les réserves en eau de sol ni à alimenter les nappes aquifères profondes. L'érosion peut avoir de graves effets sur la fertilité des sols et le régime des eaux, voire aboutir à la désertification.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
CLIMAT : PASSÉ ET AVENIR |
|
|
| |
|
| |
CLIMAT : PASSÉ ET AVENIR
* 1. Les climats du passé
* 1.1. Le paradoxe du « Soleil faible »
* 1.2. Le mouvement des continents
* 1.3. Alternances glaciaires et interglaciaires
* 2. Les climats d'hier
* 2.1. Le recul des glaces
* 2.2. L’avènement de l’homme
* 2.3. Le climat contemporain
* L'augmentation des températures
* L'eau atmosphérique
* La circulation générale atmosphérique
* Les événements extrêmes
* 3. Les climats de l'avenir
* 3.1. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (G.I.E.C.)
* 3.2. La conférence de Rio (1992)
* 3.3. Le protocole de Kyoto (1997-2005)
* 3.4. Le renforcement anthropogène de l'effet de serre
* 3.5. Les conséquences d'un réchauffement global
* 3.6. Comment maîtriser notre avenir climatique ?
1. Les climats du passé
1.1. Le paradoxe du « Soleil faible »
L’histoire de notre planète s'étend sur plus de quatre milliards d'années. Les astrophysiciens nous disent que le Soleil est devenu graduellement plus lumineux pendant cette période, et qu'il devait être sensiblement plus faible (de 30 % ?) il y a 3,8 milliards d'années. Pourtant, les indices géologiques montrent que l'eau existait bien sous forme liquide à cette époque, que la Terre n’était pas complètement couverte de glaces, qui auraient d'ailleurs empêché son réchauffement vers l'état présent. Même si une révision de la théorie de l'évolution solaire pourrait l'affaiblir, ce « paradoxe du Soleil faible » souligne l'importance des processus propres à la Terre dans la détermination de ses climats. On sait que l'atmosphère contenait davantage de gaz carbonique dans un passé très lointain, et donc que l'effet de serre devait être plus fort.
1.2. Le mouvement des continents
Sans remonter aussi loin, et en ne considérant que les derniers 300 millions d'années, on sait que les continents n'ont pas toujours occupé la situation qu'ils occupent aujourd'hui, et que l'atmosphère et la vie ont évolué, avec des climats la plupart du temps plus chauds qu'aujourd'hui.
L'analyse des rapports isotopiques dans les sédiments marins nous apprend que le climat s'est progressivement rafraîchi depuis 55 millions d'années, que les calottes glaciaires ont commencé à apparaître il y a environ 40 millions d'années, ce qui correspond à l'époque du soulèvement de l'Himalaya et du plateau du Tibet. À près de 5 000 mètres d'altitude en moyenne, ce plateau modifie la circulation de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne la mousson d'Asie. De plus, ces reliefs ont fait augmenter l'érosion physique et chimique, ce qui conduit à une diminution de la teneur atmosphérique de CO2, donc à un affaiblissement de l'effet de serre.
1.3. Alternances glaciaires et interglaciaires
Si nous ne considérons maintenant que le passé récent, le dernier million d'années, avec les continents et les reliefs sensiblement disposés comme aujourd'hui, nous constatons encore des changements climatiques de grande ampleur : avancées et reculs quasi cycliques des glaciations, aux périodes caractéristiques de – 100 000, – 40 000 et – 20 000 ans. Celles-ci se retrouvent également dans les variations des paramètres de l'orbite et de la rotation de la Terre étudiées notamment par Milutin Milankovitch avant 1940, mais l'on n'arrive pas à expliquer toute l'ampleur des variations climatiques à partir des seules variations astronomiques, sans invoquer des mécanismes d'amplification.
Nos connaissances des variations climatiques ont beaucoup avancé avec les progrès de l'analyse isotopique et l'extraction de carottes de glaces du Groenland et de l'Antarctique. La carotte de glace de la station soviétique de Vostok, en Antarctique, analysée par l'équipe de Grenoble, représente 160 000 ans d'histoire climatique. En plus des variations dans la température et dans le volume global des glaces, révélées par l'analyse des rapports deutérium/hydrogène et oxygène16/oxygène18 dans la glace même, on a su extraire – sans les contaminer – des bulles d'air piégées à ces différentes époques. Les variations mesurées dans les teneurs atmosphériques de CO2 et de méthane, deux gaz contribuant à l'effet de serre, suivent les variations de la température.
Pour étudier la « mémoire » du climat, les climatologues disposent ainsi de différents types de données (les « proxy » données) :
– la composition isotopique de l'oxygène, du carbone et du deutérium présents dans les sédiments lacustres ou océaniques, les glaciers ou les calottes polaires, les cernes des arbres, les strates géologiques, les stalactites, etc. ;
– des indicateurs de la faune ou de la flore du passé (plantes et pollens fossiles, animaux marins ou aquatiques, …) ;
– des indicateurs géologiques ;
– des données historiques (dates et volume des récoltes, dates des semis, des disettes, …).
Le tableau ci-après précise les caractéristiques principales des méthodes les plus utilisées.
LES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES UTILISÉES POUT L'ÉTUDE DES CLIMATS DU PASSÉ
Type d'archives naturelles Résolution temporelle Période couverte (années) Paramètres climatiques déduits (signification des lettres en bas de tableau)
Pollens
Carottes océaniques
Carottes de sol
Dépôts lœssiques
Roches sédimentaires
Carottes de glace polaire
Carottes de glace de montagne
Sédiments lacustres
Dépôts coralliens
Cernes des arbres
Données historiques 1 000 ans
100 ans
100 ans
10 ans
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
an-saison
jour-heure 100 000
10 000 000
100 000
5 000 000
10 000 000
400 000
1 000
1 000 000
100 000
10 000
1 000 T,H,B
T,Ce,B,M
T,H,Cs,V
H,Cs,B,M
H,Cs,V,M,O
T,H,Ca,B,V,M,AS
T,H,B,V,M,AS
T,B,M
T,Ce,O
T,H,Ca,B,V,M,O,AS
T,H,B,V,M,O,AS
T = Température ; H = Humidité ; C = composition chimique de l'air (a), de l'eau (e), des sols (s) ; B = biomasse ; V = indicateurs d'éruptions volcaniques ; M = Champ magnétique ; O = niveau des océans ; AS = activité solaire
Toutefois, malgré ces outils, de nombreuses questions se font jour, notamment celle de savoir comment faire la part entre cause et effet dans cette corrélation entre le climat et la composition de l'atmosphère. De nombreux chercheurs pensent qu'un refroidissement et des conditions moins humides conduisent – en modifiant les échanges entre biosphère et atmosphère – à une diminution de la quantité de ces gaz dans l'atmosphère, cette diminution à son tour affaiblissant l'effet de serre. L'inverse se passe une fois un réchauffement amorcé. Cause et effet se renforcent alors dans ce que l'on appelle une boucle de rétroaction positive, même si le phénomène astronomique est la cause initiale de la variation.
2. Les climats d'hier
2.1. Le recul des glaces
Le dernier maximum glaciaire est tout récent : − 18 000 ans. À cette époque, les glaces couvraient une grande partie de l'Europe du Nord, du Canada et des États-Unis. Le niveau de la mer était plus bas d'une soixantaine de mètres. En Afrique, le Sahara était bien plus étendu qu’aujourd’hui.
Il y a une douzaine de milliers d'années est apparu le réchauffement. Les glaces se retirent, la mer monte, isolant l'Angleterre du nord de l'Europe et l'Indonésie de l'Asie du Sud-Est. En Europe et en Amérique, la végétation change, les forêts avancent vers le nord. Ces changements plurimillénaires se trouvent enregistrés dans les pollens piégés dans les tourbières. En Afrique, le Sahara se rétrécit, laissant des dunes fossiles présentes aujourd’hui dans le Sahel.
Le réchauffement se poursuit, mais s'interrompt brutalement (en quelques décennies seulement), il y a 11 000 ans, et pendant plusieurs siècles les glaces avancent de nouveau en Écosse. Ensuite, tout aussi brutalement, le réchauffement reprend. Ces fluctuations peuvent dépendre de la chaleur transportée vers l'Atlantique Nord par la circulation profonde des océans. Un afflux massif d'eau douce, provenant de la fonte des glaces sur le Canada, aurait arrêté la plongée d'eaux froides salées dans l'Atlantique Nord, ralentissant le flux d'eaux chaudes venant du sud.
2.2. L’avènement de l’homme
Par la suite, depuis quelque 8 000 ans, l'homme modifie la planète à grande échelle, exterminant (sauf en Afrique) les autres grands prédateurs, étendant l'agriculture et l'élevage, domestiquant progressivement la biosphère. Cette évolution se fait au cours d'une période de stabilité – toute relative – du climat. Il y a cependant eu des fluctuations climatiques :
– une période un peu plus chaude il y a 5 000 ans, avec un niveau de mer 4 mètres plus haut qu'aujourd'hui (le Déluge ?) ;
– une période moins sèche dans le Sahara ;
– l'« optimum médiéval », qui a permis aux Vikings de peupler l'Islande et d’aller jusqu'au Groenland et en Amérique du Nord ;
– le « petit âge glaciaire » des xviie et xviiie s. ;
– depuis, un petit réchauffement, mais les xixe et xxe s. sont surtout marqués par le développement industriel et l'explosion démographique, dont l’impact sur le climat s’avèrent significatif.
2.3. Le climat contemporain
Depuis le début du xxe s., la Terre est sujette à un réchauffement global, auquel se superposent des variations régionales dues à des modifications de la circulation atmosphérique et océanique de plus haute fréquence (interannuelles à multidécennales), telles que celles qui sont associées à l'ENSO (El Niño Southern Oscillation) et à la NAO (North Atlantic Oscillation). Il ne faut surtout pas confondre les deux effets.
L'augmentation des températures
La température moyenne à la surface de la Terre s'est élevée de 0,6 °C depuis la fin du xixe s., avec quelques exceptions comme au sud-est des États-Unis, au nord de la Scandinavie et de la Russie voisine, qui se sont refroidis.
Ce réchauffement est intervenu essentiellement pendant deux périodes (de 1910 à 1945, et de 1976 à nos jours), principalement aux moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère Nord en hiver et au printemps, en conjonction pour ce qui concerne l'Europe avec la phase positive de l'oscillation nord-atlantique (NAO) qui persiste depuis 1972 et qui a atteint une phase maximale entre 1985 et 1998.
La période 1946-1975 a pour sa part été associée à un refroidissement de la majorité de l'hémisphère Nord, alors que l'hémisphère Sud continuait globalement de se réchauffer faiblement.
À l'échelle globale, les dix années les plus chaudes se sont produites depuis 1981, dont sept dans les années 1990, avec une exception marquante, le refroidissement (chiffré à 0,2 °C) résultant des grandes quantités d'aérosols émises par l'éruption du volcan Pinatubo (Philippines) en 1991, dont les effets radiatifs se sont manifestés jusqu'en 1993. L'année 1998 est considérée comme la plus chaude du deuxième millénaire, ou du moins depuis 1400. Les deux hémisphères se sont réchauffés de la même façon depuis 1860, mais l'hémisphère Nord s'est réchauffé deux fois plus vite pendant les deux périodes 1910-1945 et 1976-1999.
Sur les continents, les températures minimales ont, de manière générale, tendance à augmenter deux fois plus vite que les températures maximales (avec des exceptions, par exemple en Europe centrale ou en Nouvelle-Zélande, où elles augmentent de la même façon). De ce fait, l'amplitude diurne de température diminue. Les taux de réchauffement les plus importants sont observés aux moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère Nord.
En altitude, on note aussi une évolution des températures : dans la troposphère, aux latitudes moyennes, le réchauffement (de l'ordre de 0,3 °C depuis 1958) se fait surtout sentir jusqu'à 1,5 km, puis il est sensiblement nul jusqu'à 8 km. Au-delà, on observe un refroidissement. Dans la basse stratosphère, le refroidissement est de l'ordre de 0,5 °C par décennie, de 0,8 °C vers 30 km et de 2,5 °C vers 50 km, ce qui est cohérent avec l'augmentation de la teneur en gaz à effet de serre et la diminution de l'ozone stratosphérique.
Ce réchauffement a pour conséquence des périodes hors gel plus longues, un retrait important de la majorité des glaciers, à quelques exceptions près au voisinage de certaines côtes, où l'avancée des glaciers résulte d'une augmentation des précipitations hivernales (Nouvelle-Zélande, Norvège par exemple), une couverture neigeuse plus faible, une diminution de la glace de mer dans l'Arctique au printemps et en été et une élévation moyenne du niveau des océans de 1 à 2 mm/an.
La température de surface des océans présente des variations similaires à celles observées au-dessus des continents.
Cette modification des températures observée au xxe s. est considérable sur une aussi courte période. Après la dernière grande glaciation d'il y a 110 000 ans, le climat global a été soumis à une série d'oscillations, dont les deux les plus proches de nous ont conduit à une période froide ayant son apogée vers 18 000 ans avant J.-C., avec une température globale inférieure de 5 °C à ce qu'elle est aujourd'hui, et un niveau de la mer plus bas de 120 m. La Manche n'existait pas, et les glaciers alpins arrivaient jusqu'à Lyon. En Scandinavie, l'épaisseur de glace se chiffrait sans doute en kilomètres.
La déglaciation qui a suivi a été progressive, et est arrivée à son terme vers 5000 avant J.-C., avec en Europe des étés plus chauds (de l'ordre de 2 °C) et des hivers plus froids qu'aujourd'hui. Il en est résulté une remontée des océans de 100 m en 10 000 ans. Des variations de la température globale de quelques degrés ont donc des conséquences très importantes.
L'eau atmosphérique
L'augmentation des précipitations globales au cours du xxe s. n'excède pas 1 à 2 %, ce qui est très faible. Cette valeur recouvre toutefois de fortes disparités :
– précipitations accrues (+ 5 à 10 %) aux moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère Nord, et aux latitudes moyennes de l'hémisphère Sud, particulièrement en automne et en hiver. En Europe, les sécheresses hivernales qui affectent le pourtour méditerranéen et les conditions plus humides que la normale qui prévalent au nord de l'Europe et de la Scandinavie depuis le milieu des années 1970 sont attribuées à la phase positive de l'oscillation nord-atlantique ;
– pas de tendance marquée sur l'hémisphère Sud ;
– déficit datant du début des années 1970 dans les zones tropicales et subtropicales. En particulier, une réduction brutale est intervenue entre l'équateur et la latitude 35 ° N., de l'Afrique jusqu'en Indonésie.
Depuis le début du xxe s., on note par ailleurs une augmentation de quelques pour cent de la couverture nuageuse sur les continents, bien corrélée en général à la réduction de l'amplitude diurne de température.
Depuis 1970, on enregistre aussi, dans de nombreuses zones de l'hémisphère Nord, une augmentation de l'humidité relative de quelques pour cent par décennie, cohérente avec l'augmentation de température.
La circulation générale atmosphérique
La variabilité interannuelle dans le Pacifique est dominée par l'oscillation australe (ENSO) dont El Niño (anomalie chaude de température de l'océan Pacifique tropical est) et La Niña (anomalie froide dans la même région) constituent les deux événements extrêmes, survenant avec des périodes de récurrence privilégiées de 2 à 7 ans. Il semble que l'oscillation australe présente un comportement atypique depuis le début 1976-1977 (événements se produisant avec des indices ENSO faibles, rareté des Niña, récurrence plus grande des événements chauds type El Niño).
Dans l'Atlantique nord, c'est l'oscillation nord-atlantique (NAO) qui domine, et qui modifie également profondément les circulations atmosphérique et océanique. Elle influence la trajectoire des dépressions atlantiques en favorisant dans la phase positive que l'on a connue depuis 1970 le renforcement des régimes zonaux aux latitudes moyennes de l'Atlantique nord. Y sont associés : un refroidissement de l'océan Atlantique dans l'hémisphère Nord, des hivers froids sur l'Atlantique nord-ouest, chauds et secs sur l'Europe. La variabilité quasi biennale dominante jusqu'en 1970 a, depuis, cédé la place à une variabilité quasi décennale (6-10 ans).
Les événements extrêmes
Qu'elles soient brèves ou prolongées, les catastrophes climatiques sont des phénomènes à caractère irrégulier ou accidentel. Il ne faut pas les confondre avec les extrêmes climatiques, qui sont des phénomènes habituels. Dans la région de Verkhoïansk (Sibérie orientale), par exemple, les températures inférieures à – 60 °C sont fréquentes en hiver. Dans la région du Cherrapundji (Bengale), il tombe généralement plus de 10 m d'eau par an. Les espèces vivant dans ces zones se sont adaptées à ces situations extrêmes. En revanche, les anomalies climatiques créent des situations exceptionnelles, qui déclenchent des catastrophes entraînant, dans les régions peuplées, de profonds bouleversements socio-économiques.
La pluie : déficit ou excès
Les déficits pluviométriques prolongés surviennent de façon irrégulière, causant des catastrophes importantes. La sécheresse des années 1968-1988 en Afrique sahélienne, par sa rigueur et sa persistance, a profondément affecté l'agriculture et l'élevage. 100 000 personnes en sont mortes entre 1973 et 1974 dans Sahel (du Tchad au Sénégal) et 60 000 entre 1982 et 1983 en Éthiopie. Cette sécheresse a contraint des millions de personnes à migrer vers des régions méridionales plus humides. D'autres régions situées entre les tropiques sont aussi touchées irrégulièrement par les sécheresses (Australie, Inde, Indonésie, sud de l'Afrique tropicale, etc.). En région tempérée, le déficit pluviométrique prolongé perturbe l'économie agricole et impose parfois un strict rationnement de l'eau (France, 1976). La sécheresse multiplie aussi les risques d'incendie de forêts et de landes.
Les fortes précipitations accidentelles sont à l'origine des inondations, qui entraînent souvent la mort de milliers de personnes. Elles peuvent toucher de nombreuses régions du monde, mais celles qui ravagent les régions peuplées de l'Inde et de la Chine sont les plus meurtrières. Durant l'été 1959, les inondations du nord de la Chine ont tué deux millions de personnes et celles du fleuve Yangzi Jiang, en 1931, ont fait un million de morts. Les régions tempérées ne sont pas épargnées, mais les pertes humaines sont rarement aussi lourdes (457 victimes à Lisbonne en novembre 1967). Dans les régions tempérées, les chutes de neige excessives provoquent des avalanches en montagne (5 000 morts dans la région de Huars au Pérou en 1941), et peuvent paralyser le trafic routier en plaine.
Le vent : tempêtes, tornades et cyclones
Les tempêtes des régions tempérées, c'est-à-dire situées entre 35 et 70° de latitude, constituent un grand danger pour la navigation. La vitesse du vent en hiver peut atteindre 200 km/h. Dans les régions tropicales désertiques, les tempêtes transportent des milliers de tonnes de sable et sont responsables d'ensevelissements désastreux.
Les cyclones tropicaux, par la violence de leurs vents tourbillonnaires soufflant à plus de 200 km/h, sont à l'origine des plus importants dégâts et pertes humaines.
Les tornades et les trombes ont un caractère beaucoup plus local (diamètre : 100 à 1 000 m ; trajectoire : quelques kilomètres), mais les vents tourbillonnaires y sont aussi forts que dans les cyclones. C'est aux États-Unis qu'on en a observé le plus grand nombre (environ 1 000 par an), particulièrement dans le Middle West. Cependant, les tornades ne sont pas limitées au seul continent américain. Elles peuvent aussi se produire en Europe, en Inde, au Japon, en Afrique du Sud et en Australie.
La température : l'action du froid excessif
L'arrivée d'air polaire, en hiver, sur les régions tempérées (vague de froid de janvier 1971 en Espagne, par exemple), néfaste pour la vie animale et végétale, perturbe la vie des populations humaines et entraîne une augmentation de la facture énergétique. Les coups de froid tardifs au printemps sont préjudiciables à l'agriculture. Le froid excessif entraîne l'extension de la banquise et le gel des cours d'eau, bloquant ainsi des voies navigables.
El Niño : un dérèglement climatique aux conséquences catastrophiques
Le phénomène d'El Niño apparaît environ tous les 5 ou 6 ans (à la différence des autres anomalies climatiques, plus irrégulières), vers Noël – d'où son nom espagnol de « Corriente del Niño » (courant de l'Enfant-Jésus). Il s'agit d'un réchauffement du sud-est de l'océan Pacifique, bien connu des pêcheurs péruviens car il fait fuir les anchois, ruinant la pêche et induisant une mortalité élevée des oiseaux. Il s'accompagne de pluies torrentielles sur les régions côtières habituellement très sèches et de nombreux dérèglements climatiques.
La circulation atmosphérique perturbée
En temps normal apparaissent des remontées d'eau froide venant des fonds de l'océan (upwellings), et les vents d'est (alizés) soufflent vers l'ouest du Pacifique, se chargeant progressivement de vapeur d'eau. En arrivant sur l'Indonésie, ces vents libèrent leur humidité et il pleut beaucoup sur cette région. Cette circulation de l'atmosphère est connue sous le nom de cellule de Walker, en hommage à sir G. T. Walker, qui a démontré son existence en 1923. D'autres cellules, partiellement liées à celle du Pacifique, existent sur les autres régions intertropicales.
Lors d'un événement « El Niño » (encore appelé ENSO, El Niño Southern Oscillation), l'eau est plus chaude au large du Pérou, et la cellule de Walker est moins marquée. Elle peut même fonctionner en sens inverse, comme ce fut le cas en 1982-1983. Un vent d'ouest s'établit alors sur le Pacifique, les pluies sont abondantes sur l'ouest de l'Amérique du Sud et faibles sur l'Indonésie. Cette anomalie dure plusieurs mois ; elle entraîne une perturbation majeure de la circulation atmosphérique méridienne et un dérèglement climatique dont les conséquences sont dramatiques. Les origines de « El Niño » font encore l'objet de polémiques, car les relations entre l'océan et l'atmosphère ne sont pas suffisamment élucidées. Il est vraisemblable que tous ces phénomènes sont connectés.
Les catastrophes climatiques liées à El Niño en 1982-1983
Catastrophes climatiques liées à « El Niño » en 1982-1983
La fin de l'année 1982 et le début de l'année 1983 ont été marquée par nombreuses catastrophes climatiques liées à « El Niño » :
– Philippines : sécheresse dans le sud du pays ;
– Indonésie : sécheresse ;
– Polynésie : cyclones ;
– Pérou (nord du pays) : 3 m d'eau en six mois et la Chosica détruite par un torrent de boue ;
– Salvador : cyclone sur le littoral ;
– Brésil : pluies diluviennes ;
– Argentine : 20 000 km2 de terres inondées ;
– États-Unis : tempêtes et fortes précipitations dans l'Utah, tornades dans l'est du Texas. Le Mississippi déborde et inonde 240 000 ha de terres ;
– France : tempête. Inondations dans le Sud-Ouest et dans la vallée de la Saône ; inondation dans le Pays basque ;
– Afrique : très grande sécheresse dans toute la région du Sahel et en Éthiopie ;
– Inde : sécheresse sur une zone où vivent 260 millions de personnes ;
– Australie : sécheresse et tempêtes de sable ;
– Japon : cyclone ;
– Chine : inondations dans le Sud.
3. Les climats de l'avenir
Les climats ont changé dans le passé. Ils peuvent le faire dans l'avenir. Que pouvons-nous attendre au cours du xxie s. ? Le développement vertigineux des activités humaines atteint désormais l'échelle planétaire : ses effets doivent se faire sentir dans la marche de la machine climatique.
3.1. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (G.I.E.C.)
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (G.I.E.C.) est un organisme intergouvernemental créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement. Il a pour mission d'évaluer de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation ou d'atténuation. Il a déjà publié quatre rapports d'évaluation des connaissances relatives au changement climatique.
3.2. La conférence de Rio (1992)
La conférence de Rio (3-14 juin 1992), dite aussi Sommet de la Terre, a adopté notamment une convention adoptés, outre une déclaration de 27 grands principes, une convention sur les changements climatiques, la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC).
3.3. Le protocole de Kyoto (1997-2005)
Signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto, protocole additionnel à la Convention sur les changements climatiques de la conférence de Rio, adopté au terme d'une conférence internationale tenue à Kyoto, fixe pour 37 pays industrialisés ainsi qu'à l'Union européenne des objectifs de réduction d'au moins 5 % de leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012, par rapport à celles de 1990.
3.4. Le renforcement anthropogène de l'effet de serre
L'effet de serre, c'est-à-dire l'absorption de rayonnement infrarouge dans l'atmosphère, dépend, pour à peu près un tiers, du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Or, l'abondance du CO2 augmente, en premier lieu, en conséquence de la combustion des carburants fossiles. L'abondance d'autres gaz à effet de serre augmente aussi : le méthane (en relation surtout avec l'extension de la riziculture), le N2O, les chlorofluorocarbones ou CFC (ces derniers entièrement d'origine industrielle). L'effet de serre se renforce : si les tendances actuelles persistent, l'abondance du CO2, qui est passée de 290 ppmv (parties par million en volume) à 390 ppm en un siècle, pourrait très bien atteindre 600 ppm avant l'an 2040.
Avec l'intensification de l'effet de serre, on s'attend à un réchauffement climatique global. Mais de combien de degrés, et avec quelles conséquences ? La montée de la température moyenne globale depuis 1850 est-elle un signe de ce changement ? Ce n'est pas sûr. Il ne faut pas oublier la variabilité naturelle du climat. À l'inverse, le petit refroidissement entre 1950 et 1970 et la relative faiblesse du réchauffement observé jusqu'en 1987 ne suffisent pas à démontrer que le renforcement de l'effet de serre soit « inefficace ».
L'évolution climatique demeure donc incertaine, car elle dépend de rétroactions qui peuvent soit amplifier, soit restreindre le changement. Avec un début de réchauffement, l'atmosphère peut contenir davantage d'humidité. Si l'humidité augmente, intensifiant l'effet de serre de la vapeur d'eau, cela amplifiera le réchauffement. Mais l'humidité augmentera-t-elle ? Quant aux nuages, ils interviennent aussi bien en réfléchissant une partie du rayonnement solaire qu'en bloquant le rayonnement infrarouge terrestre. L'importance relative des deux effets dépend de l'altitude et de l'épaisseur de la couche nuageuse.
3.5. Les conséquences d'un réchauffement global
Dans le cas d’une élévation des températures de quelques degrés, on évoque souvent le risque d'une montée du niveau de la mer, particulièrement pour les régions déjà à la limite de la viabilité, notamment au Bangladesh où chaque tempête inonde d'immenses étendues au ras de l'eau. À terme, toutes les plaines côtières pourraient se trouver menacées.
Mais d'autres changements peuvent survenir beaucoup plus rapidement. Un réchauffement supérieur à 2 degrés implique des modifications importantes dans le cycle de l'eau, dans la carte des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité des sols. De façon générale, les modèles prédisent une intensification du cycle de l'eau, c'est-à-dire une évaporation plus forte et davantage de pluies à l'échelle globale, mais c'est la répartition régionale et saisonnière de ces changements qui compte en pratique. Avec un réchauffement, l'intensification de l'évaporation peut annuler les bénéfices d'une augmentation des pluies. Si les changements bouleversent la carte biogéographique, cela demandera de grands efforts d'adaptation à l'agriculture.
3.6. Comment maîtriser notre avenir climatique ?
Selon la sensibilité du climat, selon la gravité des « impacts » d'un réchauffement global plus ou moins rapide, on peut estimer plus ou moins urgent de réduire la production des gaz à effet de serre. Cela ne semble pas poser trop de problèmes en ce qui concerne les CFC, déjà mis au ban à cause de leur rôle dans la destruction de l'ozone stratosphérique. En revanche, réduire les émissions du CO2 et du méthane, liées aux activités humaines fondamentales que sont la production d'énergie et l'agriculture, paraît bien plus difficile.
Peut-on envisager d'autres solutions si l'on veut continuer à utiliser les carburants fossiles ? Pomper le CO2 dans les océans, pour l'éloigner de l'atmosphère pendant quelques siècles : est-ce praticable et sans danger ? Pourrait-on sans risques fertiliser les mers pour qu'il y ait davantage de phytoplancton (algues) transformant du CO2 en matière organique ? Arrêter la déforestation et replanter des forêts peuvent paraître des solutions « biologiques » attirantes pour stabiliser le CO2 atmosphérique. Cependant, pour que la reforestation puisse compenser des émissions industrielles croissantes de CO2, il faut remplacer la fertilisation naturelle des sols des forêts par un apport d'engrais artificiels.
À défaut de pouvoir limiter l'intensification de l'effet de serre, peut-on la contrecarrer par une sorte d'ingénierie géophysique ? Les idées ne manquent pas : on propose d'introduire des particules réfléchissantes dans la stratosphère (en quelque sorte des nuages volcaniques artificiels), voire des parasols dans l'espace. Si cela pouvait annuler le réchauffement global, quels en seraient les effets sur les climats à l'échelle régionale ?
En attendant d'y voir plus clair, ne vaut-il pas mieux ralentir la perturbation de notre environnement planétaire ? Le « développement » (quel type de développement ?) exige-t-il vraiment une production de plus en plus grande d'énergie ? Avec les technologies modernes, on doit pouvoir produire mieux avec moins ? Le ferons-nous assez vite ?
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
PLATON |
|
|
| |
|
| |
Platon
Philosophe grec (Athènes vers 427-Athènes vers 348 ou 347 avant J.-C.).
Platon est un des philosophes majeurs de la pensée occidentale, et de l’Antiquité grecque en particulier. Son œuvre, essentiellement sous forme de dialogues, se présente comme une recherche rigoureuse de la vérité, sans limitation de domaine. Sa réflexion porte aussi bien sur la politique que sur la morale, l’esthétique ou la science.
La confiance dans la capacité humaine de connaître la réalité est ce qui constitue l’unité de l’œuvre de Platon. Contre les sophistes, qui enseignent l’art de convaincre et de plaire, Platon pose la question du discours vrai. Le réel est connaissable ; l’homme n’est pas limité à ses impressions : par ce qu’il sent, il peut avoir accès à une réalité qui le dépasse. Son œuvre s’oriente ainsi dans deux directions complémentaires : d’une part, chercher la vérité à propos de réalités déterminées (la justice, le monde, par exemple) ; d’autre part, chercher à justifier la possibilité même de connaître la vérité.
Famille
Platon est né vers 427 av. J.-C. dans une famille aristocratique. Son oncle Critias fut l’un des oligarques (les Trente) qui dirigèrent Athènes après la défaite contre Sparte (404 av. J.-C.), à la fin de la guerre du Péloponnèse.
Formation
Il passe huit ans auprès de Socrate mais ne peut être témoin de la mort inique de son maître. Il poursuit sa formation auprès d’Euclide le Socratique. Il voyage et rencontre philosophes et mathématiciens de différentes écoles.
Enseignement philosophique et mise en pratique
Sa vie de maître de philosophie, à l’école (Académie) qu’il a créée, est entrecoupée d'épisodes dramatiques. Il manque partir en esclavage. Il a des relations tumultueuses avec les tyrans (autocrates qui ont pris le pouvoir par la force) de Syracuse, en Sicile ; il y est retenu contre son gré à deux reprises. Il rentre définitivement à Athènes (361 av. J.-C.) et meurt une douzaine d’années plus tard.
L’œuvre
Elle est couramment classée en dialogues de jeunesse (dits socratiques), dialogues de la maturité (dont surtout le Banquet, la République, le Théétète, le Parménide), et dialogues tardifs.
Le dialogue entre interlocuteurs est un questionnement intérieur, mouvement délibéré et difficile vers la recherche de la vérité : prendre conscience de ce qui n’est pas, de ce qui est faux, de ce qui est. Deux moyens privilégiés sont donc la dialectique et la réminiscence.
La postérité
Après les continuateurs de l’Ancienne et de la Nouvelle Académie, une certaine influence de la pensée de Platon, telle que transmise notamment par Plotin (→ néoplatonisme) marque l’Antiquité de l’Empire romain puis la Renaissance, la pensée médiévale ayant quant à elle abondamment interprété Aristote, qui fut longtemps son élève.
Voir l'article scolastique.
1. La vie de Platon
Issu d'une famille noble, Platon est né vers 427 avant J.-C. et a vécu quatre-vingts (ou quatre-vingt-un ans : une biographie pythagoricienne préfère ce chiffre, qui est le carré de 9). Il eut deux frères (Adimante et Glaucon) et une sœur, Potoné, dont le fils, Speusippe, prendra sa suite à la direction de l'Académie.
Critias, l'un des Trente –c’est-à-dire le conseil qui dirigea Athènes par un régime de terreur en 404 avant J.-C. – était son oncle maternel. Tous ces personnages apparaissent dans les dialogues.
1.1. La fréquentation de Socrate
Platon a vingt ans lorsque, vers 407 avant J.-C., il fait la rencontre de Socrate, qui en a alors soixante-trois. Les relations entre les deux hommes vont durer huit ans, jusqu'à ce qu'en 399 av. J.-C. Athènes condamne Socrate à boire la ciguë. D'après le Phédon, Platon, malade, ne pourra assister aux derniers moments de celui dont la mort fut pour lui l'expérience de l'injustice même, à partir de laquelle tout le sérieux de la philosophie ainsi que sa vocation politique lui apparurent.
1.2. Les premiers dialogues
Après la mort de Socrate, Platon part quelque temps pour Mégare, où Euclide le Socratique et son groupe l'accueillent. De retour à Athènes, il écrit ses premiers dialogues et réunit autour de lui un premier cercle d'amis et d'élèves qui préfigure l'Académie.
1.3. Voyages en Méditerranée
Suivent ensuite quelques années de voyages. Le premier le conduit en Égypte (il s'y rend, dit-on, en négociant une cargaison d'huile qu'il veut vendre à Naukratis), puis à Cyrène, où il rencontre l'un des protagonistes du futur Théétète, Théodore le mathématicien, et Aristippe de Cyrène, qui avait été de l'entourage de Socrate.
Un deuxième voyage le mène en Italie du Sud, où il veut rencontrer le pythagoricien Archytas, sans doute moins (comme certaines traditions le laissent entendre) pour être initié à quelque doctrine secrète que simplement pour connaître celui qui avait instauré à Tarente un gouvernement dont les principes reposaient sur la philosophie.
Invité par Denys l'Ancien, tyran de Syracuse, Platon gagne ensuite la Sicile. Mais son séjour à la cour du tyran, où règne une vie très dissolue, sera bref : un conflit l'oppose bientôt à Denys, qui le met d'office dans un bateau. Ce premier épisode sicilien de Platon connaît un ultime rebondissement. Le bateau fait escale à Égine, où Platon est gardé comme esclave, mais, reconnu par un certain Annicéris rencontré à Cyrène, il est finalement racheté et libéré. Il est de retour à Athènes en 387 avant J.-C.
1.4. Fondation de l’Académie
Platon achète alors un gymnase et un parc situés au nord-ouest de la ville et y fonde l'Académie (c'était le nom du lieu), première école de philosophie dont l'existence soit historiquement incontestable.
L'Académie est dotée d'un statut juridique propre, dispose de logements destinés aux élèves et, en plus des salles de cours, d'un muséum où sont conservés livres et objets scientifiques. Xénocrate, Héraclide du Pont, Eudoxe de Cnide, Speusippe, Aristote figurent parmi les maîtres. Il ne semble pas que le dialogue socratique y soit la seule méthode d'enseignement en vigueur : le recours au livre n'est pas exclu (comme en témoigne l'existence d'écrits de Platon lui-même) ni l'exposé continu, comme, à ce qu'il semble, c'est le cas des doctrines non écrites de Platon qu'Aristote a transmises.
Le rayonnement de l'Académie est considérable. On vient de tout le monde grec y acquérir une philosophie dont le but avoué est politique : établir la justice.
1.5. Expériences politiques en Sicile et retour à Athènes
Denys l'Ancien meurt en 367 avant J.-C., et son fils, Denys le Jeune, lui succède. Dion, beau-frère du premier, propose alors à Platon (dont il a été l'élève) de revenir à Syracuse. Certains disent que la République vient d'être écrite et que Platon voit dans cette offre l'occasion d'en mettre les principes à l'épreuve, en entreprenant de faire du jeune tyran un philosophe. Il confie donc la charge de l'Académie à Eudoxe. Mais à l’accueil chaleureux succède vite la méfiance. Dion et Platon sont soupçonnés de vouloir exercer le pouvoir pour leur propre compte. Le premier est alors exilé, et Platon reste quelque temps prisonnier dans le palais royal, jusqu'à ce que, obligé lui-même de partir pour une expédition militaire, Denys se décide à le relâcher. Telle est la deuxième aventure sicilienne.
Platon reste alors six ans à Athènes. Or, en 361 avant J.-C., Denys le rappelle. « Tandis que du côté de la Sicile comme de l'Italie on me tirait à soi, du côté d'Athènes on me poussait en quelque sorte dehors à force de prières ! » dit la Lettre VII. Platon confie donc l'Académie à Héraclide du Pont et repart pour Syracuse, où c'est de nouveau la brouille avec Denys, qui l'assigne à résidence. Il faut l'intervention d'Archytas de Tarente, qui envoie même un bateau pour le ramener à Athènes, pour qu'il sorte sain et sauf de cette troisième et dernière aventure sicilienne.
Platon restera désormais à Athènes, où il continue à enseigner et à écrire. Il est en train d'achever les Lois quand il meurt, vers 348 avant J.-C.
2. L'œuvre écrite de Platon
Tous les écrits philosophiques de Platon ont été conservés, ce qui est exceptionnel pour un auteur de l'Antiquité. Vingt-huit ouvrages - des dialogues - sont considérés aujourd’hui comme authentiques.
Une classification des dialogues en trois groupes à peu près chronologiques est communément admise.
2.1. Les dialogues de jeunesse
L’ensemble de ces dialogues proprement socratiques comprend tout ce que Platon a écrit avant d'entreprendre ses voyages (390 avant J.-C.), soit l'Hippias mineur (Du mensonge) , l'Hippias majeur (Du beau), l'Ion (sur l'Iliade), le Protagoras (sur les sophistes), l'Apologie de Socrate, le Criton (Du devoir), l'Alcibiade (De la nature de l'homme), le Charmide (De la sagesse), le Lachès (Du courage), le Lysis (De l'amitié), l'Euthyphron (De la piété), le Gorgias (De la rhétorique) et le livre premier de la République, qui, avant de servir de préface à ce gros ouvrage, aurait constitué, sous le titre de Thrasymaque, un dialogue indépendant.
2.2. Les dialogues de la maturité
Ce second groupe, lié plus à l'enseignement de l'Académie qu'au souvenir de Socrate, s'achève au moment du deuxième séjour de Platon à Syracuse (361 avant J.-C.). Il comprend le Ménexène (De l'oraison funèbre), le Ménon (De la vertu), l'Euthydème (De l'éristique), le Cratyle (De la justesse des noms), le Banquet, le Phédon (De l'âme), la République (De la justice), le Phèdre (De la beauté). Sont à rattacher à ce groupe deux dialogues où Platon critique l'éléatisme de l'école socratique de Mégare : le Théétète (De la science) et le Parménide (Des idées).
2.3. Les derniers dialogues
Ce dernier groupe comprend le Sophiste (De l'être), le Politique (De la royauté), le Timée (De la nature), le Critias (De l'Atlantide), qui est inachevé, le Philèbe (Du plaisir) et les Lois (De la législation).
3. La philosophie de Platon
3.1. La maïeutique, ou l’art d’accoucher les esprits
La forme dialoguée que Platon a donnée à ses écrits ne trouve pas sa justification dans le seul souvenir des entretiens que Socrate avait animés ; elle est également liée – au-delà de l'anecdote – à la méthode pédagogique que Platon présente comme l'héritage philosophique de Socrate, le « maïeute », l'accoucheur des esprits.
Le questionnement de Socrate conduit l’interlocuteur à prendre conscience qu’il ne connaît pas ce qu’il croyait connaître. Par là, il l’invite à expliciter ce qu’il a à l’esprit : si cette explicitation, cet « accouchement » est possible, alors la pensée prouve sa consistance. La mise au jour de la pensée en est comme l’épreuve : si je peux dire pour un autre ce que je pense, la preuve est faite que ma pensée est effectivement pensable.
Cette épreuve ne suffit pas à montrer que la pensée est vraie mais elle montre au moins qu’elle est logique. Grâce à cette formulation de la pensée dans la langue, le dialogue peut avoir lieu.
3.2. Le dialogue et la dialectique
Platon conçoit le dialogue comme une recherche commune de la vérité, commune parce qu’elle n’appartient à personne.
Contre les sophistes
Par opposition aux sophistes, qui ne voyaient dans le dialogue qu'une joute oratoire, qu'un combat de monologues dont la fin se limitait à réduire l'adversaire au silence, le dialogue platonicien vise, en effet, à permettre aux participants d'accorder leurs discours à la vérité.
Les sophistes, tels du moins que Platon les peint, sont des pragmatiques, pour qui compte seule la réussite et qui ne s'embarrassent pas de scrupule concernant les valeurs : l'homme, disait Protagoras, est la mesure de toute chose.
Le platonisme, au contraire, affirme la transcendance de la mesure. Et ce n'est pas à cause de la difficulté des sujets abordés, mais parce que leurs mauvaises dispositions les conduisent à rejeter cette transcendance sans laquelle le mot vérité n'a plus aucun sens, que les sophistes font se terminer sur une aporie (contradiction insoluble) la plupart des dialogues auxquels ils participent.
Partir de sa propre ignorance
Celui qui parle ne saurait donner la mesure : il ne peut que s'y soumettre. Le dialogue platonicien est une sorte d'entretien sans maître, le savant (sophistês) n'y a pas sa place, et l'on n'y fait profession que d'ignorance – profession qui constitue le moment inaugural de la philosophie en tant qu'elle est amour (philia), donc désir, donc manque du savoir (sophia).
Mais d'un savoir qui soit savoir vrai, alors que celui des sophistes, étant dissocié de la vérité, n'est qu'apparent. Le sophiste ne désire pas savoir, il désire vendre ce qu'il fait passer pour son savoir. Si le moteur du discours sophistique est financier, celui du dialogue platonicien est érotique : ce désir du vrai dans lequel Platon montre, en même temps que la vérité de tout désir, le vrai désir. C'est là ce que, d'après le récit du Banquet, Diotime aurait appris à Socrate : « La sagesse est parmi les plus belles choses et c'est au beau qu'Amour rapporte son amour ; d'où il suit que, forcément, Amour est philosophe. »
Dépasser l'apparence
Cette opposition historique et méthodologique de Platon et des sophistes redouble l'opposition de deux mondes (sensible et intelligible), qui constitue l'armature du système platonicien.
Les sophistes ont partie liée avec les philo-doxes, littéralement les « amis de l'opinion », dont les discours reposent sur la connaissance sensible, apparente, des choses matérielles. La philosophie, au contraire, sera essentiellement para-doxale, opposant la réalité aux apparences et la science aux opinions. En conséquence, le dialogue platonicien sera chaque fois une tentative pour se hausser hors de la multiplicité des apparences, et accéder à la réalité intelligible.
3.3. L’allégorie de la Caverne : se détourner des opinions fausses
L'itinéraire de cette conversion paradoxale est décrit dans l'allégorie de la Caverne (la République, vii).
La première scène, ou première étape, présente des hommes enchaînés dans une caverne, tournant le dos à un feu qui projette, sur la seule paroi qu'ils puissent voir, l'ombre d'objets que des porteurs font défiler (Platon en précise la nature : « statues et autres figures de pierre ou de bois, et toutes sortes d'objets fabriqués par la main de l'homme »).
L'habitude, jointe au fait qu'ils n'ont – ou ne se souviennent pas d'avoir – jamais rien vu d'autre, leur fait prendre ces ombres pour la vérité elle-même.
La deuxième étape, qui entreprend de briser cette première illusion, sera en conséquence douloureuse : elle décrit les souffrances qu'éprouveraient ces esclaves si quelqu'un descendait les libérer de leurs chaînes et les contraignait à tourner leur regard en direction du feu, pour constater l'existence d'objets plus vrais et reconnaître qu'ils n'en avaient vu que l'ombre.
Mais l'éblouissement empêche cette reconnaissance, et il faudra, dans une troisième étape, les faire cette fois sortir de la caverne pour qu'ils commencent à accepter l'évidence de réalités d'un degré de vérité supérieur (les statues et autres figures), dont les objets qui défilaient devant le feu (les ombres) n’étaient qu’une image.
Enfin, lorsqu'ils auront été accoutumés à ces réalités, la quatrième étape les fera accéder à la contemplation directe du Soleil, qui leur permet par sa chaleur d'exister et, par sa lumière, d'être connus. Ils redescendent alors dans la caverne pour émanciper ceux qui ne les ont pas suivis, mais, éblouis cette fois par les ténèbres, leur maladresse fera d'eux l'objet de toutes les risées, voire – s'ils deviennent gênants – de sévices pouvant aller jusqu'à la mort.
3.4. Du sensible vers l’intelligible
Les quatre étapes de cette allégorie décrivent quatre degrés d'être et les quatre modes de connaissance qui leur correspondent.
Les deux premiers appartiennent au monde visible : ce sont d'abord les images ou copies, auxquelles correspond la simulation ; ce sont ensuite les choses visibles elles-mêmes, qui sont le corrélat d'une sorte de foi perceptive. Les deux derniers constituent le monde intelligible qui commence avec les mathématiques, c'est-à-dire des raisonnements discursifs conduits à partir d'hypothèses, tandis que l'intellection véritable ne suppose rien, mais rattache tout au principe suprême (arkhê) qu'est l'idée du Bien.
D'un côté donc, le monde de ce qui paraît (phainomenon), images (eikones) ou idoles (eidola) ; de l'autre, le monde de ce qui est, monde des Idées, dont la propriété est d'être invisibles, c'est-à-dire pensables (noumena).
Le mythe de la Caverne décrit l'itinéraire qui conduit de l'un à l'autre, « hors de ce qui devient, vers ce qui existe » – itinéraire par lequel « ce qu'il y a de meilleur dans l'âme » accède à la contemplation de « ce qu'il y a de plus excellent dans la réalité ».
3.5. Philosopher, c’est apprendre à mourir
Accéder à la connaissance des Idées ne suscite donc pas seulement des difficultés logiques, mais d'abord des difficultés morales ou métaphysiques. Il faut que l'âme soit libérée, non seulement de la sujétion, mais aussi de la médiation du monde sensible : qu'elle soit rendue à l'état qui était le sien avant que, par la naissance, elle ait dû s'incarner dans un corps. « Philosopher, c'est apprendre à mourir », dit Platon, dans le Phédon.
Cette libération est l'occasion de la réminiscence, par laquelle l'âme retrouve les Idées dont elle s'était nourrie, quand elle suivait, au lieu supra-céleste, le cortège des dieux ; la vie corporelle avait ensuite étouffé ce souvenir.
Les amis de la sagesse sont donc les ennemis du corps conçu comme obstacle à l’élévation vers l’intelligible. Il y a donc lieu d’inverser les valeurs communes : dans ce monde renversé qu'est le platonisme, la vraie vie correspond à ce que l'opinion commune croit être la mort, c'est-à-dire l'état auquel l'âme renaît ou ressuscite chaque fois qu'elle se sépare de nouveau de son tombeau corporel.
Le monde des Idées est en effet la patrie de l'âme ; entre les Idées et l'âme existe une étroite parenté : indestructibles et indivisibles, elles échappent aux sens comme au devenir.
3.6. « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre »
Cette ascèse repose sur un certain nombre d'intermédiaires qui assurent le passage d'un monde à l'autre. L'amour était l'un d'eux, par lequel Socrate gagnait son entourage à la philosophie, puisque, amour charnel d'un corps au départ, il devenait amour de l'invisible beauté idéale et, par la procréation, de l'immortalité.
Mais, dans le cadre plus institutionnel de l'Académie, Platon préfère lui substituer les mathématiques : elles aussi, partant de figures sensibles, aboutissent à l'intuition de « figures absolues, objets dont la vision ne doit être possible pour personne autrement que par le moyen de la pensée ». Tel est le sens de l'inscription qui figurait au fronton de l'Académie : « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ! » : avant de s'engager dans la philosophie, il faut avoir d'abord libéré son âme au moyen des mathématiques.
Pourtant, les mathématiques, nécessaires à la science, ne lui suffisent pas : leurs principes sont des hypothèses dont elles ne peuvent répondre, pas plus qu'elles ne peuvent, par conséquent, répondre des conclusions qu’elles en tirent par voie déductive.
La dialectique seule conduit à l'intellection des principes en eux-mêmes ; elle seule peut justifier entièrement ses propositions en les rattachant à ce principe suprême que Platon a nommé le Bien et que, dans la Caverne, il a figuré par le Soleil.
3.7. Après la recherche de la vérité, l’explication de l’erreur
Les derniers dialogues, dits « dialectiques » (le Phèdre, le Parménide, le Sophiste, le Politique, le Philèbe), cherchent à comprendre comment l’erreur est possible. Il ne s’agit plus de partir des exemples pour saisir ce qui leur est commun et, par là, accéder à leur Essence, mais de comprendre comment il est possible de se tromper, c’est-à-dire de dire ce qui n’est pas. La réflexion ne porte plus que sur les Idées elles-mêmes : il s’agit de comprendre comment elles sont liées entre elles.
Dans le Parménide, le philosophe Parménide d’Élée met le jeune Socrate en difficulté en contestant la cohérence d'une philosophie qui établit une séparation tranchée entre les sensibles et les intelligibles.
À partir des cinq genres que sont l'Être, le Repos, le Mouvement, le Même et l'Autre, le Sophiste, pour sa part, développe la participation des Idées les unes aux autres, leur mutuelle implication. Sans doute Repos et Mouvement sont-ils trop exclusifs pour se mêler si peu que ce soit, mais tous deux, dans la mesure où ils sont, participent à l'Être et, chacun des trois pouvant également être dit autre que les autres et le même que lui-même, tous participent et au Même et à l'Autre. Il en résulte que l'on peut dire de l'Être autre chose que l'Être ; autour de chaque Être prolifère l'autre, le Non-Être.
Deux conclusions peuvent alors être avancées :
– de même que les êtres sensibles sont déterminés par leur participation aux Idées, de même les Idées dépendent les unes des autres selon des rapports hiérarchiques ; l’Idée de Justice participe, par exemple, de l’Idée de Vertu. La seule Idée qui ne participe d’aucune Idée est celle de laquelle dépendent toutes les autres : l’Idée de Bien ;
– si l'on ne respecte pas ces relations, mais que l'on mêle n'importe quelle Idée à n'importe quelle autre, on risque de tomber dans l'erreur en disant ce qui n'est pas - ce que fait le sophiste.
3.8. Philosophie et mythe
La recherche de la vérité s’accompagne d’une conscience aigüe des limites de la connaissance. Ainsi la philosophie de Platon recourt-elle au mythe. Ces séquences narratives qui ponctuent bien des dialogues ont des statuts différents. Il est possible d’en distinguer trois principalement.
Tout d’abord, Platon reprend des mythes populaires : au début du Phèdre, Socrate dit que, ne se connaissant même pas lui-même, il ne peut pas prétendre savoir si ce que l’on raconte sur les Hippocentaures, les Gorgones, ou Pégases est vrai ou faux. La sagesse populaire n’est peut-être pas plus aberrante que bien des arguties (distinctions subtiles).
Ensuite, le mythe est une méthode pour se représenter ce que l’on ne peut connaître. Dans le Phèdre encore, après avoir démontré l’immortalité de l’âme, Socrate montre qu’il n’est pas possible de savoir ce qui lui arrive après la mort : la seule façon de s’en donner une idée est d’imaginer ce que nous ne connaissons pas à partir de ce que nous connaissons, tel est le mythe de l’attelage ailé.
Il ne saurait y avoir de science du devenir, c'est-à-dire de physique scientifique. Le mythe cosmologique (comme celui du Timée), par l'objet même qui est le sien, ne saurait être autre chose qu'une opinion dont on n'est pas en droit d'attendre plus que de la voir s'accorder harmonieusement avec la science de l'Être.
Enfin, le mythe peut être une illustration évocatrice de ce qui a été établi rationnellement au préalable ; ainsi, le mythe de la Caverne, au début du livre vii de la République, expose-t-il la distinction entre sensible et intelligible établie au livre vi.
4. Le platonisme
4.1. Une postérité réelle quoique diverse
Qu'est-ce que le platonisme ? Dans la mesure où, depuis Platon, la philosophie est métaphysique, opposant le sensible à l'intelligible et soumettant le premier au second, toute philosophie est par destin platonicienne.
Pourtant, ce que le nom de Platon a représenté, chez ceux qui, au cours de l'histoire de la philosophie, l'ont invoqué, n'a pas cessé de varier. Le platonisme est soumis à l'histoire de la transmission du texte de Platon et varie selon la liberté des traductions et des commentaires, au travers desquels elle s'effectue et selon celui ou ceux des dialogues sur lesquels ils portent.
4.2. L’Académie : la Nouvelle et l’Ancienne
L'école que Platon avait fondée devait survivre près de dix siècles à son fondateur. Il est vrai qu'il n'en fallut pas trois pour que l'enseignement qu'on y dispensait perdît tout rapport avec la doctrine du philosophe.
On distingue l’Ancienne et la Nouvelle Académie.
Les scolarques, ou directeurs, de l'Ancienne Académie furent :
– Speusippe, neveu de Platon (de 348 à 339 av. J.-C.)
– Xénocrate (de 339 à 315 av.J.-C.)
– Polémon (de 315 à 269 av.J.-C.)
– Cratès (de 269 à 268 av.J.-C.).
Tous orientent le platonisme vers une méta-mathématique qui, prolongeant les doctrines non écrites de Platon sur les nombres, le rapproche du pythagorisme (→ Pythagore).
La Nouvelle Académie eut pour scolarques Arcésilas de Pitane, Lacydes, Téléclès, Évandre, Hégésinus, Carnéade, Clitomachos et Philon de Larissa (qui meurt vers 85-77 av. J.-C., à Rome). Le dogmatisme platonicien est alors soit critiqué, soit infléchi vers le scepticisme.
Le maître mot de Socrate, « je sais que je ne sais rien », est interprété en un sens différent. Il ne signifie plus l’étonnement, source du désir de savoir, mais la désillusion de celui qui renonce à chercher la vérité.
4.3. Le platonisme romain
On peut douter, d'ailleurs, que, si l'Académie avait été plus fidèle à la doctrine de son fondateur, le platonisme ait eu quelque chance de pénétrer à Rome. « Platon, ce dieu pour nous » (« Plato deus ille noster ») , écrit Cicéron à Atticus (iv, 6). Mais cette admiration que Cicéron ne ménage pas à Platon, c'est à la beauté des écrits, à la noblesse de la vie de Platon, et non à sa philosophie, que Cicéron les porte.
Trait dominant de toute philosophie romaine, l'éclectisme caractérisera aussi ce platonisme, qui continuera d'exister à côté du stoïcisme, de l'épicurisme ou de l'aristotélisme. Et divers éléments mystiques prendront vite le dessus, accusant une convergence du platonisme et du pythagorisme, d'ailleurs souvent déjà amorcée. C'est elle qui ressort en particulier de la pensée de Philon d'Alexandrie, du légendaire Apollonios de Tyane, de plusieurs écrits de Plutarque, des œuvres philosophiques d'Apulée (auteur d'un De Platone [Sur Platon]) et surtout des doctrines gnostiques, d'inspiration judéo-chrétienne ou « égyptienne », qui se multiplient à partir du Ier siècle de notre ère (Numenius d'Apamée, Ammonios).
4.4. Le néoplatonisme de la fin de l’Antiquité
Plotin a été, à Alexandrie, l'élève d'Ammonios. Par le contexte dans lequel il se développe, le néoplatonisme apparaît lié à une religiosité profondément mystique. À Rome comme à Alexandrie, il sera d'ailleurs accompagné de pratiques magiques plus ou moins ésotériques, de toutes sortes de mystères, etc. Il regroupera dans une semi-clandestinité les religions orientales, de plus en plus étouffées par les progrès du christianisme.
Aussi Plotin est-il avant tout un mystique qui demande simplement au langage philosophique de se greffer, pour la formaliser, sur une expérience antérieure. Entreprise qui, d'ailleurs, ne saurait atteindre à l'essentiel de cette expérience : l'absolu, en effet, échappe totalement à l'ordre du discours. Chez Plotin, la philosophie est à l'« extase » mystique ce que les mathématiques étaient à la philosophie chez Platon.
Porphyre (qui a aidé Plotin à gouverner l'école qu'il avait fondée à Rome), Amélios, Jamblique, Proclus surtout et Damaskios, enfin, prolongeront la pensée de Plotin jusqu'au vie siècle.
4.5. Le néoplatonisme de la Renaissance
La période médiévale n’a pas ignoré Platon mais lui a préféré Aristote. Trois dialogues de Platon étaient alors accessibles dans une traduction latine : le Timée, traduit au ive siècle par Chalcidius ; le Ménon et le Phédon, traduits par Henri Aristippe (1154 et 1156).
C'est le poète et humaniste Pétrarque (1304–1374) surtout qui relance l’intérêt pour Platon. Non qu'il ait jamais eu du platonisme une connaissance profonde ni étendue, mais, par ses écrits et ses recherches, il est le principal initiateur du réveil du platonisme. Après sa mort paraîtront en effet les traductions de Leonardo Bruni (Phédon, 1405 ; Gorgias, 1409 ; Criton, Lettres, 1423 ; Apologie, 1424).
Puis on opposera ce Platon redécouvert à un Aristote qui avait trop longtemps usurpé sa place ; c'est ce que font en 1439 Gémiste Pléthon et en 1469 le cardinal Bessarion, avec In calumniatorem Platonis. Alors viendra Marsile Ficin, fondateur de l'Académie florentine, à travers laquelle ce platonisme gagnera toute l'Europe.
Pour en savoir plus, voir l'article humanisme.
À ce regain du platonisme, on sait que la naissance de la physique mathématique est liée ; dans son Dialogue sur les deux plus grands systèmes du monde, l'astronome et physicien italien Galilée rejette l'aristotélisme et lie au platonisme l'avenir de la science.
Quelque chose de la pensée de Platon, sous une forme certes quelque peu sommaire, sans commune mesure avec la portée philosophique du platonisme, est passé dans la langue courante, pour désigner un sentiment détaché du sensible, en l'occurrence du sensuel : « l'amour platonique ».
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LA SYMPHONIE |
|
|
| |
|
| |
Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la musique ».
LA SYMPHONIE
Dans son sens principal, le terme de symphonie désigne le plus important genre orchestral, avec le concerto, de la musique occidentale à partir du xviiie siècle ; le plus représentatif aussi, puisque la symphonie beethovénienne a été dans toute la planète l'ambassadrice privilégiée de cette musique.
Caractéristiques
La symphonie est caractérisée par :
l'emploi de l'orchestre comme ensemble-masse, sans qu'il y ait opposition permanente d'un soliste à cette masse ; les solos dans les symphonies sont en principe des « prises de parole » isolées, au nom et au bénéfice de l'ensemble dont ils se détachent ;
un plan en 4 mouvements, disposés selon le moule de la sonate classique : allégro de forme sonate, précédé ou non d'une courte introduction lente ; mouvement lent, adagio ou andante ; menuet ou scherzo dansant à trois temps ; finale rapide de forme sonate, ou rondo-sonate ; on a parfois appelé, pour cette raison, la symphonie une sonate pour orchestre ;
des proportions qui, après Haydn, « fondateur » de la symphonie au sens moderne, et à partir de Beethoven, tendent (à de notables exceptions près il est vrai) à être de plus en plus importantes (une heure et demie chez Mahler, voire deux heures chez Messiaen).
Étymologiquement, le terme de symphonie dérive du grec symphonia (sun, « avec » ; phônê, « son »), « union de sons », « harmonie », « accord », « consonance » et aussi « concert ». Il a pris par métonymie une foule de sens, désignant tantôt un instrument (dans l'Antiquité une sorte de tambour et au Moyen Âge, sous le nom de « chifonie » ou « chifoine » la vielle à roue ou un autre instrument basé sur le même principe), tantôt la masse de l'orchestre lui-même, tantôt une intervention purement instrumentale ou orchestrale au sein d'une œuvre vocale sacrée (motet) ou profane (opéra), et enfin, à partir du xviie siècle, différents genres musicaux d'abord peu définis, dont le point commun était d'employer le ou les instruments sans la voix ni le texte, qu'il s'agisse de suites instrumentales (Symphonies pour les soupers du roy, de Michel Richard Delalande), de pièces polyphoniques pour instruments seuls (les sinfonie de Rossi et Banchieri) ou même de pièces instrumentales en solo (sinfonia au début d'une partita pour clavecin de Jean-Sébastien Bach). La symphonie moderne ne s'est trouvée qu'au milieu du xviiie siècle, mais il est curieux de noter qu'elle s'est définie d'abord par l'exclusion de la voix et du texte, et que celui qui l'a portée le plus haut, Beethoven, est aussi celui qui a fini par y réincorporer, dans sa 9e, le texte et la voix. Comme si la symphonie avait toujours conservé un rapport secret avec la voix humaine et la musique dramatique, fût-ce sous la forme de l'exclusion ou de la sublimation.
Au xviie siècle, le dictionnaire de musique de Brossard définit la symphonie comme une « composition pour les instruments », et, dans celui de Jean-Jacques Rousseau on lit que « le mot symphonie s'applique à toute musique instrumentale, tant à des pièces qui ne sont destinées que pour les instruments, comme les sonates et les concertos, qu'à celles où les instruments se trouvent mêlés avec les voix, comme dans nos opéras et dans plusieurs autres sortes de musique ».
On fait dériver la symphonie au sens moderne, c'est-à-dire la « sonate pour orchestre » dont Haydn a stabilisé le moule, de genres tels que l'ouverture d'opéra à l'italienne, avec ses 3 mouvements vif-lent-vif, jouée avant le lever du rideau, ou que l'ouverture d'opéra à la française fixée par Lully, également à 3 parties, mais dans l'ordre inverse : lent (pointé)-vif (fugué)-lent. De l'ouverture à la française, la symphonie aurait gardé le principe d'une introduction lente au premier mouvement rapide, enchaînée directement à lui. Les genres de la suite, du concerto et de la sonate instrumentale ont également contribué à la naissance de la forme symphonique.
Naissance de la symphonie classique
Le xviiie siècle voit d'une manière générale l'émancipation des formes instrumentales en dehors du cadre religieux ou dramatique, c'est-à-dire en dehors de la voix, du texte et du rite. Parallèlement à la symphonie, et en rapports étroits avec elle, naquit et se développa la salle de concerts. On sait l'importance qu'eut en France et en Europe la fondation d'une institution comme le Concert spirituel, grande consommatrice de pièces instrumentales, et en particulier de symphonies : ces pièces, destinées au début à être exécutées avant les grands motets, attirèrent peu à peu l'intérêt. Au Concert spirituel furent jouées les symphonies d'auteurs français comme Charles-Henri Blainville (né en 1711), Louis-Gabriel Guillemain, François Martin (1727-1757), Joseph Touchemoulin (1727-1801), Jean-Baptiste Miroglio, et plus tard celles de François Joseph Gossec (1734-1829), auteur d'une quarantaine de symphonies qui purent le faire passer pour un Haydn français. La plupart de ces symphonies françaises sont encore en 3 mouvements.
Les origines de la symphonie de concert sont aussi à chercher en Italie, du côté des sinfonie (pluriel de sinfonia) émancipées de leur fonction de préludes d'opéras, mais surtout de l'autre côté du Rhin : d'abord à Vienne, avec les symphonies en 3 ou en 4 mouvements de ces prédécesseurs ou contemporains de Haydn que furent G.-M. Monn (1717-1750), Wagenseil (1715-1777), Carlo d'Ordonez (1734-1786), Michael Haydn (1737-1806), Johann Baptist Vanhal (1739-1813) ou Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799). Il est vrai que l'époque consommait les symphonies comme aujourd'hui le public consomme des films, et Barry S. Brook, dans une étude sur la symphonie française à l'époque, compte environ 1 200 symphonies différentes exécutées à Paris entre 1750 et 1800.
Mais c'est surtout à Mannheim que l'on a voulu localiser la naissance de la symphonie moderne. De l'école de Mannheim, il semble à présent que l'on ait surestimé le rôle, même s'il ne fut pas mince. Les précurseurs et les modèles de Haydn sont en effet à rechercher à Vienne, et non à Mannheim. L'orchestre de Mannheim, assez important en effectifs, et dont le premier chef fut Johann Stamitz, permit à la symphonie de trouver un certain équilibre formel et orchestral (→ FORME SONATE).
Il faut signaler aussi, en Allemagne et en Angleterre, les symphonies de J. H. Hasse (1699-1783), de Johann-Gottlieb Graun (1698-1771), Karl-Henrich Graun (1701-1759), de J.-M. Molter (1695-1765), sans oublier celles des quatre fils de Jean-Sébastien Bach.
Dans toute cette activité symphonique européenne, s'affirment, malgré les différences notables quant au nombre et à la nature des mouvements, à la forme, à l'orchestration et au statut donné au genre, quelques constantes : raffinement de l'écriture orchestrale, des nuances et des procédés d'exécution ; enrichissement de la palette, avec des instruments à vent plus individualisés, sortant parfois de leur rôle de doublure ou de soutien harmonique pour tenir une partie propre ; allégement progressif de la basse continue. Ainsi, l'orchestre assouplit ses articulations et assoit sa formule de base : la naissance du genre de la symphonie s'accompagne de celle de l'orchestre symphonique au sens moderne.
Le plan de la symphonie
La naissance de la symphonie moderne est généralement associée à l'ajout d'un 4e mouvement venant se glisser entre le mouvement lent central et le mouvement rapide final de l'ouverture à l'italienne de coupe vif-lent-vif, donc à l'intérieur d'une forme traditionnelle tripartite conservée par le concerto, et qui en soi témoignait d'une belle symétrie. Mince conquête, en apparence, que ce petit menuet issu de la suite, avec son trio central, son rythme simpliste et son inspiration aimable : comment put-il contribuer à engendrer une forme nouvelle ? En cassant et en décentrant la symétrie vif-lent-vif, il donna à la symphonie ses bases modernes. Succédant à la gravité ou au charme mélodique du mouvement lent, le menuet vint affirmer un besoin de mouvement et de légèreté tout en aidant le finale à reprendre dans une dimension plus sérieuse et plus ambitieuse. En faisant « tampon » entre les langueurs du mouvement lent et la brillance du finale, le menuet ou le scherzo permettent à l'auditeur de respirer, et aux mouvements qui le précèdent et le suivent de s'étendre l'un et l'autre, de se raffiner, et de devenir infiniment plus complexes. On peut dire que le finale de symphonie ne conquit son indépendance, son ambition, sa largeur de perspectives qu'à la faveur du « détour » apporté par le 3e mouvement détour qui, en l'éloignant encore plus du premier mouvement, lui permit de renouer avec lui un lien plus fort, plus large. Quand 2 mouvements vifs se tendent la main par-delà un seul mouvement lent, comme dans le concerto, on débouche sur une simple complicité entre gens d'action, sans grand enjeu, pour une partie gagnée d'avance : souvent, l'allégro final d'une forme tripartite ne peut que viser court. Mais quand 2 mouvements, et non un seul, séparent le premier et le dernier, et que l'un de ces 2 mouvements est nettement léger le finale ne peut que viser plus loin et plus haut. Il doit en effet contrebalancer un échafaudage déjà lourd et complexe de 3 mouvements contrastés dont les forces convergent en lui.
La symphonie conserva en outre des liens secrets avec l'opéra, puisqu'elle est issue, notamment, de l'ouverture d'opéra. Le finale de symphonie se joue sur une scène plus vaste, plus encombrée de péripéties, que le finale de concerto, et ne peut plus compter, pour s'imposer, sur un simple effet de contraste et de dynamisme. Tout cela n'est, bien sûr, qu'une tendance, une potentialité, et il s'en faut de beaucoup que tous les finales de symphonies soient aussi ambitieux. Mais, dans certains finales de symphonies très plaisantes se contentant de prolonger sur une allure binaire et vive la gaieté ternaire du menuet-scherzo (cf. la 6e Symphonie de Schubert), on ressent, qu'on le veuille ou non, une certaine impression de redondance. À moins que, comme dans l'Italienne de Mendelssohn, ne soit jouée la carte du « toujours plus vite, plus brillant ». Ainsi, le finale tend à être placé sous le signe du « plus » : plus brillant, plus rapide, plus étonnant, plus savant. L'œuvre de Mozart (cf. la symphonie Jupiter) et celle de Joseph Haydn comptent déjà de ces finales placés sous le signe du triomphe et de la surenchère. Mais c'est évidemment avec Beethoven et surtout avec ses successeurs que le finale acquiert cette fonction dans la symphonie moderne.
Un autre problème de plan est celui de la place respective des 2 mouvements centraux, le mouvement lent et le menuet-scherzo. Une innovation de plus en plus fréquente, à partir de la 9e Symphonie de Beethoven, consiste à intervertir l'ordre habituel pour placer le scherzo en deuxième position. On en voit bien la raison dans le cas précis de la Neuvième, où l'adagio est traité comme une longue méditation introductive au finale. Un scherzo placé immédiatement après cet adagio viendrait en effacer la tension, et la dépenser sous la forme d'une excitation légère. Il devint d'ailleurs plus difficile, au xixe siècle, de réussir un finale rapide immédiatement précédé d'un scherzo. La variante introduite par Beethoven fut donc assez souvent reprise, car elle est propice aux vastes finales dramatiques venant exploser après la lenteur recueillie d'un adagio. De même, mis en deuxième position, le scherzo introduit souvent un élément terrestre et mondain, voire païen et dionysiaque, après lequel le mouvement lent apparaîtra d'autant plus recueilli et plus grave. C'est donc encore une fois ce mouvement intermédiaire de « divertissement » (au sens pascalien) qu'est le scherzo qui, selon son emplacement avant ou après le mouvement lent, conditionne l'équilibre ou plutôt le déséquilibre général. Ceci dans la mesure où étant facteur de dissymétrie et de déséquilibre, le scherzo ou le menuet devient du même coup facteur d'ouverture, d'inquiétude et d'expansion, par opposition à la symétrie satisfaite et fermée du concerto classique, à peine remise en cause pendant des siècles. À noter également que, grâce à ses menuets-scherzos, la musique symphonique put honorer ses racines populaires.
Entre les 4 parties de la symphonie, quel que soit leur ordre, il y a une répartition des fonctions, avec des dominances : dominance de la forme et de l'affirmation tonale dans le premier mouvement ; dominance de l'élément mélodique et lyrique pour le mouvement lent ; dominance de la pulsation rythmique pour le scherzo ou le menuet. Que reste-t-il alors au finale ? Une dimension théâtrale, rhétorique et dramaturgique, par sa fonction même, donnant à la forme son point d'aboutissement, peut-être son sommet, ou à défaut son issue.
Quand Debussy salue l'effort de Beethoven pour faire, avec sa 9e Symphonie, éclater le moule de la symphonie, et qu'il considère le genre comme usé et épuisé après cette tentative, connaît-il les créations de Bruckner et de Mahler ? On ne le dirait pas, car c'est sur la symphonie « cyclique » type César Franck et la symphonie « sur un thème folklorique » type Dvořák que portent ses sarcasmes : « Une symphonie est construite généralement sur un choral que l'auteur entendit tout enfant. La première partie, c'est la présentation habituelle du « thème » sur lequel l'auteur va travailler ; puis commence l'obligatoire dislocation… ; la deuxième partie, c'est quelque chose comme le laboratoire du vide… ; la troisième partie se déride un peu dans une gaieté toute puérile, traversée par des phrases de sentimentalité forte ; le choral s'est retiré pendant ce temps-là c'est plus convenable ; mais il reparaît et la dislocation continue, ça intéresse visiblement les spécialistes, ils s'épongent le front… » (écrit en 1902).
Évidemment, Mendelssohn est le premier visé, avec sa symphonie Réformation, que Debussy n'aimait pas. En fait, la symphonie s'est montrée plus vivace, beaucoup plus susceptible de renouvellement qu'il ne l'a dit.
Haydn et Mozart
Officiellement, Haydn est le « père de la symphonie » au sens moderne, c'est lui qui, par ses 104 ou plutôt 106 symphonies cataloguées, écrites de 1757 environ à 1795, a, le premier, donné au genre ses lettres de noblesse. Il s'est, le premier, révélé comme ayant « l'esprit symphonique », cet esprit pouvant se définir comme la faculté de fusionner divers éléments en un tout organique, de maintenir le sens du mouvement et d'exercer sur lui un contrôle continu, de maintenir la musique active ou du moins en activité latente, à tous les niveaux, de suggérer un sens de l'espace tendant vers l'infini et à dimension épique (tout cela par le biais de la forme sonate et d'une conception neuve de la tonalité). On distingue dans la production symphonique de Haydn plusieurs étapes avec notamment les symphonies Sturm und Drang, les 6 Parisiennes et les 12 Londoniennes (nos 93 à 104), ces dernières étant considérées comme le plus haut stade de la pensée symphonique de Haydn. Elles sont les plus proches de la symphonie à venir de Beethoven et de Schubert. Selon certains (cf. Pierre Barbaud), ces œuvres récupèrent et vulgarisent le travail formel accompli dans les quatuors (recherche d'unité thématique fondée sur de courts motifs générateurs, écriture savante), tandis que, pour d'autres, il y a là une richesse d'inspiration qui, en dehors de toute question de proportions extérieures, leur donne l'ampleur et la profondeur de pensée des constructions beethovéniennes.
Le corps des quelque 50 symphonies de Mozart, écrites de 1764 à 1788, n'est pas aussi réputé, pas aussi décisif dans l'évolution du genre (un phénomène inverse se produisit pour celui du concerto pour piano). Les très grandes pages de Mozart pour la symphonie ne sont que d'admirables cas particuliers, tandis que ses concertos forment un ensemble avec un trajet. On a parlé de la « docilité » de Mozart à la forme symphonique. Les 3 dernières symphonies, celles de 1788, sont sublimes, mais il est difficile d'en dégager une essence commune. Elles présentent des audaces et une liberté d'inspiration incontestable, mais ce sont toujours 1 ou 2 mouvements qui se détachent du tout, qui donnent le ton de l'ensemble : l'allégro initial dans la 40e Symphonie en sol mineur, et son menuet ; et, pour la Jupiter, le dernier mouvement. Il semble que Mozart ne s'investisse pas totalement dans la forme symphonique et qu'elle lui reste organiquement extérieure.
Les paradoxes beethovéniens
Les 9 symphonies de Beethoven, créées de 1800 à 1824, ont si fort marqué le genre qu'il n'a plus été possible de faire une symphonie sans en tenir compte dans un sens ou dans l'autre.
Elles sont dans la musique occidentale ce qui parle le plus immédiatement au public le plus large. Il n'est pas jusqu'à leur numérotation qui n'ait acquis une résonance magique. Est-ce à dire qu'elles ont mis au point un modèle, un canon unique de la symphonie ? Justement pas. C'est leur variété qui fascine, à l'intérieur du modèle haydnien, jamais remis en cause de façon fondamentale, pas même dans la 6e Symphonie (Pastorale), ni même dans la 9e (« avec chœurs »). C'est leur autorité comme ensemble, et leur variété dans les tons qui en fait quelque chose d'unique. On peut y trouver en germe toutes les directions prises ultérieurement par la symphonie : la Pastorale préfigure les symphonies descriptives (Richard Strauss) et en même temps les symphonies cosmiques et évocatrices de tableaux naturels de Mahler. Dans la 9e Symphonie, il y a la symphonie mahlérienne avec chœurs et solistes, ainsi que le principe cyclique d'un thème prépondérant amené par la récapitulation des thèmes précédents. Dans cette même œuvre, l'inversion du scherzo par rapport à l'adagio est un geste formel qui sera beaucoup imité, en particulier par Mahler dans sa 6e. La 8e annonce les symphonies néoclassiques, néohaydniennes et vivaces (cf. la Symphonie classique) de Prokofiev. L'Héroïque préfigure toutes les symphonies guerrières, nationales et conquérantes de Dvořák ou Tchaïkovski. Inversement, on peut trouver le germe de la Fantastique de Berlioz dans différentes symphonies de Beethoven : la Scène aux champs rivalise avec la Pastorale, le principe cyclique avec thème conducteur découle un peu de la 5e.
Il y a un côté démonstratif, oratoire, dans la façon dont ces symphonies travaillent la forme : le travail des motifs ne peut être caché, dissimulé, comme dans les ricercari à l'ancienne manière, faits pour l'amateur ; il est, au contraire, affiché, souligné, dramatisé, créant par lui-même la matière d'un drame. Chez Beethoven, l'architecture apparaît en pleine lumière, alors qu'auparavant on cherchait plutôt à la dissimuler. Le travail formel s'exhibe donc avec une certaine impudeur, et les thèmes sont souvent susceptibles de se réduire à une cellule de base rythmique très identifiable : les « quatre coups du destin » dans la 5e Symphonie, le rythme noire-deux croches dans l'adagietto de la 7e, etc.
La symphonie après Beethoven : Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms
Ces quatre compositeurs regroupés sous l'étiquette « romantique » ont composé des symphonies dans la suite directe de leur grand prédécesseur, et chacun a résolu à sa manière le problème de cette paternité. Ainsi, Schubert passait de son vivant, comme on sait, pour un petit maître dans une petite forme : le lied. Peu de gens s'attendaient à ce qu'il donnât des symphonies grandioses et architecturées. Lui-même ne semblait pas s'en juger capable au début, car ses 6 premières symphonies connues sont de proportions modestes et, à part la Tragique, c'est-à-dire la 4e, qui a des accents beethovéniens, renvoient plutôt à Mozart et au Beethoven des 2 premières symphonies. Ces 6 premières symphonies sont des œuvres attachantes, délicieuses, mais très circonscrites et policées dans leur forme, sans ce côté éperdu que Schubert mettait dans ses sonates pour piano et certains de ses quatuors. Mais, après la fameuse Inachevée, classée 8e, la 9e, dite la Grande Symphonie en ut (1825-26), redécouverte elle aussi après la mort de Schubert et saluée par Schumann, réalise complètement l'assimilation du genre : c'est une longue symphonie, mais de ton schubertien. Elle trouve son souffle, non en haussant sa voix ou en s'acharnant sur un travail de forme paralysant, mais en suivant son cours, aussi ductile, aussi coulante qu'une œuvre pour piano.
Œuvres de synthèse, les 5 symphonies de Mendelssohn (si on laisse de côté ses 12 symphonies pour cordes de prime jeunesse [1821-1823]) veulent réconcilier la référence descriptive et évocatrice, ou le message religieux, avec la logique et la fermeté d'une forme classique, comme pour faire la jonction entre le projet romantique de type berliozien et un souci de néoclassicisme. Ainsi, le propos « touristique » des symphonies Italienne et Écossaise n'empêche pas ces œuvres de garder des proportions et une forme sévèrement tenues. La symphonie Réformation est un des premiers exemples de la symphonie « à choral » dont se moque Debussy, mais dont Bruckner devait porter très haut l'inspiration. Et la symphonie avec chœurs Lobgesang est une œuvre festive qui, inévitablement, louche vers la 9e de Beethoven. Un des plus grands soucis de Mendelssohn, avec la retenue orchestrale, reste l'« unité », la cohésion, le souci cyclique qui fait de l'œuvre « un ensemble étroitement noué » : c'est ainsi que l'Écossaise doit s'exécuter d'une traite.
Ce même projet néoclassique de fermer la symphonie sur elle-même est à l'œuvre dans les 4 symphonies de Robert Schumann, qui n'est pas toujours le romantique échevelé qu'on croit : autant, au piano, il se donne toute licence de forme, autant, à l'orchestre, il est respectueux de la tenue formelle de la symphonie, et de son caractère de continuité et de gravité. Il y a évidemment de l'originalité et de la grandeur dans la conception cyclique de la 4e Symphonie en ré mineur entreprise en second, et achevée la dernière, et destinée à être, comme l'Écossaise de Mendelssohn, exécutée d'une traite. On en retient cependant une certaine grisaille et le même sentiment d'obsession tourmentée et laborieuse que dans l'Écossaise ; mais le travail formel a quelque chose d'une machine qui tourne à vide. Ce n'est pas un hasard si les très grandes symphonies postbeethovéniennes sont celles où le compositeur risque tout, se donne tout entier, comme c'est le cas pour Bruckner et Mahler, qui ont investi tout leur travail de compositeur sur ce genre.
Même les belles symphonies de Brahms gardent un côté laborieux et démonstratif qui a fait parler à leur propos d'« inutile beauté ». Brahms a longtemps attendu avant de s'attaquer à la symphonie. Bien sûr, aucune des 4 qu'il composa n'a de programme, ni ne contrevient au modèle classique en 4 parties. Curieusement, dans leur solidité formelle et leur couleur compacte, elles ont parfois plus de séduction, de largeur, d'abandons, de surprises, que les symphonies de Schumann une fois franchi le cap de la 1re Symphonie en ut mineur, qui semble portée à bout de bras par le souci de faire bonne figure à côté de Beethoven, car c'est bien à propos du finale de cette œuvre et de son thème en ut majeur, sorte de pastiche de l'Hymne à la joie savamment amené, qu'on peut légitimement parler de beauté creuse et suffisante. Dès la 2e Symphonie, Brahms se laisse souvent aller au romantisme et à la liberté de ses intermezzi pour piano.
Après Beethoven : Berlioz et Liszt
D'autres compositeurs prirent la suite de Beethoven en considérant implicitement le moule classique comme n'offrant plus de ressources neuves, et en cherchant à ouvrir la symphonie à la liberté. Berlioz et Liszt furent de ceux-là. On sait comment Hector Berlioz s'arrangea pour écrire 4 symphonies dont aucune ne se ressemble, et dont aucune n'est conforme au modèle traditionnel (la Fantastique en 1830 ; Harold en Italie, en 1834 ; Roméo et Juliette en 1839 ; et la Symphonie funèbre et triomphale en 1840). La notion de symphonie devient alors un fourre-tout très utile pour innover, pour expérimenter, à l'abri d'un titre propre à rassurer les foules… et les organisateurs de concerts.
Liszt, admirateur de Berlioz, reprit à ce dernier la forme symphonique libre à programme, avec la Dante-Symphonie (1854) et surtout la Faust-Symphonie (1854-1857), qui annonce les grandes symphonies autobiographiques de Mahler. On rattache souvent au modèle berliozien de la symphonie à programme les deux symphonies descriptives de Richard Strauss, Sinfonia domestica (1904) et Alpensymphonie (Symphonie des Alpes, 1915), sortes de grands dioramas pittoresques qui tiennent en effet plus de la tradition descriptive française que du projet lisztien, lequel est plus dramatique, voire religieux.
L'ultrasymphonie : Anton Bruckner et Gustav Mahler
Nous appelons « ultrasymphonie » la symphonie brucknérienne et mahlérienne, parce qu'elle poursuit le genre en le faisant passer dans une dimension plus large, celle, presque, d'un opéra, d'un parcours dramatique complet et, comme disent les Allemands, « abendfüllend » (« remplissant une soirée »). À part cela, les deux compositeurs ont des démarches et des styles très différents. Bien que très développées, les symphonies de Bruckner conservent les 4 parties classiques, avec un scherzo situé généralement en troisième position, et adoptent pour les mouvements extrêmes une forme sonate élargie et raffinée (avec en général 3 thèmes au lieu de 2). Leur orchestration est grandiose, mais fuit les effets pittoresques et descriptifs. Elles sont concentrées sur elles-mêmes.
Bruckner apparaissait néanmoins à ses contemporains, et non sans raisons, comme un musicien compliqué, névrotique, obscur et wagnérien. Il élabora, en effet, une musique très modulante, raffinée de forme, extrêmement abrupte et pathétique et souvent remise sur le métier. Il porta la nouveauté au sein de la symphonie classique, dont il distendit le modèle en le respectant, la forme ancienne n'ayant pas, contrairement à ce que d'autres pensaient, tout dit avec Beethoven.
À l'opposé, Gustav Mahler voulut étendre ses symphonies aux dimensions du monde, en particulier en y intégrant la voix. Des 9 (ou 10) symphonies achevées, 4 seulement comprennent une importante partie vocale et/ou chorale (2e, 3e, 4e, 8e), mais on peut dire que toutes suivent un « programme » métaphysique et autobiographique, explicite ou implicite. Adorno les a judicieusement comparées à des romans. Reste en outre le cas particulier du Chant de la terre. On connaît la définition personnelle que Mahler en donnait : « Le terme symphonie signifie pour moi : avec tous les moyens techniques à ma disposition, bâtir un monde » (1895) ; et sa boutade au jeune Bruno Walter : « C'est inutile de regarder le paysage, j'ai tout mis dans ma 3e Symphonie » (1896). Il y a souvent plus de 4 mouvements, et l'ordre traditionnel est rarement respecté, Mahler adoptant le genre de la symphonie comme le plus propre à faire accepter par le public des conceptions musicales et stylistiques tout à fait singulières.
Mahler et Bruckner composèrent tous deux après Wagner et d'après Wagner ; ils prennent en compte le phénomène wagnérien dans son énormité, en tirent des inspirations de forme, d'orchestration, d'écriture (travail des motifs), et eurent le même réflexe de ne pas chercher à lutter contre lui sur le terrain où il s'était affirmé : l'opéra. Bruckner distendit le modèle de la symphonie de l'intérieur, dans son tissu même ; Mahler introduisit dans ce tissu des corps étrangers. Le genre s'avéra pour ces deux compositeurs, non pas un ersatz d'opéra, un pis-aller, mais plutôt un magnifique « lieu de projection », à la fois riche, stable, et susceptible d'expansion infinie.
La symphonie française
On aurait pu penser que les Français auraient revendiqué l'exemple de liberté donné par Berlioz. Par un chassé-croisé assez typique, ce fut au contraire Liszt qui s'inspira de Berlioz, tandis que les Français semblent avoir eu à cœur de prouver qu'ils s'entendaient aussi bien que les Allemands à faire de belles symphonies, dans les règles et les proportions classiques : ainsi, Saint-Saëns, Vincent d'Indy, Lalo, Chausson, Paul Dukas, Albéric Magnard, etc. C'est néanmoins la Symphonie en ré mineur de César Franck (1886-1888) qui reste la plus jouée. On a là un admirable exemple de symphonie cyclique, dans laquelle le principe de « retour du thème » ne sonne pas le creux, et où tous les mouvements sont soudés par une affinité profonde.
Les 4 symphonies d'Albert Roussel relèvent d'une solide et talentueuse inspiration néoclassique et sont peut-être parmi les plus spécifiquement françaises du répertoire, dans leur mélange de vivacité, de concentration et de rigueur.
La symphonie « nationale » : Russie, Europe centrale, etc
De manière inattendue et logique, le genre à la fois très codifié et très populaire de la symphonie a servi à des compositeurs issus de pays « excentriques » par rapport à la vieille Europe (Russie, Europe centrale, pays scandinaves, etc.) pour se faire introduire et reconnaître non seulement dans leurs propres pays, mais aussi dans les milieux musicaux de cette vieille Europe. Ces symphonies inspirées par le modèle formel classique prennent souvent une estampille nationale et officielle par l'utilisation de thèmes folkloriques empruntés à la tradition du pays. Ainsi, on fait coup double : on donne à la musique populaire et à la tradition qu'elle représente ses « lettres de noblesse », et, en même temps, on réalise une sorte d'appropriation nationale d'un genre, pour la plus grande gloire de la patrie. Beaucoup de ces symphonies « nationales » et héroïques ne le sont que par l'apparition d'un ou de plusieurs thèmes du fonds populaire, passés à la moulinette d'un même style savant international ; mais, pour énoncer ces thèmes, elles adoptent un ton altier, un ton de proclamation, qui donne au moindre motif une allure de déclaration d'indépendance ou de patriotisme. Or, le ton « national » que l'orchestre peut prendre est le même pour tous les pays. Debussy s'est moqué avec esprit de cette veine « folklorique », qui, pourtant, a aidé bien des cultures nationales à s'affirmer et à se faire respecter, en passant l'examen de passage de la symphonie réglementaire.
« La jeune école russe, dit Debussy, tenta de rajeunir la symphonie en empruntant des idées aux thèmes populaires : elle réussit à ciseler d'étincelants bijoux ; mais n'y avait-il pas là une gênante disproportion entre le thème et ce qu'on l'obligeait à fournir de développements ? Bientôt, cependant, la mode du thème populaire s'étendit sur tout l'univers musical : on remua les moindres provinces, de l'est à l'ouest ; on arracha à de vieilles bouches paysannes des refrains ingénus, tout ahuris de se retrouver vêtus de dentelles harmonieuses. Ils en gardèrent un petit air tristement gêné ; mais d'impérieux contrepoints les sommèrent d'avoir à oublier leur paisible origine. » Cette remarque est pertinente pour une œuvre folklorisante un peu empruntée comme la Symphonie sur un chant montagnard français de Vincent d'Indy. En revanche, pour la jeune école russe ou toute autre jeune école nationale, Debussy se trompe en affectant de croire que c'était pour « rajeunir la symphonie » que les compositeurs de ces pays empruntaient des thèmes à leur culture populaire alors que c'était plutôt pour appuyer leur jeune talent et leur propre culture sous l'autorité d'un genre ancien et respecté.
Glinka parla cependant de la difficulté de marier la musique populaire à la technique allemande du développement. Tchaïkovski, dans ses 6 symphonies, évolua de la symphonie folklorisante à la symphonie autobiographique. On doit également des symphonies basées sur des thèmes populaires russes à Rimski-Korsakov, Borodine, Balakirev, Glazounov et plus tard Rachmaninov.
En Tchécoslovaquie, Smetana incorpora le folklore national dans sa Symphonie triomphale (1853), et Dvořák ne composa pas moins de 9 symphonies entre 1865 et 1893, avec, en particulier, des scherzos et des mouvements lents portant souvent une inspiration populaire. Les pays scandinaves eurent également leurs symphonistes nationaux, comme le Suédois Franz Berwald, les Danois Niels Gade et Carl Nielsen, et surtout le Finlandais Jean Sibelius, qui, avec ses 7 symphonies données entre 1899 et 1924, s'imposa comme un des principaux rénovateurs du genre. En Grande-Bretagne, un des pays qui, au xxe siècle, a le plus cultivé la symphonie, il faut citer avant tout les 2 d'Elgar, les 9 de Vaughan Williams, les 4 de Michael Tippett, les 5 de Peter Maxwell Davies.
Bien que composées au xxe siècle, on peut situer dans la continuité des écoles nationales les créations symphoniques de Prokofiev et de Chostakovitch. Le premier composa 7 symphonies, dont la première, la Symphonie classique (1916-17), rend un hommage à Haydn en forme de pastiche. Les suivantes évoluent d'un modernisme tonitruant (cf. la 3e) jusqu'à une inspiration populaire et dynamique représentée par les 3 dernières.
Quant à Chostakovitch, pour qui la symphonie était « le plus complexe de tous les genres et le plus accessible à l'oreille des masses », il en écrivit 15, où se retrouvent toutes les vocations extramusicales du genre.
Retour à la symphonie pure
On s'est aussi préoccupé de refaire de la symphonie un genre de « musique pure », de l'arracher aux longueurs mahlériennes, aux confessions et aux messages. Il est significatif de voir comment Schönberg et, surtout, Webern ont fait porter sur la symphonie, comme genre symptôme, leur effort de concentration et de resserrement : qu'il s'agisse des 2 Symphonies de chambre de Schönberg ou de la très incisive et transparente Symphonie op. 21 (1928) d'Anton Webern, pur et bref exercice d'écriture sérielle, où l'orchestre réduit est atomisé en parties solistes. Dans un style tout différent, Hindemith a poursuivi le même propos, qui était de redonner à la symphonie sa dignité de genre objectif construit sur une forme, non sur des idées. Après la guerre, en Allemagne, Karl Amadeus Hartmann et Hans Werner Henze ont continué dans cette voie, et compte non tenu de la Symphonie de psaumes et des Symphonies d'instruments à vent, dont le titre se réfère au sens ancien du terme, Stravinski a réalisé avec sa Symphonie en ut (1940) et sa Symphonie en trois mouvements (1945) des œuvres ostensiblement néoclassiques et objectives, dégagées de tout message comme de tout romantisme. Mais l'immense production de la symphonie « américaine » atteste que pour ce jeune pays, comme pour les Tchèques, la symphonie est une façon de se relier au tronc commun de la musique occidentale. À côté de la symphonie néoclassique, on y trouve des symphonies d'esprit mahlérien comme celles de Charles Ives. On peut citer aussi celles de Walter Piston, Samuel Barber, Aaron Copland, William Schumn, etc., et pour l'Amérique du Sud, celles de Carlos Chavez, Heitor Villa-Lobos, de Vagn Holmboe pour le Danemark, de Hilding Rosenberg pour la Suède, de Melartin, Klami, Englund, Kokkonen, Sallinen, Rautavaara, Aho, Kaipainen pour la Finlande, etc.
La symphonie française moderne
Ni Debussy, ni Ravel, ni Fauré n'ont laissé de symphonies : le genre était sans doute pour eux trop conventionnel et usé. Mais il fut repris et illustré par des compositeurs du groupe des Six : Darius Milhaud, fidèle à son optique méditerranéenne, compose des symphonies d'un style assez délié et il ose même en faire plus de 9, affrontant l'interdit auquel ni un Tchèque comme Dvořák ni un Finlandais comme Sibelius n'avaient osé déroger. On ne lui doit pas moins de 12 symphonies pour grand orchestre et 6 symphonies pour orchestre de chambre. Quant à Arthur Honegger, il s'est recréé dans ses 5 symphonies sa propre tradition, intégrant librement les références germaniques sous une forme ramassée en 3 mouvements seulement. C'est de cette tradition humaniste que s'est réclamé Marcel Landowski pour ses 3 symphonies, dont Jean de la Peur (1949), tandis que Serge Nigg, lui, dans sa Jérôme Bosch-Symphonie (1960), s'est référé au poème symphonique. La Turangalila-Symphonie (1946-1948) d'Olivier Messiaen, avec son orchestre colossal et ses 10 mouvements, pourrait être d'un Mahler français contemporain. On peut citer aussi les 13 symphonies de Georges Migot (1919-1967), les 5 d'André Jolivet (1953-1964), les 7 de Jean Rivier, celles d'Henri Barraud, Georges Hugon, Jacques Chailley, Jean Martinon, Alain Bancquart, etc.
Parmi les symphonies françaises contemporaines les plus célèbres et les plus personnelles se distinguent celles d'Henri Dutilleux, qui prouve que la forme et le nom de « symphonie » sont encore capables d'inspirer les œuvres les plus variées et les plus personnelles. L'époque moderne n'a pas tué la symphonie. On peut citer, par exemple, la Sinfonia, de Luciano Berio (1968), qui se défend d'être une symphonie alors qu'elle en présente bien des caractères. La vitalité de la symphonie montre que ce genre est à la fois forme et esprit, au carrefour de la musique « pure » et de la musique « à idées », genre synthétique où la musique occidentale a trouvé un lieu de projection sans égal.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|