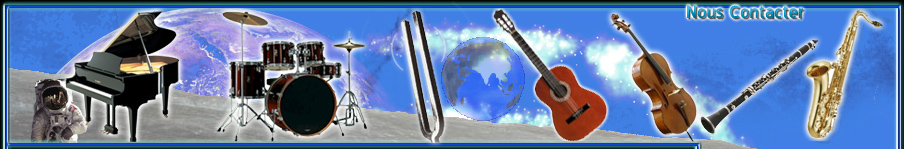|
|
|
|
 |
|
VOLTAIRE |
|
|
| |
|
| |
François Marie Arouet, dit Voltaire
Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
Écrivain français (Paris 1694-Paris 1778).
Voltaire, l’un des philosophes des Lumières les plus importants, a connu une vie mouvementée marquée par l’engagement au service de la liberté. Travailleur infatigable et prolixe, il laisse une œuvre considérable et très variée qui touche à tous les domaines, renouvèle le genre historique et donne au conte ses lettres de noblesse.
Famille
Il est né le 21 novembre 1694 ; son père est notaire et conseiller du roi ; sa mère meurt alors qu’il est âgé de sept ans.
Formation
Il est placé chez les jésuites du collège Louis-le-Grand (ancien collège de Clermont), puis fait des études à la faculté de droit de Paris.
Début de sa carrière
À partir de 1715, il fréquente les milieux libertins et les salons littéraires, compose des écrits satiriques qui le conduisent à la Bastille. En prison, il rédige Œdipe (1717). Il fait des voyages en Europe et connaît des intrigues de cour. Il continue à écrire pour le théâtre et commence une épopée, la Ligue (1723), première version de la Henriade (1728). Une altercation avec le chevalier de Rohan-Chabot lui vaut douze jours à la Bastille, puis l’exil en Angleterre (1726).
Premiers succès
Rentré en France en 1728, il fait jouer son théâtre ; il triomphe avec sa pièce Zaïre (1732). Il se retire à Cirey, chez Mme du Châtelet. Les Lettres philosophiques connaissent un succès de scandale (1734), de même que le poème provocateur le Mondain (1736).
Tournant de sa carrière
Il est rappelé à Paris où il est nommé historiographe du roi (1745). Parallèlement à son travail d’historien (le Siècle de Louis XIV, 1752 ; Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1756), il commence à rédiger des contes satiriques (Zadig, 1748 ; Micromégas, 1752). Il accepte l’invitation de Frédéric II de Prusse et part pour Potsdam (1750). En 1755, il s’installe en Suisse, où sera publié Candide (janvier 1759) et, enfin, dans un village français près de la frontière suisse, Ferney (décembre 1758-février 1759).
Dernière partie de sa carrière
Devenu l’« hôte de l’Europe », il intervient dans des « affaires » (Calas, Sirven, La Barre). Il poursuit son combat en faveur de la tolérance (Traité sur la tolérance, 1763 ; Dictionnaire philosophique portatif, 1764) sans toutefois abandonner le conte (l’Ingénu, 1767). Il meurt le 30 mai 1778. Treize ans plus tard, en 1791, ses restes sont transférés solennellement au Panthéon.
1. La vie de Voltaire
1.1. La formation initiale (1694-1713)
François Marie Arouet est le cinquième enfant de François Arouet (1649-1722) et de Marguerite Daumart (vers 1661-1701) [sur les six enfants de la famille, trois meurent en bas âge]. Son père, notaire royal, puis payeur des épices à la Chambre des comptes, est en relations professionnelles et personnelles avec l'aristocratie. Il fait donner à ses fils la meilleure éducation possible. Pour l'aîné Armand, vers 1695, c'est celle des Oratoriens. Pour François Marie, en 1704, c'est celle des jésuites du collège Louis-le-Grand. La mésentente entre les deux frères vient sans doute en partie de là. Elle sera doublée de difficultés entre le père et le fils, lorsque le libertinage et la vocation littéraire apparaîtront simultanément. Voltaire affecte parfois de ne pas être le fils de son père, mais du chansonnier Rochebrune : affirmation agressive d'indépendance – la plaisanterie sur sa bâtardise est considérée de nos jours comme le signe d'une phobie et d'une hantise qui se retrouvent dans l'attitude de Voltaire devant Dieu, père au terrible pouvoir.
Son adolescence subit l'influence de l'humanisme jésuite et celle du libertinage mondain. Aux Jésuites, Voltaire doit sa culture classique, son goût assez puriste, le souci de l'élégance et de la précision dans l'écriture, son amour du théâtre et même, en dépit d'eux, les bases de son déisme. Aux libertins du Temple, son épicurisme, son esprit plaisant et irrévérencieux, son talent dans la poésie légère.
1.2. Première expérience de l’écriture polémique (1713-1726)
Mais Voltaire ne se contente pas d'être un homme de plaisir : il y a dans son art de jouir une insolence qui lui vaut d'être envoyé par son père à Caen, puis à La Haye en 1713, d'être confiné à Sully-sur-Loire en 1716 sur ordre du Régent (sur lequel on dit qu’il a écrit quelques vers assassins) et embastillé en 1717. Dès ce moment, il prépare deux grandes œuvres, d'une tout autre portée que ses vers épicuriens : la tragédie Œdipe, triomphalement représentée en novembre 1718, et le poème de la Ligue, paru en 1723, qui deviendra en 1728 la Henriade. Il veut maintenant imiter Sophocle et Virgile. Le libertin commence à se faire philosophe en lisant Malebranche, Bayle, Locke et Newton.
C'est en 1718 qu'il prend le pseudonyme de Voltaire (d'abord Arouet et Voltaire), peut-être formé à partir d'Airvault, nom d'un bourg poitevin où ses ancêtres ont résidé. Le chevalier de Rohan (1683-1760), qui le fait bâtonner et, humiliation pire, de nouveau embastiller en 1726, semble avoir interrompu une carrière admirablement commencée d'écrivain déjà illustre et de courtisan. En fait, il rend Voltaire à sa vraie vocation, qui aurait certainement éclaté d'une façon ou d'une autre, car on ne peut guère imaginer qu'il se soit contenté d'être poète-lauréat.
1.3. Séjour en Angleterre (1726-1728)
C'est Voltaire lui-même qui demande la permission de passer en Angleterre. Y a-t-il découvert ce dont il n'avait aucune idée et subi une profonde métamorphose ? Y a-t-il, au contraire, trouvé ce qu'il était venu y chercher, appris ce qu'il savait déjà ? Les deux thèses ont été soutenues. On admet maintenant que s'il a, avant son voyage, lu des ouvrages traduits, s'il a aussi adopté par ses propres cheminements des vues déjà « philosophiques » sur Dieu, sur la Providence, sur la société, sur la tolérance, sur la liberté, il n'est pourtant pas en état, dans les années 1726-1728, d'assimiler complètement la science et la philosophie anglaises.
Mais Voltaire fait l'expérience d'une civilisation, dont il sent et veut définir ce qu'il appelle l'esprit ou le génie. Il comprend l'importance pour la pensée et la littérature françaises de connaître ces Anglais, avec qui le Régent a noué alliance, et il réunit une masse de notations, d'idées, de questions, de problèmes, d'anecdotes, de modèles formels dont il ne cessera de tirer parti pendant tout le reste de son existence.
Les Lettres philosophiques, ou Lettres anglaises, conçues bien avant la fin de son séjour en Angleterre, paraissent en anglais dès 1733, en français en 1734. Elles sont, malgré leurs erreurs et leurs lacunes, l'un des essais les plus réussis pour ce qui est de comprendre et donner à comprendre le fonctionnement d'une société étrangère et le lien entre des institutions, des mœurs et une culture sous le signe de la liberté.
1.4. Retour en France : spéculation financière et clandestinité (1728-1734)
De son retour en France (1728) à son installation en Lorraine, à Cirey (1734), Voltaire vit quelques années tiraillé : entre le monde et la retraite, le succès et les persécutions, la publication des œuvres achevées et la mise en chantier d'œuvres nouvelles.
Il fait applaudir Brutus (décembre 1730) et Zaïre (août 1732), mais son Histoire de Charles XII est saisie (janvier 1731). Son Temple du goût soulève des protestations violentes (janvier 1733), ses Lettres philosophiques (avril 1734), longuement revues et auxquelles il a ajouté les remarques « Sur les Pensées de M. Pascal », sont brûlées, et l'auteur doit se réfugier en Lorraine (mai 1734) pour échapper à une lettre de cachet (écrit formel du roi ordonnant l'incarcération ou l'exil). En mai 1732, il avait pour la première fois fait mention de son projet d'écrire l'histoire de Louis XIV.
C'est pendant cette période qu'il met au point deux moyens d'assurer sa liberté d'écrire, et dont il ne cessera désormais d'user : la spéculation, qui lui procurera l'aisance matérielle puis la richesse, et la clandestinité, dans laquelle il prépare l'impression et la diffusion de ses œuvres.
1.5. La retraite à Cirey (1734-1750)
1.5.1. Période studieuse (1734-1740)
Voltaire s'est installé à Cirey, en Haute-Marne, chez Mme du Châtelet (Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, 1706-1749). C'est le lieu de sa retraite et le centre de ses activités jusqu'à la mort de sa maîtresse. Plusieurs raisons lui ont fait souhaiter de se retirer pendant quelques années : les poursuites entamées contre lui, le besoin de se recueillir pour l'œuvre de longue haleine que va être le Siècle de Louis XIV, le sentiment qu'il doit acquérir en science et en philosophie les connaissances qui lui manquent, et au seuil desquelles l'achèvement des Lettres philosophiques l'a conduit.
De 1734 à 1738 s'accomplit ce que l'on a appelé la rééducation de Voltaire. Il était déjà philosophe par son esprit critique, par ses idées sur la religion, sur la société, sur le bonheur. Il le devient au sens encyclopédique où son siècle doit entendre le mot : en se faisant métaphysicien, physicien, chimiste, mathématicien, économiste, historien, sans jamais cesser d'être poète et d'écrire des comédies, des tragédies, des épîtres ou des vers galants.
Avec Mme du Châtelet, il commente Newton, Leibniz, Christian von Wolff, Samuel Clarke, Bernard de Mandeville et fait des expériences de laboratoire. Sa correspondance avec Frédéric II de Prusse et le rôle qu'il espère jouer auprès du prince l'amènent à s'instruire sur la diplomatie et sur les problèmes économiques.
Toutes ces activités et ces recherches, qui explorent le concept de civilisation, aboutissent au Traité de métaphysique (Voltaire y travaille du début de 1734 à la fin de 1736, l'ouvrage ne sera pas publié de son vivant), aux Éléments de la philosophie de Newton (publiés en 1738), au Siècle de Louis XIV (une première version est prête en 1738, le début est publié en 1739 et aussitôt saisi), aux sept Discours sur l'homme (composés et diffusés plus ou moins clandestinement en 1738) et au projet de l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations.
1.5.2. Période d'instabilité (1740-1750)
Mais la retraite à Cirey n'est ni constante, ni solitaire, ni même toujours tranquille. Les visiteurs se succèdent. On fait du théâtre. On lit les œuvres toutes fraîches. On veille sur les manuscrits, qui sont comme des explosifs prêts à éclater : Voltaire entre en fureur quand des pages de la Pucelle disparaissent de leur tiroir. Il doit fuir en Hollande quand le texte du Mondain circule (novembre 1736).
La seconde partie de la période de Cirey est encore plus agitée : voyages à Lille auprès de sa nièce Mme Denis (qui devient sa maîtresse à partir de 1744), voyages à Paris pour la représentation, vite interdite, de Mahomet (août 1741) et pour celle de Mérope, triomphale (février 1743). Il rencontre Frédéric II à Wesel, près de Clèves (septembre 1740), part en mission diplomatique à Berlin et en Hollande (1743-1744), séjourne à Versailles pour la représentation de la Princesse de Navarre et celle du Temple de la gloire (1745).
Voltaire cherche, en effet, à obtenir la faveur de Louis XV. Son Poème de Fontenoy est imprimé par l'imprimerie royale (1745). Il est finalement nommé historiographe de France (avril 1745), élu à l'Académie française (avril 1746), avant de recevoir le brevet de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi (décembre 1746). Les académies de province et de l'étranger rivalisent pour le compter parmi leurs membres. Il est reçu à Sceaux chez la duchesse du Maine, pour laquelle il écrit ses premiers Contes.
Mais, comme en 1726, l'édifice de son succès s'effondre quand il peut se croire au sommet. L'épisode du jeu de la reine (où Voltaire dit à Mme du Châtelet, qui perdait tout ce qu'elle misait, qu'elle jouait avec des coquins) est moins autant une des causes de sa disgrâce que la conséquence et le symbole de la conduite qu'il a adoptée. Il n'aurait en effet jamais sacrifié son œuvre et sa pensée à la quête des faveurs royales, dont il voulait se faire un bouclier, et le roi savait fort bien qu'il n'était pas un courtisan sincère. La mort de Mme du Châtelet prive Voltaire de son refuge, mais le délie de la promesse qu'il a faite de ne pas répondre à l'invitation de Frédéric.
1.6. Auprès de Frédéric II de Prusse (1750-1754)
1.6.1. Entre admiration et défiance réciproques
À son arrivée à Potsdam, en juillet 1750, Voltaire n'a plus d'illusions sur le roi-philosophe. Il comprend bien que la guerre et l'intrigue passeront toujours avant la philosophie aux yeux de celui qui lui a soumis, en 1740, une réfutation de Machiavel, mais a envahi la Silésie dès 1741. Le souverain et l'écrivain éprouvent l'un pour l'autre un sentiment étrange et violent, mélange d'admiration, d'attachement, de défiance et de mépris. Ce qu'ils se sont écrit l'un à l'autre, et ce qu'ils ont écrit l'un de l'autre, est à interpréter en fonction de toutes leurs arrière-pensées. Voltaire doit se justifier devant l'opinion française, et peut-être à ses propres yeux, d'être allé servir le roi de Prusse : celui-ci accable Voltaire de flatteries tout en le calomniant auprès du gouvernement français, pour lui interdire le retour en France. Le 15 mars 1753, Voltaire reçoit néanmoins le droit de quitter la Prusse.
1.6.2. Une période féconde malgré tout
En peu de temps, Voltaire apprend beaucoup sur le pouvoir politique, sur la parole des rois, sur le rôle des intellectuels, et son expérience humaine, déjà variée, renforce encore davantage son caractère cosmopolite. Il travaille aussi beaucoup, malgré les divertissements, les corvées et les polémiques. En vérité, il songe d'abord à son travail en acceptant l'invitation de Frédéric II. Le Siècle de Louis XIV paraît (1752). Voltaire rédige de grands morceaux de l'Histoire universelle (le futur Essai sur les mœurs et l'esprit des nations), que déjà les éditeurs pirates s'apprêtent à publier d'après des manuscrits volés. Il pense à écrire son Dictionnaire philosophique portatif. Il donne, sous le titre de Micromégas (1752), sa forme définitive à un conte dont le premier état datait peut-être de 1739, et compose le Poème sur la loi naturelle, qui paraît en 1755.
1.6.3. De nouveau en quête d'un abri
Pendant un an et demi, de mars 1753 à novembre 1754, Voltaire cherche un abri. Malgré le bon accueil qu'il reçoit de plusieurs princes d'Allemagne, à Kassel, à Gotha, à Strasbourg, à Schwetzingen, les motifs de tristesse s'accumulent : deux représentants de Frédéric l'ont cruellement humilié et retenu illégalement prisonnier à Francfort (29 mai-7 juillet 1753). Les éditions pirates de ses œuvres historiques et les manuscrits de la Pucelle se multiplient. Mme Denis semble disposée à l'abandonner. Sa santé chancelle. À Colmar, pendant l'hiver de 1753, il songe au suicide. Mais il ne cesse de travailler : cela le sauve.
1.7. Le patriarche (1754-1778)
1.7.1. La retraite à Ferney : une activité intense
En novembre 1754, Voltaire s'installe à Prangins (commune suisse du canton de Vaud), puis en mars 1755 près de Genève dans le domaine de Saint-Jean qu'il rebaptise « les Délices ». S'ensuivent des querelles et même des menaces d'expulsion, à cause des représentations théâtrales auxquelles il doit renoncer, à cause aussi du scandale de l'article « Genève », écrit par d'Alembert dans l’Encyclopédie, où l'on reconnaît son influence.
En décembre 1758, Voltaire achète le château de Ferney (dans l'Ain, près de la frontière suisse), où il ne s'installe qu'en 1759. Il y restera jusqu'à l'année de sa mort et y devient le « grand Voltaire », le « patriarche » qui reçoit des visiteurs de tous pays et correspond avec le monde entier – il dicte ou écrit parfois jusqu'à quinze ou vingt lettres à la suite. Il travaille de dix à quinze heures par jour, fait des plantations, construit des maisons, fonde des manufactures de montres, de bas de soie, donne des représentations théâtrales, des repas, des bals. Ainsi, en une vingtaine d'années, il lance dans le public plus de quatre cents écrits, depuis la facétie en deux pages jusqu'à l'encyclopédie philosophique en plusieurs volumes.
Candide, qui paraît en 1759, marque la fin d'une période d'inquiétude, au cours de laquelle il publie pourtant les Annales de l'Empire (1753) et l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations (1756). Il écrit, à la suite du tremblement de terre ayant détruit la ville, le Poème sur le désastre de Lisbonne (1756) et la première partie de l'Histoire de la Russie sous Pierre le Grand (1759). Il achève et fait paraître l'Orphelin de la Chine (1755), travaille à l'édition générale de ses œuvres entreprise par les frères Cramer. Il tente aussi, sans succès, d'arrêter la guerre en servant d'intermédiaire entre le duc de Choiseul et Frédéric II.
Dans l'immense production de Ferney figurent des tragédies comme Tancrède (1759), Olympie (1764), les Scythes (1768), les Guèbres (1769), les Lois de Minos (1772), Irène (1778), quelques comédies, le commentaire du théâtre de Corneille, des études historiques (Histoire du parlement de Paris, le Pyrrhonisme de l'Histoire, Fragment sur l'histoire générale), des études juridiques (Commentaire du livre des délits et des peines [de Beccaria], Commentaire sur l'Esprit des lois, le Prix de la justice et de l'humanité), des épîtres au roi de Chine, au roi du Danemark, à l'impératrice de Russie, à Boileau, à Horace, etc. Mais même les œuvres de pure littérature ou d'érudition sont liées aux polémiques dans lesquelles Voltaire est engagé, et chacune ne trouve son sens que replacée dans les circonstances qui l'ont fait naître. Il arrive à l'auteur d'expédier en quelques jours une tragédie, à la fois pour attirer l'attention du roi et obtenir la permission de revenir à Paris, qui lui est refusée aussi obstinément par Louis XVI qu'elle l'a été par Louis XV.
1.7.2. Défense de la liberté de pensée
Dispute de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau
Tout sert le combat philosophique. « Écr. l'inf. », c'est-à-dire « Écrasons l'infâme », répète-t-il à ses correspondants – l'« infâme » étant la superstition, la religion en général et la religion catholique en particulier. Le combat vise aussi l'injustice, l'arbitraire, l'obscurantisme, la sottise, tout ce que Voltaire juge contraire à l'humanité et à la raison. Sa première arme étant le ridicule, satires, épigrammes et facéties bafouent les croyances et les usages qu'il condamne. Elles pleuvent sur Fréron, Omer de Fleury, les frères Le Franc de Pompignan, Jean-Jacques Rousseau, Chaumeix, Needham, Nonnotte, Patouillet, et bien d'autres ennemis récents ou de vieille date. Plusieurs de ces railleries mordantes sont restées célèbres : la Relation de la maladie, de la confession, de la mort et de l'apparition du jésuite Berthier, le Pot-Pourri, les Anecdotes sur Bélisaires ou la Canonisation de saint Cucufin.
Selon un dessein conçu depuis longtemps, Voltaire réunit des articles d'un ton plus sérieux, souvent tout aussi satirique, sur des sujets théologiques ou religieux (le Dictionnaire philosophique portatif, 1764, plusieurs fois réédité, augmenté à chaque réédition, devenu en 1769 la Raison par alphabet, puis simplement le Dictionnaire philosophique) ou sur tous les sujets de philosophie, législation, politique, histoire, littérature, où le philosophe a son mot à dire (Questions sur l'Encyclopédie, à partir de 1770). Il met en forme les recherches de critique religieuse et de critique biblique qu'il a commencées à Cirey avec Mme du Châtelet, et une vingtaine d'essais ou de traités sortent de Ferney de 1760 à 1778 : Sermon des Cinquante (1762), Traité sur la tolérance (1763), Questions sur les miracles (1765), Examen important de Milord Bolingbroke (1766), le Dîner du comte de Boulainvilliers (1768), Collection d'anciens évangiles (1769), Dieu et les hommes (1769), la Bible enfin expliquée (1776), Histoire de l'établissement du christianisme (1777).
Voltaire a des alliés dans ce combat, les encyclopédistes d'Alembert et Marmontel, et il prend leur défense quand ils sont persécutés. Mais, à mesure que se développe en France une philosophie athée, dont les porte-parole sont, entre autres, Diderot et d'Holbach, il ressent le besoin de raffermir les bases de sa propre philosophie, qui est loin d'être toute négative. Il le fait dans des dialogues comme le Douteur et l'Adorateur (1766 ?), l'A.B.C. (1768), les Adorateurs (1769), Sophronime et Adelos (1776), Dialogues d'Evhémère (1777) et dans des opuscules comme le Philosophe ignorant (1766), Tout en Dieu (1769), Lettres de Memmius à Cicéron (1771), Il faut prendre un parti ou le principe d'action (1772).
1.7.3. Le polémiste engagé
Enfin, la satire et la discussion ne suffisent pas à Voltaire. Il fait appel à l'opinion publique et intervient dans des affaires judiciaires qui l'occupent et l'angoissent pendant plusieurs années : affaires Calas, Sirven, Montbailli, La Barre, Lally-Tollendal. Les Contes (l'Ingénu, la Princesse de Babylone, l'Histoire de Jenni, le Taureau blanc) sont la synthèse fantaisiste de toutes ces polémiques et de toutes ces réflexions, pour la joie de l'imagination et de l'intelligence…
Le 5 février 1778, après avoir envoyé devant lui en reconnaissance Mme Denis, Voltaire part sans autorisation pour Paris et y arrive le 19. Sa présence soulève la foule, les visiteurs se pressent à son domicile, la loge des Neuf-Sœurs lui donne l'initiation. L'Académie française lui fait présider une de ses séances, la Comédie-Française – où l'on joue sa pièce Irène – fait couronner son buste sur la scène en sa présence.
Voltaire meurt le 30 mai, en pleine gloire. Son cadavre, auquel le curé de Saint-Sulpice et l'archevêque de Paris refusent la sépulture, est transporté clandestinement et inhumé dans l'abbaye de Seillières par son neveu, l'abbé Vincent Mignot.
Après la Révolution, le 11 juillet 1791, son corps entre en grande pompe au Panthéon, accompagné par l'immense cortège des citoyens reconnaissants, lors de la première cérémonie révolutionnaire qui se déroule sans la participation du clergé. Son épitaphe porte ces mots : « Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit humain, et lui apprit à être libre. »
2. L'œuvre de Voltaire
2.1. Le Voltaire historien
2.1.1. Une nouvelle méthode historique
Voltaire a voulu que l'histoire soit philosophique et n'a cessé de faire avancer parallèlement ses travaux historiques et ses réflexions sur les méthodes et les objectifs de l'historien. Parti d'une conception épique et dramatique, qui a pu faire dire que la Henriade était une histoire en vers et l'Histoire de Charles XII une tragédie en prose, il a voulu ensuite faire le tableau d'un moment de haute civilisation dans un pays (le Siècle de Louis XIV), puis retracer l'histoire de la civilisation dans l'univers entier, en commençant au point où Bossuet avait arrêté son Discours sur l'histoire universelle (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII, qui devait d'abord être une Histoire générale ou une Histoire de l'esprit humain).
Voltaire entend respecter plusieurs principes, qu'il a de mieux en mieux précisés avec le temps : les faits doivent être exactement établis, contrôlés par la consultation des témoins oculaires et des documents écrits ; tout ce qui est contraire à la raison, à la vraisemblance et à la nature doit être écarté ; les récits légendaires et les miracles n'ont pas leur place dans une œuvre historique, sauf comme exemples de la crédulité et de l'ignorance des siècles passés. Voltaire reproche à ses prédécesseurs et à ses contradicteurs moins leur manque de connaissances que leur manque de jugement. Il s'acharne à dénoncer leurs « bévues » et leurs « sottises ».
Tous les faits, même avérés, ne sont pas à retenir : l'érudition historique a réuni depuis le début du xviie s. une immense documentation, et le critère du tri à faire dans cette documentation est la signification humaine des faits. De sorte que Voltaire s'intéresse moins aux événements, batailles, mariages, naissances de princes, qu'à la vie des hommes « dans l'intérieur des familles » et « aux grandes actions des souverains qui ont rendu leurs peuples meilleurs et plus heureux ». Il ne renonce pas à raconter : l'Histoire de Charles XII est une narration. Les chapitres narratifs dans le Siècle de Louis XIV sont les plus nombreux, mais le récit est rapide et clair. Il vaut une explication et il comporte une signification critique, parfois soulignée d'un trait d'ironie.
Les idées, la religion, les arts, les lettres, les sciences, la technique, le commerce, et ce que Voltaire appelle les « mœurs » et les « usages », occupent une place croissante : ils constituent la civilisation, dont Voltaire écrit l'histoire, sans la nommer, puisque le mot n'existait pas encore.
2.1.2. Trois causes à l'œuvre dans l'histoire
Voltaire voit agir dans l'histoire trois sortes de causes : les grands hommes, le hasard et un déterminisme assez complexe, où se combinent des facteurs matériels – comme le climat et le tempérament naturel des hommes – et des facteurs institutionnels, comme le gouvernement et la religion. De ces dernières causes, il ne cherche pas à démêler le « mystère » : il lui suffit d'affirmer que tout s'enchaîne. Le hasard est ce qui vient dérouter les calculs humains, les petites causes produisant les grands effets. Ici encore, Voltaire est en garde contre une explication trop ambitieuse de l'histoire. Quant aux grands hommes, ils peuvent le mal comme le bien, selon leur caractère et selon le moment où ils apparaissent. Ceux qui comptent aux yeux de l'historien sont ceux qui ont conduit leur pays à un sommet de civilisation : Périclès, Philippe de Macédoine et Alexandre le Grand dans la Grèce antique ; César et Auguste à Rome ; les Médicis au temps de la Renaissance italienne ; Louis XIV dans la France du xviie s.
Voltaire n'ignore pas que ces grands hommes ont rencontré des circonstances favorables et ont été puissamment secondés, qu'ils n'ont pas tout fait par eux-mêmes, que, dans l'intervalle des siècles de « génie », l'humanité a continué à progresser. Mais son scepticisme et son pessimisme sont plus satisfaits de reporter sur quelques individus exceptionnels l'initiative et la responsabilité de ce qui fait le prix de la vie humaine.
2.1.3. Une histoire polémique
Voltaire écrit l'histoire également en polémiste et, malgré son désir de tout comprendre, en civilisé de l'Europe occidentale. Ses jugements sont orientés par les combats philosophiques, par les problèmes propres à son époque et par les intérêts d'un homme de sa culture et de son milieu. Il est assez mal informé des mécanismes économiques. Il considère comme plus agissantes les volontés humaines. Il a délibérément renoncé à rendre compte du mouvement de l'histoire par un principe philosophique, métaphysique, sociologique ou physique : il pense que l'histoire, à son époque, doit devenir une science, non pas parce qu'elle formulera des lois générales, mais parce qu'elle établira exactement les faits et déterminera leurs causes et leurs conséquences.
Plusieurs de ces défauts qu'on reproche à Voltaire sont sans doute des qualités. En tout cas, les discussions actuelles sur l'ethnocentrisme ou sur la possibilité d'une histoire scientifique prouvent qu'on ne peut opposer à la conception voltairienne de l'histoire que des conceptions aussi arbitraires. Il reste que Voltaire a débarrassé l'histoire de la théologie et de toute explication par la transcendance, et qu'il l'a, en sens inverse, arrachée à l'événementiel, à la collection minutieuse de faits particuliers.
Historien humaniste, Voltaire a établi un ordre de valeurs dans les objets dont s'occupe l'histoire, mettant au premier rang le bonheur sous ses formes les plus évoluées. Il a ainsi fait apparaître un progrès que l'historien ne doit pas seulement constater, mais auquel il doit contribuer en inspirant l'horreur pour les crimes contre l'homme. Au récit des actions commises par les « saccageurs de province [qui] ne sont que des héros » (Lettre à A.M. Thiriot, 15 juillet 1735), il a tenté de substituer le récit d'une action unique : la marche de l'esprit humain.
Les principaux essais historiques de Voltaire
2.2. Le Voltaire dramaturge
Au théâtre, l'échec est presque complet, si l'on met à part l'utilisation de la scène comme d'une tribune. Voltaire aimait trop le théâtre : l'histrion en lui a tué le dramaturge, qui, pourtant, avait des idées nouvelles et n'avait pas en vain essayé de comprendre Shakespeare – dont il reste le principal introducteur en France. Son plus grand succès théâtral fut Zaïre (1732) : la pièce a été traduite dans toutes les langues européennes et jouées par les comédiens-français 488 fois jusqu'en 1936.
Il y a certes de beaux passages, du pathétique, du chant dans les tragédies d'avant 1750 (Zaïre, 1732 ; Mérope, 1743). Mais peut-être faudrait-il mettre toutes les autres en prose pour faire apparaître leurs qualités dramatiques. On peut trouver un réel intérêt à quelques pièces en prose, étrangères à toute norme, comme Socrate (1759) ou l'Écossaise (1760) : pour Voltaire, c'était d'abord des satires, elles ont pourtant un accent moderne qui manque trop souvent aux drames de Diderot, Sedaine et Mercier.
Les principales pièces de Voltaire
2.3. Le Voltaire philosophe
2.3.1. Le refus de la métaphysique
Si le philosophe est celui dont toutes les pensées, logiquement liées, prétendent élucider les premiers principes de toutes choses, Voltaire n'est pas un philosophe. Ce qu'il appelle philosophie est précisément le refus de la philosophie entendue comme métaphysique. Qu'est-ce que Dieu, pourquoi et quand le monde a-t-il été créé, qu'est-ce que l'infini du temps et de l'espace, qu'est-ce que la matière et qu'est-ce que l'esprit, l'homme a-t-il une âme et est-elle immortelle, qu'est-ce que l'homme lui-même ? Toutes ces questions posées par la métaphysique, l'homme ne peut ni les résoudre ni les concevoir clairement. Dès qu'il raisonne sur autre chose que sur des faits, il déraisonne. La science physique, fondée sur l'observation et l'expérience, est le modèle de toutes les connaissances qu'il peut atteindre. Encore n'est-il pas sûr qu'elle soit utile à son bonheur.
L'utilité est en effet le critère de ce qu'il faut connaître, et le scepticisme, pour Voltaire comme pour la plupart des penseurs rationalistes de son temps, le commencement et la condition de la philosophie. Mais le doute n'est pas total. Il épargne quelques fortes certitudes :
– que l'existence du monde implique celle d'un créateur, car il n'y a pas d'effet sans cause, et que ce créateur d'un monde en ordre est souverainement intelligent ;
– que la nature a ses lois, dont l'homme participe par sa constitution physique, et que des lois morales de justice et de solidarité, dépendant de cette constitution, sont universellement reconnues, même quand elles imposent des comportements contradictoires selon les pays ;
– que la vie sur cette terre, malgré d'épouvantables malheurs, mérite d'être vécue ;
– qu'il faut mettre l'homme en état de la vivre de mieux en mieux et détruire les erreurs et les préjugés qui l'en séparent.
2.3.2. Le refus de l'esprit de système
Parce que son argumentation devait changer selon ses adversaires, Voltaire n'hésita pas à se contredire en apparence, unissant en réalité dans des associations toujours plus riches les arguments qu'il employait successivement. Ainsi, le tremblement de terre de Lisbonne lui sert, en 1759, à réfuter Leibniz et Alexander Pope, mais la sécurité des voyages « sur la terre affermie » lui sert, en 1768, dans l'A.B.C., à rassurer ceux qui ne voient dans la création que le mal. La métaphysique de Malebranche est sacrifiée vers 1730 à la saine philosophie de Locke et de Newton, mais l'idée malebranchiste du « Tout en Dieu » est développée dans un opuscule de 1769 et mise au service d'un déterminisme universel déiste, opposé et parallèle au déterminisme athée.
Voltaire ignore la pensée dialectique. Il ne sait pas faire sortir la synthèse du heurt entre la thèse et l'antithèse. Il ne peut qu'appuyer, selon le cas, sur le pour ou sur le contre, non pour s'installer dans un juste milieu, mais pour les affirmer comme solidaires, chacun étant la condition et le garant de l'autre. Ce faisant, il ne se livre pas à un vain jeu de l'esprit. Il est persuadé qu'une vue unilatérale mutile le réel et que, dans l'ignorance où est l'homme des premiers principes et des fins dernières, le sentiment des contradictions assure sa liberté.
2.3.3. La philosophie comme morale
Toute la philosophie se ramène ainsi à la morale, non pas à la morale spéculative, mais à la morale engagée, qui peut se faire entendre sous n'importe quelle forme : tragédie, satire, conte, poème, dialogue, article de circonstance, aussi bien que sous l'aspect consacré du traité. Voltaire a pourtant été obsédé par les questions qu'il déclare inutiles et insolubles : elles sont au cœur de ses polémiques.
Son esprit critique se dresse contre un optimisme aveugle fondé sur un acte de foi ou sur des raisonnements à la Pangloss, ce personnage de Candide (1759). Dès le début, il n'est optimiste que par un acte de volonté. Son poème le Mondain, si on le lit bien, fait la satire d'un jouisseur que n'effleure aucune inquiétude. Ses malheurs personnels ont confirmé à Voltaire l'existence du mal. Dire qu'il a été bouleversé et désemparé par le tremblement de terre de Lisbonne, c'est gravement exagérer. Mais il s'en prend aux avocats de la Providence avec irritation et tristesse, parce qu'il refuse de crier « tout est bien » et de justifier le malheur.
Voltaire condamne tout aussi énergiquement ceux qui calomnient l'homme, les misanthropes comme Pascal, et, croyant en un Dieu de bonté, il déteste l'ascétisme et la mortification. Il lui faut se battre sur deux fronts, puis sur trois quand entre en lice l'athéisme matérialiste.
Une aptitude sans égale, au moment où il affirme une idée, à saisir et à préserver l'idée contraire, une adresse géniale à l'ironie, qui est le moyen d'expression de cette aptitude, telles sont les qualités de Voltaire philosophe. Sa pensée est inscrite dans l'histoire de l'humanité. Il a passionné plusieurs générations pour la justice, la liberté, la raison, l'esprit critique, la tolérance. On peut redemander encore à son œuvre toute la saveur de ces idéaux, si l'on a peur qu'ils ne s'affadissent.
Les principaux ouvrages philosophiques de Voltaire
2.4. Le Voltaire conteur
L'ironie voltairienne est intacte dans les romans et les contes « philosophiques », parce qu'ils n'ont pas été écrits pour le progrès de la réflexion ou de la discussion, mais pour le plaisir, en marge des autres œuvres. Voltaire y a mis sa pensée telle qu'il la vivait au plus intime de son être. Elle s'y exprime dans le jaillissement, apparemment libre, de la fantaisie. Ce qui est ailleurs argument polémique est ici humeur et bouffonne invention.
La technique du récit, le sujet des Contes, leur intention ont changé selon les circonstances de la rédaction : Micromégas est plus optimiste, Candide plus grinçant, l'Ingénu plus dramatique, l'Histoire de Jenni plus émue. Ils sont l'écho des préoccupations intellectuelles de Voltaire et de sa vie à divers moments (Zadig [1748] écrit en référence au « roi-philosophe » Frédéric II).
Mais dans tous, Voltaire s'est mis lui-même, totalement, assumant ses contradictions (car il est à la fois Candide et Pangloss) et les dépassant (car il n'est ni Pangloss ni Candide), répondant aux questions du monde qui l'écrase par une interrogation socratique sur ses expériences les plus profondes. Car l'ironie y est elle-même objet d'ironie. Elle enveloppe le naïf, dont les étonnements font ressortir l'absurdité des hommes et la ridiculisent. Elle vise non plus seulement les préjugés et la sottise, mais l'homme en général, être misérable et fragile, borné dans ses connaissances et dans son existence, sujet aux passions et à l'erreur, qui ne peut pas considérer sa condition sans éclater de rire. Ce rire n'anéantit pas ses espérances ni la grandeur de ses réussites, mais signale leur relativité (voyez Micromégas). La finitude et la mort frappent d'ironie toute existence humaine : en épousant l'ironie du destin, en ironisant avec les dieux, l'homme échappe au ridicule, s'accorde à lui-même et à sa condition, et se donne le droit d'être grand selon sa propre norme.
L'ironie de Voltaire est libération de l'esprit et du cœur. Ce que sa pensée peut avoir de rhétorique, de tendancieux, de court quand elle s'exprime dans des tragédies, des discours en vers ou même dans des dialogues, est brûlé au feu de l'ironie. Voltaire n'est dupe d'aucune imposture, d'aucune gravité. Il s'évade par le rire et rétablit le sérieux et le sentimental sans s'y engluer. Il ne court pas le risque de tourner à vide, de tomber dans le nihilisme intellectuel et moral du « hideux sourire » (selon les vers d'Alfred de Musset : « Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire/Voltige-t-il encor sur tes os décharnés ? », Rolla, 1833). Nullement dérobade d'un esprit égoïste qui ricanerait de tout et ne voudrait jamais s'engager, l'ironie voltairienne est appel au courage et à la liberté. Elle est généreuse.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
JUSTICE |
|
|
| |
|
| |
justice
(latin justitia)
Cet article fait partie du dossier consacré à la justice.
DROIT
La balance et le glaive constituent les symboles traditionnels de la justice ; ils symbolisent les deux termes entre lesquels s'exerce la justice des hommes : d'un côté, l'arbitrage des litiges, qui repose sur l’idée d’équilibre et de mesure ; de l’autre, l’action de trancher et de sanctionner, qui renvoie à la puissance de l’État qui permet de faire appliquer la justice. Dans les deux cas, le juge est l'instrument indispensable de la paix sociale et de l’ordre public.
Les missions de la justice
Trancher et sanctionner
L’une des missions essentielles de la justice consiste à trancher les litiges conformément au droit. Son domaine d’exercice coïncide alors avec le « contentieux ».
La justice civile
Les conflits de la société civile occupent le centre du domaine de la justice. Il s'agit de litiges qui opposent des particuliers : individus, ou personnes morales telles que des sociétés ou des associations. Ces litiges forment le contentieux privé : civil, commercial ou social. Relèvent, par exemple, de ce contentieux les procès en divorce, les litiges qui naissent entre bailleurs et locataires, employeurs et salariés…
Si la fonction de justice n'était pas convenablement assurée dans la société civile, celle-ci serait paralysée par des conflits privés. À l'échelle des individus, la justice civile doit donc être considérée comme un bien de première nécessité : un service absolument indispensable, au même titre que la sécurité personnelle, la fourniture de logement, de nourriture ou des soins médicaux. À l'échelle de la société, l'exercice de cette justice civile est une fonction résolument vitale.
La justice administrative
Les différends qui s'élèvent entre les gouvernants et les gouvernés tombent aussi dans le champ de la justice. On parle à leur propos de contentieux « administratif ». Le contentieux administratif comprend les actions dirigées par les particuliers contre l’administration (État, établissements publics, collectivités locales, etc.). En France, il en existe deux grands types : les premiers visent à obtenir des réparations pour un dommage injustement causé (par exemple, l'indemnisation d'un patient mal soigné dans un hôpital public) – ils sont appelés recours de pleine juridiction – ; les seconds (appelés recours pour excès de pouvoir) consistent à demander l’annulation des règlements de l'administration qui ne seraient pas conformes aux règles de droit (par exemple, lorsque des riverains attaquent la décision de construire un pont entre une île et le continent). Cette forme de contrôle de l'autorité publique, accessible aux simples administrés qui cherchent à défendre leurs intérêts particuliers, est une condition requise dans le cadre d’un État de droit : c'est une garantie très importante de l'effectivité des principes fondant les libertés élémentaires.
La justice pénale
A priori les questions pénales ne relèvent pas à proprement parler du « contentieux » et donc de la justice puisqu’il s'agit de punir les actes ou les comportements interdits par la loi, et non pas de trancher des litiges. Cette répression pourrait être simplement confiée à l'administration, notamment à la police. Pourtant, depuis très longtemps, elle s'exerce dans le champ de la justice. En effet, la puissance publique s'est très tôt substituée aux victimes pour infliger les châtiments qu'exigent non seulement les victimes mais la société dans son ensemble. Comme la vengeance des victimes prend spontanément la forme d'un conflit qui les oppose aux responsables et à leurs proches, la confiscation de cette vengeance par l'État conduit à une sorte de conflit entre l'autorité publique, qui se substitue aux victimes, et les délinquants. Ce conflit doit être tranché comme le sont les litiges véritables, c’est-à-dire sous la forme de procès.
Définir le droit
Outre la fonction de trancher les litiges, la justice est chargée de formuler des règles de droit. Conformément au principe de séparation des pouvoirs, le juge n’est pas censé faire le droit : il applique des règles que d’autres ont créées. Pour remplir convenablement sa fonction, chaque juge puise largement dans un fonds de règles préexistantes et lui emprunte les normes générales dont il a besoin pour justifier ses décisions. Il trouve d'abord ces règles dans les textes des traités, de la Constitution, des lois et des règlements qu'il est tenu d'appliquer ; il les trouve ensuite dans la jurisprudence (l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux), les usages, la coutume (la France étant un pays de droit écrit, la coutume n’est pas une source de droit très importante). Mais le rôle du juge ne se borne pas à cet emprunt de règles préexistantes. En réalité, il participe à la création de ces règles lorsqu'elles lui sont nécessaires ; il peut procéder de deux manières.
D'abord, lorsqu'il est en présence de textes, notamment de lois écrites, le juge exerce un très large pouvoir d'interprétation au moment d'appliquer les règles que ces textes comportent. Ce pouvoir lui permet d'en préciser, d'en compléter et même d'en modifier le sens.
Ensuite, lorsqu'il n'existe pas de texte – ni loi, ni règlement – concernant une question, le juge saisi de cette question n'en doit pas moins remplir sa fonction : il lui faut, malgré le silence des textes, rendre une décision conforme au droit. La seule façon de satisfaire à cette exigence est de produire les règles générales permettant de justifier le jugement.
La finalité de la justice
La justice vise à assurer la paix sociale et l’ordre public. Elle a aussi une finalité immédiate : celle de donner à chaque litige particulier – donc, au coup par coup – une solution conforme au droit et imposée de l'extérieur.
Cette solution – la chose jugée – fait l'objet de la décision que l'on désigne du terme générique de jugement. Le jugement a un caractère contraignant pour les parties au procès. En France, on traduit ce caractère en disant que chaque décision de justice est revêtue de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire.
En effet, tout jugement énonce à l'adresse des parties, sous forme de normes, le modèle du comportement à suivre pour terminer le procès. Il s'agit de « faire », « ne pas faire » ou « donner » quelque chose ; de considérer un acte donné comme juridiquement valable ou, au contraire, comme nul (dépouillé de légitimité juridique), etc. Souvent, le juge ordonne ou interdit, parfois, il autorise ; la norme qu'il énonce doit toujours être respectée par les parties au procès. C'est en cela que consiste l'autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, ce qu'un jugement ordonne de faire ou de donner doit être effectivement fait ou donné – si cela est nécessaire sous la contrainte et avec le concours de la force publique. C'est en cela que consiste la force exécutoire.
Le caractère contraignant du jugement implique nécessairement que son auteur ait autorité sur les parties. Ainsi, la justice ne peut être rendue que par des représentants de l’État.
L’organisation de la justice en France
La justice est un service public de l'État dont la responsabilité incombe exclusivement à des organes spécialisés que l'on appelle « juridictions ». L'organisation de la justice peut apparaître fort complexe. L’ensemble des juridictions françaises forme cependant un système ordonné autour de deux principes : la spécialisation des compétences attribuées aux diverses juridictions ; la hiérarchisation des tribunaux appelés à intervenir dans un même champ de compétence.
Les principes fondamentaux
L’indépendance du pouvoir judiciaire
La justice est une institution fondamentale : avec le Parlement (qui légifère) et le gouvernement (chargé d'exécuter les lois), le pouvoir judiciaire représente l'un des trois pouvoirs qu'identifie la théorie politique traditionnelle. En France, l’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par l'article 64 de la Constitution de 1958.
Conformément au principe de séparation, les juridictions ont le monopole de la fonction de justice : les autres organes de l'État n'ont pas à s'en mêler. Ni le Parlement ni le gouvernement ne doivent rendre la justice. Ils ne doivent pas non plus revenir sur ce qu'ont jugé les tribunaux.
Pour que ce monopole existe réellement au profit des juridictions, il faut que leur personnel soit indépendant vis-à-vis des agents du pouvoir exécutif.
Les principes de la procédure judiciaire
Les juristes nomment par le terme « procédure » la manière de faire correctement progresser l'examen d'un litige, depuis l'acte qui saisit le tribunal jusqu'au jugement qui termine l'affaire. La procédure obéit à des règles strictes dont l'importance pratique est considérable puisque la qualité et l’efficacité de la justice en dépendent.
Au premier rang des principes régissant la procédure judiciaire figure la gratuité de la justice : la justice est un service public gratuit et même les frais à la charge du justiciable peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle pour les personnes sans ressources. Tout le monde a le droit de faire appel à la justice pour faire valoir ses droits.
Destiné à garantir les droits de la défense, le principe du contradictoire est un élément essentiel de la procédure : en vertu de ce principe, chaque partie au procès doit connaître tous les moyens employés par son adversaire, et elle doit avoir aussi la possibilité de combattre ces moyens. Le juge lui-même est soumis au principe du contradictoire : il ne peut soulever lui-même certains arguments sans les communiquer aux parties. Finalement, tous les éléments contestés d'un litige doivent avoir fait l'objet d'un débat contradictoire.
La spécialisation des compétences
On entend par compétence d'un tribunal son pouvoir de juger des litiges d'une catégorie donnée. Chaque État répartit ce pouvoir entre ses propres tribunaux. Cette répartition s'effectue en France selon deux principes, pris en compte simultanément : d'une part, la nature des litiges – les juristes français parlent alors de compétence d'attribution, ou ratione materiae (« en raison de la matière ») –, qui dépend des questions posées au juge ; d'autre part, la situation géographique des litiges – on parle de compétence territoriale, ou ratione loci (c'est-à-dire attribuée « en raison du lieu »).
En matière de compétence d’attribution, l’organisation de la justice repose en France sur une répartition fondamentale des juridictions entre deux ordres : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L’ordre administratif est chargé de régler les litiges entre les citoyens et l’administration. L’ordre judiciaire est lui-même subdivisé en deux grandes branches : les juridictions civiles, qui tranchent les litiges entre les personnes, et les juridictions pénales, qui jugent les actes et les comportements interdits par la loi.
Cette « dualité de juridiction » fonctionne grâce à une juridiction spécifique, le Tribunal des conflits, créée en 1872 et chargée de régler les conflits de compétence qui surgissent fréquemment entre les deux ordres.
À l'intérieur de chaque ordre, la mise en œuvre du principe de spécialisation conduit à distinguer des juridictions dites de droit commun et d'autres qui sont dites d'exception. Enfin, toutes ces juridictions sont hiérarchisées de telle façon que les justiciables puissent former des recours contre les jugements rendus en première instance.
La hiérarchisation des juridictions
Dans chaque ordre, les juridictions sont hiérarchisées. Au niveau inférieur se trouvent les tribunaux de première instance : dans l'ordre judiciaire, les tribunaux de grande instance et les divers tribunaux d'exception ; dans l'ordre administratif, les tribunaux administratifs et les diverses juridictions administratives d'exception. À l'étage intermédiaire se trouvent les cours d'appel. Enfin, une juridiction unique occupe le sommet de la pyramide : la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire ; le Conseil d'État dans l'ordre administratif.
Deux sortes de préoccupations fondent la hiérarchie des juridictions. D'abord, le souci de garantir aux citoyens un service de bonne qualité : c'est dans leur intérêt que les règles de procédure prévoient un double degré de juridiction, qui donne aux plaideurs insatisfaits de la première décision rendue un droit d'appel. En conséquence, un procès peut être jugé deux fois. Le juge d'appel a le pouvoir de rejuger entièrement ce procès (il juge en droit et en fait). Il peut soit confirmer, soit infirmer, soit réformer (c’est-à-dire modifier), en tout ou en partie, le jugement rendu par les premiers juges.
La hiérarchie des juridictions vise également à favoriser l'unité et la cohérence du système juridique par l'institution d'un recours en cassation devant la juridiction qui occupe le sommet de la hiérarchie dans chaque ordre juridique. Mais, afin d'éviter l'institution d'un troisième degré de juridiction, les règles de la procédure donnent au juge de cassation un rôle très différent de celui du juge d'appel. Le rôle du juge de cassation est de vérifier si la décision rendue en appel a correctement formulé et appliqué le droit. Mais il ne juge pas sur les faits. C'est pourquoi, lorsque le juge de cassation estime que l'arrêt d'appel n'est pas correctement fondé en droit, il « casse » – en d'autres termes, il annule – cet arrêt mais ne le réforme pas et renvoie le dossier devant un autre juge d'appel.
Dans l'ordre judiciaire, le rôle de juge de cassation est réservé – comme son nom l'indique – à la Cour de cassation. Dans l'ordre administratif, ce rôle est tenu par le Conseil d'État.
L'ordre judiciaire
Juridictions civiles et juridictions pénales
L’ordre judiciaire est subdivisé en deux branches : les juridictions civiles, qui tranchent les litiges entre les personnes, et les juridictions pénales, qui jugent les infractions (c’est-à-dire les actes et les comportements interdits par la loi, comme les crimes ou les délits) et infligent des peines.
Le contentieux civil est principalement porté devant les tribunaux d'instance, et de grande instance, qui statuent en premier ressort ; puis, en cas d'appel, il est porté devant des cours d'appel.
Au pénal, les mêmes juridictions prennent le nom de tribunaux de police, qui jugent les infractions légères (appelées contraventions], et de tribunaux correctionnels, qui jugent en premier ressort les infractions de gravité moyenne (les délits) – en cas d'appel, la cour d’appel est compétente. Les infractions les plus graves (les crimes) relèvent des cours d'assises, dont la composition est particulière puisqu’elle comprend un jury populaire (neuf jurés tirés au sort à partir des listes électorales) aux côtés de trois magistrats professionnels ; l'appel d'un arrêt de cour d'assises est porté devant une autre cour d'assises, qui comprend alors douze jurés.
Chacune de ces juridictions a une compétence limitée territorialement. Par exemple, une cour d'assises siège périodiquement au chef-lieu de chaque département.
Mais une instance unique dont la compétence couvre tout le territoire coiffe l'organisation judiciaire : c’est la Cour de cassation, qui siège à Paris. Elle exerce son contrôle sur les autres juridictions grâce à la procédure du pourvoi. La Cour de cassation juge en droit et non en fait, c'est-à-dire qu'elle juge les arrêts ou jugements, et les casse, s'il y a lieu, pour non-conformité à la loi.
Au côté de ces juridictions répressives que l’on qualifie de droit commun parce qu’elles ont vocation à se prononcer sur toutes les incriminations quelle que soit la personnalité du prévenu, il existe des juridictions répressives spécialisées. Elles ne sont compétentes que dans les cas prévus par la loi. Les juridictions militaires en sont un exemple, ainsi que les juridictions pénales pour les mineurs (juge des enfants, tribunal pour enfants et cour d’assises des mineurs).
Le ministère public
Le ministère public – on dit aussi le parquet – représente l'État mais fait partie intégrante des juridictions judiciaires. Il exerce l'action publique contre les délinquants devant les juridictions pénales et présente des conclusions dans l'intérêt public devant les tribunaux civils. Il est, dans une certaine mesure, soumis à l'autorité du ministre de la Justice (ou garde des Sceaux), aussi ses membres ne participent-ils pas au jugement des affaires. Le ministère public est constitué, devant chaque tribunal de grande instance, d'un procureur de la République assisté de substituts et, devant chaque cour d'appel, d'un procureur général assisté d'avocats généraux et de substituts généraux. Le parquet de la Cour de cassation est composé d'un procureur général et d'avocats généraux.
Magistrats, avocats et auxiliaires de justice
Les parties sont assistées et, le cas échéant, représentées en justice par des avocats. Ce sont des personnes privées exerçant une profession réglementée : les avocats sont regroupés dans des barreaux, établissements publics qui veillent au respect des règles professionnelles.
Les magistrats dans leur ensemble appartiennent tous au même corps : ce sont des magistrats recrutés par concours et, en principe, issus de l'École nationale de la magistrature (installée à Bordeaux). La Constitution garantit l'indépendance de ceux qui exercent la fonction de jugement : les juges et les conseillers, appelés magistrats assis par opposition aux magistrats debout, qui sont ceux des parquets. Les magistrats assis relèvent disciplinairement du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont inamovibles : on ne peut les déplacer sans leur consentement.
Les juges d’instruction appartiennent aussi à la magistrature assise ; dans la procédure pénale, ils sont chargés de mener l’enquête permettant d’établir l’éventuelle culpabilité d’un suspect accusé d’avoir commis une infraction.
Outre les juges et les avocats, la justice utilise les services d'auxiliaires de toute sorte qui sont participent à son administration et sont indispensables à son fonctionnement : greffiers, huissiers, experts. En particulier, les fonctionnaires de la police judiciaire ont pour tâche d'identifier et d'arrêter les personnes suspectes d'avoir commis des infractions.
L'ordre administratif
Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour trancher les litiges qui opposent l’administration aux particuliers.
Elles se sont constituées par une lente évolution, à partir d'organes qui n'avaient à l'origine rien de juridictionnel. En effet, jusqu'à la loi du 24 mai 1872, l'administration était censée régler elle-même les différends qui l'opposaient aux particuliers : elle ne relevait donc d'aucun juge. Les juges dont elle dépend aujourd'hui – ceux des tribunaux administratifs – tirent leur origine des anciens conseils de préfecture qui, comme leur nom l'indique, conseillaient les préfets, en particulier sur les suites à donner aux requêtes adressées par les administrés. Les tribunaux administratifs sont coiffés par le Conseil d'État, qui est non seulement une juridiction, mais aussi une instance de réflexion qui étudie les projets de lois et de règlements. Enfin, depuis 1989, des cours administratives d'appel sont venues s'insérer entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'État.
Les juridictions administratives sont composées de conseillers, qui exercent les fonctions de juges, et d'un ministère public qui a pour rôle de présenter des conclusions. Mais, à la différence des magistrats des parquets des juridictions judiciaires, les commissaires du gouvernement des juridictions administratives ne reçoivent pas d'instructions et prennent leurs conclusions en toute liberté. Les membres du Conseil d'État sont, de plus en plus souvent, issus de l'École nationale d'administration (E.N.A.).
Les parties au procès administratif sont assistées par les mêmes avocats qui plaident devant les juridictions judiciaires.
Juges de droit commun et juges d'exception
Dans chaque ordre de juridiction, la spécialisation comporte des limites. En effet, si elle était complète, tout juge serait enfermé dans sa compétence particulière, sa spécialité. Or il est presque impossible de définir un ensemble de spécialités distinctes qui couvrent tout le champ des contentieux possibles. Avec une spécialisation très complète des tribunaux, certains litiges risqueraient de ne pas pouvoir être jugés, faute de tribunal spécialement compétent. C'est pourquoi, dans chaque ordre, est prévue une catégorie de juridictions dont la compétence est définie de façon résiduelle, pour tout procès que des règles particulières n'attribueraient pas à une autre sorte de tribunaux. Sa compétence est dite de principe ou de droit commun. Celle des autres tribunaux, enfermés dans leur spécialité, déroge au principe et constitue donc l'exception.
Dans l'ordre administratif, le tribunal administratif est le juge de droit commun. Il existe à côté de lui nombre de juridictions d'exception : par exemple, en matière financière, les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes ; la Commission de recours des réfugiés, qui est compétente en matière de droit d'asile ; les sections disciplinaires des universités, dont relèvent, en vertu d'un véritable privilège, les membres du corps enseignant ainsi que les étudiants.
Dans l’ordre judiciaire, le tribunal de grande instance est le juge de droit commun. Les autres tribunaux de premier degré (ceux devant qui tout procès commence) sont tous d'exception. Outre les tribunaux d'instance, les deux principales sortes de juridictions judiciaires d'exception sont, d'une part, les conseils de prud'hommes, spécialisés dans le contentieux des relations individuelles du travail ; d'autre part, les tribunaux de commerce (ou tribunaux consulaires), qui traitent les litiges entre commerçants. Ils ont la particularité de n'être pas composés de magistrats professionnels, mais de particuliers élus par leurs pairs : des employeurs et des salariés siégeant en nombre égal dans les conseils de prud'hommes ; des commerçants, dans les tribunaux de commerce. Mais, en cas d'appel, il faut saisir la cour d'appel, ce qui ramène les procès devant les magistrats professionnels.
Justice d’État et justice privée
À côté de la justice d’État, il existe des juridictions privées, dont le rôle pratique est très important. Ces tribunaux arbitraux sont appelés à trancher certains procès civils ou, plus souvent, commerciaux. Leurs juges, qu'on appelle des arbitres, sont des personnes privées. Les arbitres sont choisis sur la base d'un contrat, conclu entre les parties à un litige donné. Leur autorité se fonde sur ce contrat et se limite donc aux questions qu'il désigne. Toutefois, dans le cadre de leur mission, les arbitres sont de véritables juges et doivent appliquer les règles de droit. En France et dans la plupart des pays comparables, l'arbitrage est officiellement reconnu et réglementé. L'institution de l'arbitrage est ainsi placée dans un rapport de subordination vis-à-vis de la justice d'État. Il en résulte d'abord que seuls certains types de litiges privés peuvent être soustraits par contrat à la compétence du juge ordinaire et public, pour faire l'objet d'un arbitrage. Par exemple, les divorces ne peuvent pas être arbitrés. Ensuite, les juridictions de l'État assurent le contrôle de l'activité des arbitres, et peuvent obtenir la modification ou l'annulation de leurs sentences.
La justice internationale
La justice internationale concerne les litiges opposant des États, les litiges opposant un particulier à un État et les litiges opposant des particuliers relevant d'États différents.
Dans ce dernier cas, les relations extrêmement denses que les personnes privées nouent à travers les frontières engendrent un contentieux civil et commercial abondant. La justice interne (c’est-à-dire nationale) est compétente pour le juger, conformément aux règles que chaque État pose en toute souveraineté. Les juridictions internationales n'interviennent pas en ces matières, mais c'est dans ce domaine que l'arbitrage privé s'est développé le plus largement depuis la Seconde Guerre mondiale, sous le contrôle des justices d'État.
Concernant la justice entre États, rien n'oblige en principe deux États qu'oppose un différend à porter leur affaire devant un juge. La Charte des Nations unies exige un règlement « pacifique » (art. 2 al. 1), mais nullement un règlement « juridictionnel ». Dans ces conditions, pour qu'un litige entre États soit jugé, il faut que les parties à ce litige acceptent ce type de solution. Les juridictions créées à cet effet fondent leur pouvoir sur un accord conclu entre les États qui acceptent ainsi de se faire juger : les tribunaux internationaux sont alors similaires aux arbitres privés existant dans les organisations judiciaires nationales.
Enfin, les particuliers n'ont en principe pas accès aux juridictions internationales. Il existe cependant deux exceptions, en matière de protection des droits de l’homme et dans le cas des crimes les plus graves (tribunaux pénaux internationaux : T.P.I.R. et T.I.P.Y.).
La Cour internationale de justice
La plupart des juridictions internationales ont été, au cours de l'histoire, non pas des institutions permanentes, mais des tribunaux arbitraux caractérisés par leur précarité. Toutefois, au lendemain de la Première Guerre mondiale, une juridiction permanente, dont la vocation était générale, a été créée par application du pacte de la Société des Nations (S.D.N.) : la Cour permanente de justice internationale. Cette institution a survécu au naufrage de la S.D.N. et forme, de nos jours, l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations unies sous le nom de Cour internationale de justice (C.I.J.). Pourtant, sa compétence conserve la précarité de celle d'un tribunal arbitral : elle demeure facultative.
La Cour internationale de justice, qui siège à La Haye, tranche les différends entre États (par exemple, un conflit de frontières ou de délimitation du plateau continental). La Cour européenne des droits de l’homme
Une protection très forte est donnée aux droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe. D'ordinaire, en effet, l'individu qui s’estime victime d'atteintes à ses droits fondamentaux du fait des autorités de son propre pays, ne peut saisir d'autre justice que celle de ce pays. Mais la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) permet aux citoyens des États signataires d'agir contre leur propre pays en cas de violation des dispositions de ladite Convention : elle leur ouvre un accès indirect à la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg.
Des tribunaux pénaux internationaux à la Cour pénale internationale
L'idée de traduire devant une juridiction internationale les criminels de guerre s'est développée au xxe s. À l'issue du premier conflit mondial, nombre de généraux et d'hommes politiques français avaient tenté, en vain, d'obtenir l'extradition et le jugement de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, réfugié aux Pays-Bas. Mais ce n'est que lorsque furent découvertes les atrocités commises par les nazis que le premier tribunal militaire international vit le jour à Nuremberg. Les projets de cour pénale internationale restèrent en suspens pendant plus de quarante ans, puis deux juridictions furent constituées dans les années 1990 pour juger les crimes commis sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, T.P.I.Y.) et au Rwanda (Tribunal pénal pour le Rwanda, T.P.R.). Cependant, tous ces tribunaux étaient des tribunaux ad hoc, c'est à dire dotés de compétences réduites dans le temps et dans l'espace. Il fallut attendre 1998 pour que soit enfin adopté le statut d'une Cour pénale internationale, permanente, et chargée de « juger les crimes les plus graves ayant une portée internationale ».
La création du T.P.I.Y. et du T.P.R. avait relancé l'idée de Cour pénale internationale (C.P.I.), dont les prémices remontaient à 1937. Le statut d'une telle cour, conçue comme une juridiction permanente et indépendante, a fait l'objet du traité de Rome adopté le 17 juillet 1998 par les représentants de 120 États ; sept pays ont voté contre, dont les États-Unis, la Chine, l'Inde et Israël. La C.P.I., qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002, a compétence pour les crimes dits les plus graves et pour les violations aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant qui ne seraient pas sanctionnées par les juridictions pénales nationales.
Les crimes considérés comme les plus graves au regard de la communauté internationale sont les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression et les crimes de guerre. Son statut permet à la C.P.I. d'ériger en crime de guerre l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans l'armée et leur engagement dans les combats.
Le droit européen
Le droit européen occupe une place à part dans le champ de la justice internationale, en ce qu’il s’applique non seulement dans les rapports internes des Communautés formant l’Union et de leurs institutions, mais également dans l’ordre juridique des États membres.
Les contentieux liés au droit de l'Union européenne sont jugés par une institution unique, la Cour de Justice des communautés européennes (C.J.C.E.), qui siège à Luxembourg. Ses décisions n'ont pas seulement autorité sur les États, mais aussi directement sur les personnes privées ; elles doivent en outre être exécutées sur tout le territoire de la Communauté.
La Cour a des attributions de nature très diverse. Tout comme une juridiction internationale, elle peut trancher sur la base d'un compromis les différends que les États membres décideraient de lui soumettre, pourvu que ces différends se rapportent à l'objet des traités européens. Les institutions communautaires et les États membres peuvent ou doivent, suivant le cas, prendre son avis. Mais la Cour a, surtout, des attributions contentieuses, et c'est à ce titre qu'elle incarne un véritable pouvoir juridictionnel. Au contentieux, le règlement des litiges relevant du droit communautaire n'est pas réservé à la Cour. Au contraire, il fait l'objet d'un partage avec les juridictions nationales, aménagé de telle sorte que ces institutions coopèrent étroitement. En conséquence, les tribunaux des États membres et la Cour sont intégrés dans un seul et même système, qui a tous les caractères d'une organisation juridictionnelle interne.
La Cour peut être directement saisie – soit par des institutions communautaires, notamment la Commission, soit par des États membres, soit par des personnes privées – des litiges que lui confient les traités. Elle est compétente ainsi, notamment, en matière de recours en annulation d'actes des institutions européennes pour méconnaissance du droit communautaire, de recours « en carence » dirigés contre ces mêmes institutions lorsqu'elles négligent d'exercer leur pouvoir, d'actions en responsabilité extracontractuelle des communautés, de recours contre les États qui n'ont pas respecté leurs obligations.
Enfin, elle peut être saisie par une juridiction nationale, notamment d'une demande d'interprétation d'une disposition de droit communautaire. Lorsque les juges nationaux hésitent sur le sens d'une règle communautaire, ils doivent interroger la Cour avant de rendre leur décision.
MILITAIRE
La justice militaire est la justice applicable aux militaires ainsi qu'aux personnes assimilées à ces derniers, conformément aux dispositions du Code de justice militaire.
C'est en 1347 que le premier texte soustrayant les hommes d'armes aux juridictions ordinaires apparaît, et c'est au milieu du xive s. qu'est créé le tribunal de la connétablie, première en date des juridictions pénales particulières aux armées. La Révolution de 1789 supprime les juridictions de l'Ancien Régime : juridiction des prévôts des maréchaux, présidiaux, tribunal des maréchaux de France et conseils de guerre de Louis XIV. Mais, dès 1790, sont créés des cours martiales, des tribunaux criminels militaires et des conseils militaires. Plusieurs systèmes sont ensuite mis à l'épreuve (1857, 1928, 1938), bien qu'ils aient progressivement réorganisé la justice militaire dans le sens du droit commun, ils ne paraissent plus adaptés, après la Seconde Guerre mondiale, aux réalités et perspectives de l'époque moderne. Ainsi un code unique de justice militaire, commun aux trois armées, est promulgué par la loi du 8 juillet 1965. L’application du droit commun caractérise les réformes les plus récentes, même si une spécificité demeure. Les lois des 21 juillet 1982 et 10 novembre 1999 distinguent nettement le temps de paix et le temps de guerre, et s’alignent pour l'essentiel sur le Code de procédure pénale. Pour mettre le Code de justice militaire en cohérence avec le Code de procédure pénale issu de la réforme de 1993, le gouvernement a été autorisé en 2004 à le refondre par ordonnance (ordonnance du 1er juin 2006, ratifiée par la loi du 5 mars 2007). Le code est désormais conforme aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En temps de paix
Les infractions commises, sur le territoire de la République, par des militaires en service relèvent de juridictions spécialisées, instituées dans chaque cour d'appel. Ces juridictions jugent les infractions de droit commun et les infractions militaires prévues par le Code de justice militaire (désertion, abus d'autorité, infractions contre l'honneur et le devoir, etc.). Les juges civils appliquent le Code de procédure pénale. Seul l'avis préalable aux poursuites donné par le ministre de la Défense constitue une particularité. Les voies de recours sont celles du droit commun.
Les infractions commises, hors du territoire de la République, par des militaires en service ou hors service relèvent du Tribunal aux armées de Paris. La compétence de cette juridiction est liée aux accords internationaux passés par la France avec les pays concernés. En sont principalement justiciables les militaires engagés en opérations extérieures (OPEX). Les magistrats sont des juges civils de la cour d'appel de Paris. Les enquêtes sont conduites par des prévôts, gendarmes officiers de police judiciaire.
En temps de guerre
La justice militaire, en temps de guerre, relève d’une organisation particulière : des tribunaux territoriaux des forces armées peuvent être institués sur le territoire national ainsi que des tribunaux militaires aux armées hors des frontières. Le Haut Tribunal des forces armées juge les officiers généraux et assimilés. Le temps de guerre correspond à des situations juridiquement très précises : déclaration de guerre (article 35 de la Constitution), mise en œuvre des mesures de mobilisation ou de mise en garde – mesures propres à assurer la liberté d’action du gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces militaires. Si des dérogations sont justifiées par les circonstances (présence d'assesseurs militaires aux côtés du président civil, engagement des poursuites par un commissaire du gouvernement), les réformes récentes tendent à gommer les différences avec les juridictions de droit commun, en permettant par exemple de faire appel des décisions de première instance.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
RUSSIE: VIE POLITIQUE DEPUIS 1991 |
|
|
| |
|
| |

DOCUMENT larousse.fr LIEN
Russie : vie politique depuis 1991
1. L'ère Ieltsine (1991-1999)
1.1. De la RSFSR à la Fédération de Russie
Le 25 décembre 1991, la RSFSR change d'appellation et devient la Fédération de Russie. Pour la première fois de son histoire en tant qu'État moderne, la Russie perd sa dimension « impériale », mais elle est néanmoins confrontée à une forte hétérogénéité culturelle sur son territoire. Recouvrant 21 républiques, la Fédération de Russie compte plus de 30 millions de citoyens non russes. En revanche, avec l'effondrement de l'URSS, elle compte 25 millions de nationaux russes disséminés dans les anciennes républiques soviétiques (en particulier en Asie centrale), devenues États indépendants.
Outre toutes les difficultés liées à la redéfinition de son identité géographique, culturelle, institutionnelle, la Russie s'est engagée dans un long et difficile processus de sortie du communisme en tant que système politique et économique. La restauration de l'autorité de l'État, dans le contexte des immenses mutations systématiques engagées, représente toujours l'un des grands défis de cette fin de décennie post-soviétique.
1.2. Le recours à la manière forte
La longévité de Boris Ieltsine à la tête du pays (près de dix ans) témoigne, pour une part, de la difficile et lente recomposition de la scène politique dans le contexte russe, marqué par la permanence des anciennes élites, issues de la nomenklatura et des principales branches de l'économie soviétique. L'absence d'alternative crédible et le soutien indéfectible des Occidentaux au président ont largement pesé dans sa réélection, en juin 1996. B. Ieltsine a pu asseoir son autorité face à un Parlement rebelle, dominé par l'opposition communiste et agraire, grâce à un incontestable sens politique mais aussi à des tentatives autoritaires (comme la prise sanglante, en octobre 1993, du Parlement, alors occupé par les députés qui refusaient la dissolution de la Chambre).
La nouvelle Constitution, à l'origine du conflit entre le législatif et l'exécutif, qui est approuvée en décembre 1993 par référendum, accroît les pouvoirs présidentiels en redéfinissant la répartition des compétences entre le président, le gouvernement et le Parlement, ainsi que les relations entre les régions et le centre. La Fédération de Russie est composée de 89 « sujets » (régions, républiques autonomes, etc.) égaux en droits. Le bicaméralisme est institué : la Douma d'État (Chambre basse) comprend 450 députés possédant le pouvoir législatif et budgétaire ; le Conseil de la Fédération, où sont représentés les « sujets », est composé de 178 parlementaires.
1.3. L'intervention en Tchétchénie
Tchétchénie, accord de paix, 1997
Si, désormais, le pouvoir semble se partager entre un Parlement jouant la carte de l'opposition constructive et un gouvernement contraint à faire de multiples concessions, le problème complexe de la Tchétchénie soulève à nouveau la question de l'unité du pays. L'intervention armée, décidée en décembre 1994 dans la république rebelle marque l'exacerbation de plusieurs années de tension, depuis la déclaration officielle de l'indépendance de la république en novembre 1991. Contestée par l'opinion, elle n'apporte guère de victoire décisive et aboutit à un accord de paix en 1996.
1.4. Un second mandat brouillon et la préservation du clan Ieltsine
En dépit de la sanction infligée à la politique gouvernementale, lors des élections législatives de 1995, qui consacrent la victoire du parti communiste, B. Ieltsine est réélu un an plus tard devant son concurrent, le communiste Guennadi Ziouganov. Régulièrement en retrait ou absent pour raisons de santé, le président russe se voit contraint d'abandonner progressivement les larges pouvoirs que lui confère la Constitution : ses successeurs potentiels rivalisent au grand jour, alors que les potentats locaux deviennent de plus en plus autonomes par rapport au pouvoir central. B. Ieltsine procède, de manière récurrente, par des tentatives d'épreuve de force et des coups de théâtre, renvoyant et rappelant, au gré des circonstances, plusieurs membres du gouvernement. L'accélération des changements à la tête du gouvernement russe porte à cinq le nombre de Premiers ministres qui se sont succédé en un an et demi.
Groznyï bombardée, avril 2000
En août 1999, Sergueï Stepachine, auquel B. Ieltsine reproche de ne pas avoir pu empêcher la formation du puissant rassemblement politique, La Patrie-Toute la Russie dirigé par Ievgueni Primakov, doit céder la place à Vladimir Poutine. La nomination de cet inconnu de la scène politique a été dictée par un président soucieux avant tout de préserver les intérêts de son clan, alors qu'une série de scandales (notamment celui du détournement de l'argent du FMI au profit de sa famille) étaient en train d'obscurcir son second mandat.
Début août, la présence de quelques milliers de rebelles islamistes au Daguestan (venus pour la plupart de la petite République voisine, la Tchétchénie) a ravivé le souvenir de la défaite militaire russe de 1994-1996. Prenant prétexte du non-respect des accords passés en 1996, les autorités russes lancent une seconde offensive en Tchétchénie. Grâce à une habile propagande jouant sur les humiliations accumulées depuis plusieurs années par les Russes et leur armée, les autorités parviennent dans un premier temps à rallier à leur cause la majeure partie de la population.
C'est donc dans un contexte de nationalisme exacerbé que se déroule la campagne des législatives. Devancée de peu par le parti communiste (KPRF), la liste Unité – créée en septembre et dont le seul programme est un soutien sans réserve au Premier ministre – fait un excellent score en obtenant près d'un quart des suffrages. La grande perdante de ce scrutin est la coalition La Patrie-Toute la Russie de l'ancien Premier ministre I. Primakov et du maire de Moscou Iouri Loujkov. V. Poutine est assuré d'une large majorité (formée par Unité, l'Union des forces de droite [SPS], la plupart des indépendants et les ultranationalistes de Vladimir Jirinovski) à la Douma. Satisfait par la victoire de son dauphin et s'étant préalablement assuré le bénéfice d'une immunité judiciaire à vie, B. Ieltsine démissionne le 31 décembre de la présidence russe. V. Poutine assure l'intérim jusqu'à l'élection anticipée de mars 2000.
2. La présidence de V. Poutine : l'affirmation d'un État fort
2.1. Le renforcement du pouvoir central
Vladimir Poutine
Quelques semaines avant le scrutin, I. Primakov et I. Loujkov se retirent de la course à la présidence, tandis que l'ultranationaliste V. Jirinovski se voit refuser sa candidature. Au terme d'un scrutin entaché d'irrégularités, V. Poutine remporte l'élection présidentielle dès le premier tour, avec 52,9 % des voix. Le communiste G. Ziouganov arrive en deuxième position (29,2 %) ; quant au libéral Grigori Iavlinski (parti Iabloko), il obtient un score très faible (5,8 %).
Encore inconnu un an plus tôt, mais ayant acquis en quelques mois – sur fond de guerre tchétchène – une stature de présidentiable, le nouvel homme fort de la Russie suscite de nombreuses interrogations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Élu sans véritable programme électoral et longtemps resté flou sur ses intentions, cet ancien chef des services secrets place finalement le renforcement du pouvoir central au premier rang de ses objectifs. Le profond remaniement de l'appareil administratif ieltsinien et la redéfinition des relations avec les élites administratives locales constituent les deux volets de ce renforcement. La plupart des responsables de l'époque ieltsinienne sont écartés au profit de personnalités issues, comme V. Poutine, des organes de sécurité (FSB) et de cadres de la région de Saint-Pétersbourg, dont provient également le président.
La nouvelle équipe voit son audience confortée dans l'opinion par la mise en œuvre de grandes réformes dans le fonctionnement de l'État et de la vie politique. La première d'entre elles concerne les relations entre le centre et les régions, avec pour objectif majeur de faire respecter l'autorité centrale à l'échelon des différents sujets de la Fédération, dont les dirigeants sont régulièrement accusés de constituer de véritables potentats locaux. À cette fin, le nouveau gouvernement met en place, entre mai et septembre 2000, sept districts fédéraux, recouvrant l'ensemble des sujets et dirigés par des personnalités directement mandatées par le président. Toutefois, les « super-préfets » ne disposent ni des moyens financiers, ni de l'appareil administratif qui leur permettraient de s'affirmer face aux gouverneurs des régions, lesquels restent élus au suffrage universel. Ces derniers comprennent que le maintien de leur emprise sur les affaires de leurs territoires exige désormais qu'ils affirment leur loyauté politique envers V. Poutine.
Pour le président russe, la réforme de l'État ne peut être dissociée d'une volonté de contrôle de l'espace public, du jeu politique mais aussi des circuits économiques. La poursuite de la guerre en Tchétchénie et la lutte médiatique contre le terrorisme constituent la toile de fond de cette tendance générale à l'accroissement du poids de l'État dans la société.
2.2. La mise sous tutelle des médias
Adoptée en septembre 2000 par le Conseil national de sécurité, la Doctrine sur la sécurité de l'information dénonce les « menaces » pesant sur les « intérêts nationaux » et stigmatise les entreprises de « désinformation et de manipulation de l'opinion » ; elle prône, en revanche, la nécessité de « renforcer les moyens d'information de l'État pour offrir une information fiable aux citoyens ». À partir du printemps 2001, l'État entame le démantèlement des empires médiatiques détenus par Vladimir Goussinski et Boris Berezovski. Les chaînes télévisées nationales semi-indépendantes ou indépendantes sont soit reprises en main (ORT en septembre 2000 et NTV au printemps 2001), soit liquidées (TV 6 en janvier 2002). Plusieurs journaux de diffusion nationale – Sevodnia, Itogui – subissent le même sort.
En l'espace de deux ans, le Kremlin parvient à retrouver son monopole des ondes, perdu après la chute de l'URSS. Le prix à payer de cette reconquête est lourd : instrumentalisation de la justice, poursuites contre certains journalistes, montages financiers opaques pour le transfert des actions vers des structures se trouvant dans l'orbite du pouvoir (le géant gazier Gazprom contrôlé par l'État est ainsi devenu le principal actionnaire de NTV).
La censure imposée à la liberté de l'information s'explique, en premier lieu, par l'intolérance à l'égard d'une critique indépendante concernant les dossiers sensibles. Le verrouillage de l'information sur le conflit tchétchène (allant jusqu'au meurtre, le 7 octobre 2006, de la journaliste indépendante Anna Politkovskaïa) ou la couverture médiatique de situations de crise (les prises d'otages au théâtre Doubrovka à Moscou en octobre 2002 et dans une école de Beslan, en Ossétie du Nord, en septembre 2004) constituent des enjeux majeurs pour le contrôle de l'opinion publique. Par ailleurs, cette mise sous tutelle des médias s'inscrit dans un contexte de réorganisation des grands groupes industriels et financiers.
2.3. La mise au pas des oligarques
En s'attaquant à certains magnats de l'économie russe, V. Poutine entreprend de clore l'époque Ieltsine, marquée par l'emprise sur le Kremlin des oligarques – ces hommes d'affaires qui, ayant bâti leurs immenses fortunes à partir de la privatisation des grands secteurs de l'industrie, contrôlent à la fin des années 1990 près de 70 % des richesses nationales et exercent un pouvoir d'influence majeur sur la vie politique du pays, que ce soit au niveau central, où certains oligarques ont joué un rôle de premier plan dans la réélection du président Ieltsine en 1996, ou au niveau régional, où l'on assiste à l'établissement d'alliances de holdings avec les équipes régionales dirigeantes. V. Goussinski, le patron du groupe de presse Media-Most, et B. Berezovski, l'artisan de l'accession de V. Poutine à la présidence, entrent les premiers dans la ligne de mire du nouveau président et sont contraints de s'exiler à l'étranger en juin et en novembre 2000.
Outre ces deux attaques spectaculaires, V. Poutine opte pour une mise au pas « négociée » du monde des affaires, à savoir la garantie de l'impunité aux patrons détenant des actifs obtenus dans des conditions douteuses contre leur renonciation à intervenir dans le champ politique. Cependant, l'« affaire Ioukos » montre les limites de la tolérance à l'égard de la puissance économique privée, en particulier lorsqu'elle concerne un secteur clef comme celui des hydrocarbures. Le 25 octobre 2003, Mikhaïl Khodorkovski, le président de la deuxième compagnie pétrolière russe, Ioukos, est arrêté et inculpé d'escroquerie et de fraude fiscale à grande échelle. À l'issue d'un procès placé sous le signe de la violation permanente des règles de droit, l'inculpé est condamné, en mai 2005, à neuf ans de prison, commués à huit ans en appel en septembre. Quant au groupe pétrolier, il est soumis à des redressements fiscaux atteignant la somme de 27 milliards de dollars et perd sa principale filiale, Iouganskneftegaz, qui passe, en décembre 2004, sous le contrôle de l'entreprise publique Rosfnet, dont l'un des dirigeants est l'un des responsables de l'administration présidentielle. En août 2006, le tribunal d'arbitrage de Moscou décide la mise en faillite de Ioukos, dont les ex-dirigeants – M. Khodorkovski et l'ex-président Vassili Aleksanian – sont, depuis, devenus passibles d'un deuxième procès pour détournement de fonds et blanchiment d'argent.
L'expropriation de Ioukos par le Kremlin répond à des considérations d'ordre à la fois stratégique et politique. Les choix stratégiques de M. Khodorkovski – que ce soit la tentative d'ouverture par Ioukos à des capitaux américains (ChevronTexaco et ExxonMobil) ou la promotion d'oléoducs à capitaux privés concurrents de ceux détenus par l'État – contrevenaient directement à l'objectif des autorités russes d'encadrer plus étroitement le secteur pétrolier. En outre, M. Khodorkovski était sur le point de devenir une figure d'opposition capable de peser sur le processus législatif (il avait réussi à bloquer à la Douma la réforme sur la taxation des sociétés pétrolières) et, d'une façon plus générale, de modifier la configuration politique du pays. En finançant plusieurs partis d'opposition, aussi bien communistes que libéraux, M. Khodorkovski apparaissait, à la veille des élections législatives de décembre 2003, comme un obstacle à l'aspiration du président Poutine de contrôler de la vie politique en Russie.
2.4. La mise en place d'une « verticale du pouvoir »
Cette volonté de contrôle, manifeste dès l'année 2000, se traduit par diverses actions visant, tout d'abord, à conforter les bases politiques du président. La nouvelle loi sur le statut et le fonctionnement des partis politiques, votée par la Douma en juin 2001, instaure des conditions restrictives pour la reconnaissance officielle d'un parti politique. Parmi ces conditions, l'exigence de faire état d'au moins 10 000 membres enregistrés dans au moins la moitié des 89 sujets de la Fédération a une incidence immédiate sur le paysage politique russe. Elle permet, outre l'élimination de partis jugés indésirables, la formation d'un nouveau parti, Russie unie, regroupant plusieurs formations centristes et, désormais considéré comme le parti du président.
En dépit d'une forte abstention (plus de 43 % des inscrits), les élections législatives du 7 décembre 2003 à la Douma confortent l'assise politique de V. Poutine – Russie unie étant sortie, en effet, grand vainqueur du scrutin (37,5 % des suffrages). Cette victoire, facilitée par la mobilisation massive de l'appareil d'État en faveur du parti présidentiel, est acquise au détriment du parti communiste (12,6 % des voix), du parti ultra-nationaliste de Vladimir Jirinovski (11,4 %) et, surtout, des deux partis libéraux Iabloko et SPS (Union des forces de droite), qui ne parviennent pas à franchir le seuil des 5 % pour siéger au Parlement. Elle donne également le ton à une campagne présidentielle étroitement contrôlée par les autorités. Alors que les dirigeants des partis réformateurs Iabloko et SPS renoncent à se présenter à une élection qu'ils jugent jouée d'avance, le Kremlin entreprend de susciter des candidatures pour donner un semblant de pluralisme au vote. Ainsi, V. Poutine fait quasiment cavalier seul lorsqu'il est réélu, le 14 mars 2004, avec 71,3 % des voix et un taux de participation de 64,3 %.
Bénéficiant auprès de l'opinion publique d'une image de dirigeant incarnant la stabilité et promettant de rétablir un État fort sur fond de croissance économique, V. Poutine affirme vouloir poursuivre sa politique de « remise en ordre ». Le traumatisme causé par la meurtrière prise d'otages de l'école de Beslan, en Ossétie du Nord, en septembre 2004 (plus de 300 morts, provoqués, pour l'essentiel, au moment de la prise d'assaut de l'école par les forces spéciales russes), et la mobilisation contre le terrorisme qu'il a suscitée, fournit au président russe l'occasion d'accélérer sa politique de mise en place d'une « verticale du pouvoir » au détriment des pouvoirs régionaux et des institutions parlementaire et judiciaire.
En septembre 2004, V. Poutine annonce une modification du mode de désignation des gouverneurs locaux : jusque-là élus au suffrage universel direct, ils seront désormais élus par les assemblées locales sur proposition du président de la Fédération avec l'aval des assemblées locales. Par ailleurs, les membres du Haut Collège de qualification des juges, qui nomme les juges des cours suprêmes, seront désormais tous choisis par le chef de l'État ou par le président du Conseil de la Fédération.
En décembre 2004, la loi sur les partis politiques adoptée en 2001 est amendée : prévoyant notamment que le nombre minimal de membres d'un parti doit être de 50 000 membres (contre 10 000 auparavant), cette loi entraîne une réduction sensible du nombre de partis qui ne sont plus qu'une quinzaine en 2007. En mai 2005 est adoptée une nouvelle loi sur les élections législatives qui remet en cause l'élection au scrutin uninominal de la moitié des députés de la chambre basse de la Douma. Les députés seront tous élus au scrutin proportionnel et devront appartenir à des partis ayant obtenu plus de 7 % des suffrages exprimés.
L'administration présidentielle, un cabinet élargi étroitement lié aux services de renseignement et aux milieux d'affaires, double le gouvernement. De fait, différents cercles continuent à jouer un rôle important dans le jeu politique. Les libéraux, essentiellement des juristes et des experts appartenant à la filière pétersbourgeoise, restent les artisans de la modernisation économique et sociale du pays. En revanche, les ieltsiniens, comme le montre le limogeage du Premier ministre M. Kassianov à la veille de l'élection présidentielle de 2004, semblent désormais hors jeu alors que les représentants des structures de force (Sécurité, Défense, Intérieur) ont gagné en influence à tous les échelons de l'administration.
À l'approche des législatives de 2007 et de la présidentielle de 2008, le Kremlin montre sa volonté de contrecarrer toute possibilité d'une issue à la géorgienne ou à l'ukrainienne. La loi sur les ONG, promulguée par V. Poutine le 17 janvier 2006, vise à instaurer un contrôle strict de l'administration : une ONG pourra être interdite si elle représente une menace pour « la souveraineté de la Russie, l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité et l'originalité nationales, l'héritage culturel ou les intérêts nationaux ». L'évaluation de cette menace étant laissée à l'administration.
Un autre dispositif, celui de la loi contre l'extrémisme, permet de restreindre davantage les libertés individuelles et politiques. Ainsi, dans un discours prononcé devant les deux chambres, le 26 avril 2007, V. Poutine appelle les parlementaires à sévir dans leur lutte contre « l'extrémisme politique ». Dès juillet 2007, la Douma adopte une série d'amendements qui, d'une part, punit plus lourdement les délits et les crimes commis pour « extrémisme » et, d'autre part, élargit la définition de l'extrémisme à la diffamation des responsables politiques.
À l'approche des élections législatives de décembre 2007, alors que le président jouit d'une réelle popularité et que la croissance économique s'est installée durablement, le parti pro-présidentiel, Russie unie, bénéficie des meilleures conditions pour remporter les élections. Les rares forces d'opposition encore actives font l'objet d'un harcèlement permanent. Les manifestations organisées par Une autre Russie, mouvement fondé par l'ex-champion du monde d'échecs Garry Kasparov, sont régulièrement dispersées par la force. À quelques jours du scrutin, Kasparov lui-même est arrêté lors d'une manifestation et incarcéré pendant cinq jours. D'une façon générale, les mesures d'intimidation se multiplient à l'encontre de ceux qui se permettent de critiquer le pouvoir en place : passages à tabac d'opposants et de journalistes jugés trop indépendants, retour aux méthodes soviétiques d'internement psychiatrique d'opposants politiques.
Dans ce contexte, les élections législatives du 2 décembre représentent une simple formalité pour le parti pro-présidentiel. Russie unie obtient 64,3 % des voix. Seuls le parti communiste, le parti ultra-nationaliste de V. Jirinovski et Russie juste (un nouveau parti proche du Kremlin) dépassent le seuil des 7 %. Les partis de l'opposition réformatrice et libérale sont les grands absents de ce nouveau Parlement. Les observateurs de l'OSCE dénoncent de nombreuses irrégularités.
Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine
Son mandat expirant en mars 2008, V. Poutine s'attelle à résoudre la question de sa succession. Après avoir laissé planer le doute sur des candidats potentiels, Russie unie et trois autres petits partis proches du Kremlin annoncent, une semaine après les législatives, leur soutien à la candidature de Dmitri Medvedev. Originaire de Saint-Pétersbourg, cet ancien juriste de 42 ans doit son ascension politique à V. Poutine, tout d'abord à la mairie de Saint-Pétersbourg – où il a été le conseiller du maire de 1990 à 1995 –, puis, à partir de 1999, au sein de l'administration présidentielle, dont il a pris la direction en 2003. Il cumule cette fonction avec la présidence du conseil de direction du géant gazier Gazprom. Le soutien de V. Poutine à D. Medvedev se poursuit tout au long de son second mandat, comme en témoigne sa nomination, en novembre 2005, au poste de vice-Premier ministre auprès du Premier ministre M. Fradkov. Il est à ce poste chargé des grands projets nationaux russes de développement social et économique (logement, santé, éducation), ce qui lui confère une certaine visibilité auprès de l'opinion publique. La candidature de D. Medvedev, présenté comme le chef du clan « libéral », est plutôt bien accueillie par les milieux d'affaires, inquiets de l'ascendant pris au Kremlin par le clan des « siloviki » (armée, police, forces de sécurité).
Tout en soutenant la candidature de D. Medvedev, V. Poutine ne souhaite pas s'éloigner des commandes de l'État et déclare dès la fin 2007 que sa nomination au poste de Premier ministre est tout à fait « réaliste ». La campagne présidentielle constitue un non-événement, marquée essentiellement par la poursuite de l'éviction de tout opposant potentiel. L'intensité de la pression exercée sur G. Kasparov et sur son entourage contraint le chef de file d'Une autre Russie à renoncer à se présenter. En outre, l'ex-Premier ministre, M. Kassianov, passé dans l'opposition après son limogeage en 2004, voit sa candidature invalidée par la commission électorale centrale.
2.5. La présidence de Dmitri Medvedev : une coprésidence ?
D. Medvedev s'impose le 2 mars 2008 avec 70,2 % des voix dans une élection jugée « non libre » par les rares observateurs occidentaux présents. Son arrivée au pouvoir n’entraîne toutefois pas un retrait de la vie politique de V. Poutine : celui-ci prend, en avril, la tête du parti majoritaire de la Douma, Russie unie, et il est nommé, en mai, Premier ministre par D. Medvedev. De 2008 à 2012, les deux hommes forment un tandem à la tête de l’État russe. Cette situation inédite suscite de nombreux débats en Russie comme à l’étranger, les observateurs s’interrogeant sur la réelle répartition des pouvoirs entre le président et le chef du gouvernement.
Pour certains qui pointent les divergences entre les deux hommes, l'arrivée de D. Medvedev annonce une certaine évolution de la politique russe. Le nouveau président est volontiers perçu comme un libéral, réformateur, plus ouvert que son prédécesseur. En témoignent son projet de modernisation économique, sociale et politique de la Russie lancé en septembre 2009 ou encore son attitude en mars 2011 de l'intervention militaire occidentale en Libye. V. Poutine a vivement dénoncé la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU en la comparant à « l’appel aux croisades de l’époque du Moyen Âge », le président a, pour sa part, jugé « inadmissible » et « inacceptable » l'accusation de « croisade » lancée contre les partenaires occidentaux.
D’autres observateurs minimisent les divergences entre les deux hommes et estiment que la politique de D. Medvedev s’inscrit dans la continuité de celle menée par son prédécesseur. En témoignent, à leurs yeux, l’attitude intransigeante du président russe lors du conflit russo-géorgien de l’été 2008, la loi sur le renforcement des pouvoirs du FSB (Service fédéral de sécurité, ex-KGB) qu’il a fait voter en juillet 2010, ou encore le limogeage du maire de Moscou en septembre 2010 et son remplacement par un proche de V. Poutine.
V. Poutine et D. Medvedev ont longtemps laissé planer le doute sur leurs intentions respectives à propos de l’élection présidentielle de mars 2012, ni l’un ni l’autre n’excluant la possibilité de présenter sa candidature. Ce n’est que fin septembre 2011, lors du congrès préélectoral du parti Russie unie, que le président Medvedev propose la candidature de V. Poutine à la présidence russe, indiquant qu’il accepterait de prendre la tête du gouvernement en cas de victoire de V. Poutine à l’élection présidentielle.
2.6. Le retour contesté de Vladimir Poutine à la tête de l’État
En novembre 2011, une semaine avant la tenue des élections législatives, devant les partisans du parti Russie unie réunis en congrès à Moscou, V. Poutine « accepte » officiellement d’être candidat à l’élection présidentielle du 4 mars 2012.
L'annonce de sa candidature intervient alors que V. Poutine fait face à une baisse de popularité sans précédent depuis son arrivée au pouvoir en 2000. Une situation qui est confirmée par la publication des résultats officiels des élections parlementaires du 4 décembre 2011 : alors que quatre ans plus tôt le parti pro-présidentiel Russie unie avait obtenu 64,3 % des suffrages, il n’en remporte cette fois-ci que 49,5 %. Le recul paraît d’autant plus net que le scrutin est entaché par de multiples irrégularités, l’OSCE dénonçant « l’ingérence de l’État » à toutes les étapes du processus électoral, « la partialité de la plupart des médias » ou encore, lors du décompte des voix, de « fréquentes violations de la procédure » et « de sérieuses indications de bourrage des urnes ». Critiqué par la majeure partie des responsables politiques européens et américains, le déroulement des élections fait également l’objet de vives réactions au sein de la société russe. Dans les semaines qui suivent l’issue du scrutin, d’importants mouvements de contestation voient le jour dans les grandes villes du pays. Les manifestants protestent contre l’injustice, la corruption, les fraudes électorales, le « vol de l’élection » par Russie unie, qualifié de « Parti des voleurs et des escrocs », et militent en faveur d’une « Russie sans Poutine ».
Malgré l’accumulation de preuves flagrantes de falsifications (souvent diffusées par vidéos mises en ligne sur Internet), les autorités russes nient toute fraude à grande échelle et excluent l’organisation d’un nouveau scrutin. Alors que les interpellations d’opposants se multiplient, V. Poutine minimise l’ampleur des manifestations qu’il estime fomentées par l’Occident.
C’est dans ce contexte de tensions, que certains observateurs qualifient de « printemps russe » (en référence au « printemps arabe », mouvements de contestations populaires qui frappent plusieurs pays du monde arabe depuis 2010), qu’a lieu l'élection présidentielle le 4 mars 2012. V. Poutine est élu (pour six ans depuis l’extension du mandat votée en 2008) dès le premier tour avec 63,6 % des suffrages face à Guennadi Ziouganov (parti communiste, 17,1 %), Vladimir Jirinovski (Parti démocrate-libéral, 7,9 %), Sergueï Mironov (Russie juste, 6,2 %), Mikhaïl Prokhorov (Juste cause, 3,8 %). Dénoncés par l’opposition et par les observateurs électoraux, le déroulement et le résultat du scrutin donnent lieu à de nouvelles manifestations. Mais en l’absence d’une opposition unie, le mouvement de contestation faiblit.
Tout en revenant sur la législation précédente très restrictive sur les partis politiques et les élections en la libéralisant, le pouvoir durcit l’arsenal juridique contre les opposants et les ONG (juin et juillet 2012) provoquant de nouvelles protestations. Les élections municipales et régionales de septembre 2013 donnent pourtant l’occasion aux oppositions de se remobiliser et d’enregistrer quelques progrès, notamment avec le score obtenu par l’activiste controversé Alekseï Navalny au scrutin de Moscou où le maire sortant Sergueï Sobianine, nommé en 2010, l’emporte cependant avec 51,3 % des voix dès le premier tour. La forte médiatisation de cette élection exceptionnellement ouverte et contestée – dont l’enjeu prend une dimension nationale – ainsi que la vitalité du mouvement citoyen autonome qui le sous-tend, ne peuvent toutefois éclipser la très faible participation aussi bien dans la capitale (33 %) que dans les autres régions. Dans la plupart des circonscriptions concernées, les candidats sortants et/ou proches du pouvoir s’imposent par ailleurs en dépit de plusieurs surprises, comme la victoire du sulfureux Evgueni Roïzman, à Ekaterinboug face au candidat de Russie unie. Il n’en reste pas moins que ces consultations semblent aussi montrer la « résilience » de la société civile russe et des forces démocratiques.
À la veille des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi de février 2014, V. Poutine tente, semble-t-il, de redorer son image très détériorée dans les pays occidentaux, une impopularité qu’une loi contre la « propagande homosexuelle en direction des mineurs » n’a fait qu’accentuer en 2013. Après le vote d’une amnistie par la Douma, un certain nombre de prisonniers sont ainsi libérés en décembre 2013, au premier rang desquels l’ex-oligarque M. Khodorkovski, les militants de Greenpeace appréhendés lors d’une opération contre l’exploitation pétrolière dans l’océan Arctique, ainsi que les chanteuses du groupe rock Pussy Riot condamnées pour avoir déclamé une « prière punk » anti-Poutine dans la cathédrale de Moscou. Toutefois, l’assassinat (février 2015) de Boris Nemtsov, ex-ministre de B. Ieltsine devenu l’un des principaux représentants de l’opposition, révèle le climat politique délétère régnant dans le pays, favorisé par une propagande nationaliste contre les « ennemis » de la Russie, particulièrement prégnante depuis l’intervention de cette dernière en Ukraine.
Ces gestes de « clémence » ne sauraient ainsi dissimuler les atteintes récurrentes à la liberté d’expression malgré l’effort du pouvoir de redorer son image à travers divers médias en ligne progouvernementaux. La Russie occupe ainsi la 148e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse établi en 2016 par Reporters sans frontières, tandis que les ONG sont de plus en plus inquiétées depuis l’adoption de la loi de 2012. Outre l’organisation Memorial, le centre Levada, réputé pour ses études sociologiques et ses sondages d’opinion, est à son tour étiqueté « agent de l’étranger » en septembre 2016, à la veille des élections à la Douma. Remporté sans surprise et massivement par Russie unie qui obtient 343 sièges sur 450, ce scrutin ne mobilise toutefois que 48 % des électeurs.
2.7. Le quatrième mandat de V. Poutine
En mars 2018, fort d’une popularité retrouvée depuis 2014 (avec 80 % d’opinions favorables), en l’absence d’une opposition digne de ce nom et à l’issue d’une campagne électorale peu compétitive et largement verrouillée, V. Poutine est réélu sans surprise. Il s’impose avec 76 % des suffrages devant sept autres candidats dont le communiste Pavel Groudinine (environ 12 %), le nationaliste V. Jirinovski (5,6 %) et la candidate libérale (et controversée) Ksenia Sobtchak (moins de 2 % des voix). Si l’on en croit le taux de participation (67 %), l’appel au boycott lancé par A. Navalny, écarté du scrutin à la suite d’une condamnation judiciaire controversée, ne semble pas avoir été entendu même si ces élections n’ont pas été exemptes de pressions et d’irrégularités pour assurer au chef de l’État le maximum de légitimité.
3. La politique extérieure de la Fédération de Russie
3.1. Les limites de la Communauté des États indépendants
La C.E.I. (Communauté d'États indépendants)
Avec l'effondrement de l'URSS, la Fédération de Russie se trouve confrontée à la double difficulté de redéfinir sa position à l'échelle régionale et internationale. Dans l'espace post-soviétique, elle cherche à jouer un rôle fédérateur et à préserver son influence en participant de façon décisive à la création et au développement de la Communauté des États indépendants (CEI), qui regroupe la plupart des anciennes républiques soviétiques (à l'exception des États baltes et de la Géorgie jusqu'en 1993). La CEI est conçue comme une instance de négociations et de concertations dans les grands domaines intéressant l'ensemble des États, tel celui de la Défense. Dès sa fondation, son autorité apparaît cependant limitée par la rareté des accords d'ensemble au profit d'accords « à la carte », qui favorisent le développement des relations bilatérales. La préservation d'un espace militaire stratégique commun – objectif affiché de la fondation de la CEI – ne résiste pas à la volonté des nouveaux États d'affirmer leur indépendance nationale et à la diversité de leurs priorités stratégiques, la perception des menaces variant considérablement d'un pays à l'autre. La redistribution de l'arsenal militaire ne va pas sans contentieux, parfois tardivement résolus, comme ce fut le cas avec l'Ukraine à propos de la flotte de la mer Noire. Bien qu'elle affirme respecter l'intégrité des nouveaux États, la Russie est à plusieurs reprises mise en cause dans des conflits régionaux (entre la Géorgie et l'Abkhazie notamment) et accusée d'instrumentaliser les tensions à son profit. Signée en 1996 avec la Biélorussie et assimilée à une future fusion des deux États, la « communauté des États souverains » sanctionne la proximité des deux pays sans conduire toutefois à l'unification, Moscou ne voulant pas assumer les coûts d'une véritable intégration économique et se contentant d'une situation de protectorat qui lui profite du point de vue stratégique.
Afin de redonner du souffle à une CEI en crise, des réformes sont entreprises en 2000 : elles conduisent à l’entrée en vigueur en mai 2001 du traité instituant la Communauté économique eurasiatique (CEEA ou Eurasec) réunissant autour de la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, avec l’Ukraine, la Moldavie et l’Arménie comme États observateurs. En septembre 2003, les États signataires du premier accord de sécurité collective (signé à Tachkent en mai 1992) donnent naissance à la nouvelle Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). Après l’auto suspension de la participation de l’Ouzbékistan en 2012, cette alliance politico-militaire réunit sous l’égide de la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan.
3.2. Vers la fin de l'isolement
Dans le domaine des relations avec l'Occident, la Russie poursuit, dans un premier temps, la politique extérieure inaugurée par Mikhaïl Gorbatchev. Elle confirme son rapprochement avec les États-Unis et sa volonté d'en devenir le partenaire à part entière, malgré un rapport de forces défavorable (les dépenses militaires russes, qui n'ont pas cessé de décroître, étaient, en 1999, douze fois moins importantes que celles des États-Unis).
Face aux attentes déçues, notamment dans l'aide à l'intégration du pays sur la scène internationale, et à la perspective, très mal reçue, de l'élargissement de l'OTAN vers des pays d'Europe centrale, la Russie réoriente sa position à partir de 1994, prône l'instauration d'un monde multipolaire et évoque la nécessité de constituer un axe Moscou-Pékin-Delhi. Elle engrange, durant la seconde moitié des années 1990, quelques résultats positifs : grâce à sa participation, le G7 devient le G8 ; elle est admise aux clubs de Paris et de Londres ; elle ratifie le traité de partenariat et de coopération avec l'Union européenne. Mais ses relations avec l'OTAN restent profondément marquées par l'élargissement à l'est de l'organisation et l'intervention de l'Alliance en Yougoslavie en 1999.
3.3. Le retour de la « Grande Russie »
À partir du printemps 2001, et surtout après les attentats du 11 septembre, la Russie procède à une réorientation de sa politique extérieure et ambitionne de devenir un partenaire de poids dans les relations internationales, en particulier auprès des États-Unis et de l'Europe.
Dans la lutte contre les nouvelles menaces à la sécurité internationale (terrorisme, prolifération des armes, criminalité organisée et flux migratoires illégaux), la Russie cherche à mettre en valeur ses atouts : sa situation géographique – au carrefour des zones particulièrement sensibles quant à ces menaces –, ses capacités de renseignement, mais aussi l'intérêt de ses contacts (dus à l'héritage soviétique) avec des pays alors soupçonnés de soutenir le terrorisme (Afghanistan, Iran).
La Russie utilise ses ressources énergétiques comme un outil d'influence économique, en proposant un partenariat avec les États-Unis et l'Europe en quête d'une diversification de leurs sources d'approvisionnement. En contrepartie, elle entend en tirer, outre des avantages économiques, une totale liberté dans sa politique de maintien de son intégrité territoriale et le respect de son influence exclusive dans l'espace post-soviétique.
Moscou retrouve une plus grande visibilité sur la scène internationale, avec l'établissement du conseil OTAN-Russie (COR) en mai 2002, avec sa participation active au jeu diplomatique durant la crise irakienne – au cours de laquelle elle rejoint les vues de Berlin et de Paris sans s'exposer aux foudres des États-Unis –, mais aussi avec la poursuite des négociations pour son entrée à l'OMC et, enfin, avec son adhésion au protocole de Kyoto et sa présidence du G8 en 2006.
Au Proche-Orient, elle cherche à s'affirmer comme médiateur, que ce soit dans le dossier nucléaire iranien, le dossier syro-libanais ou encore dans le conflit israélo-palestinien (la Russie est membre du Quartet pour le Proche-Orient avec les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies). V. Poutine s'est surtout assuré le ménagement de l'Occident dans sa politique de « pacification » de la Tchétchénie et d'importantes garanties de la part de l'Union européenne pour l'enclave de Kaliningrad
Ces acquis ne doivent pas masquer les reculs de l'influence russe dans le monde. Malgré son siège au Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie se montre incapable de peser, de façon décisive, sur les grands dossiers internationaux, tels que la crise irakienne. Dans sa sphère d'influence traditionnelle – son « étranger proche » – elle témoigne d'une grande difficulté à s'imposer en puissance dominante.
Les velléités de prise de distance de certains membres de la CEI vis-à-vis de Moscou coïncident avec un engagement accru des États-Unis en Asie centrale (Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ainsi qu'en Géorgie et en Ukraine. Profondément affectée par l'émancipation de ces deux républiques en 2003 et 2004, la Russie cherche à jouer sur les difficultés rencontrées par les gouvernements issus des « révolutions de couleur » et sur la perte d'attractivité que représente pour ces pays l'Union européenne, au moment de l'enlisement de la Constitution européenne. À cette fin, elle use régulièrement de l'arme énergétique : l'Ukraine voit son prix du gaz multiplié par deux en janvier 2006 ; un an plus tard, la Biélorussie subit la fermeture de son oléoduc Droujba.
La Russie reprend aussi l’initiative en matière de coopération économique avec l’entrée en vigueur, en 2012, de l’Espace économique unique regroupant la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Cette zone reste ouverte à d’autres États, notamment l’Arménie (qui décide de la rejoindre en décembre 2013), l’Ukraine et le Kirghizistan. Parallèlement, tandis que la Russie est admise à l’OMC (août 2012), les discussions en vue de l’élargissement et l’approfondissement de zone de libre-échange entre États membres de la CEI conduisent à un nouvel accord en octobre 2011. En janvier 2014, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Moldavie, la Russie, l’Ukraine et le Kirghizistan, l’avaient ratifié, la procédure étant en cours en Ouzbékistan (sous certaines conditions) et au Tadjikistan.
En mer Noire, – où elle craint de voir son influence déjà entamée par l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'OTAN, encore amoindrie par celle de deux autres États riverains, l'Ukraine et la Géorgie – la Russie cherche à maintenir ses bases en Abkhazie, en Ossétie du Sud ou encore en Transnistrie, entité séparatiste pro-russe de Moldavie. L’issue du conflit russo-géorgien de l’été 2008 lui permet de marquer des points dans ce domaine. Il en est de même suite à l’élection de Viktor Ianoukovytch à la tête de l’État ukrainien en février 2010 : l’accord de Kharkiv (21 avril) signé par le président Medvedev et son homologue ukrainien prévoit notamment le prolongement du stationnement de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol (Crimée, Ukraine) jusqu’en 2042. Cette position de force facilite l’annexion de ce territoire en majorité russe, en mars 2014, à la suite de la chute de V. Ianoukovytch.
3.4. La Russie face à l'unilatéralisme américain et la question du désarmement
Dans un discours prononcé lors d'une conférence sur la sécurité à Munich en février 2007, V. Poutine s'en prend aux « actions unilatérales et souvent illégitimes des États-Unis ». Ce réquisitoire s'inscrit dans un contexte de tension grandissante entre les deux pays, tension qui trouve son point d'orgue dans les projets américains d'extension des systèmes antimissiles dans les nouveaux pays membres de l'OTAN (Pologne et République tchèque). Malgré l'assurance donnée par les États-Unis que le bouclier antimissile a pour objet la protection contre les menaces d'États « voyous », comme l'Iran et la Corée du Nord, la Russie demeure convaincue que le déploiement américain à ses frontières est une atteinte à sa propre sécurité et un empiètement sur son « étranger proche » et qu'il contribue à relancer la course aux armements.
Après avoir menacé depuis des mois de s'en retirer, la Russie annonce, en juillet 2007, sa suspension de l'application du traité limitant l'usage et le développement des forces armées conventionnelles en Europe (FCE). Seuls la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ukraine et la Russie ont ratifié les modifications adoptées en 1999 à Istanbul. Soutenues par les pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord, la Géorgie et la Moldavie ont refusé de les ratifier, réclamant le retrait de leurs territoires des bases militaires russes. En novembre 2011, les États membres de l’OTAN, dont la France, annoncent qu’ils cessent à leur tour de mettre en œuvre le traité FCE à l’égard de la Russie, en réaction à la « suspension » russe de 2007.
Par ailleurs, Moscou se montre farouchement opposée à la proclamation de l'indépendance du Kosovo (février 2008) – reconnue par les États-Unis et par la plupart des pays membres de l'Union européenne – ainsi qu'au projet d'adhésion à l'OTAN de la Géorgie et de l'Ukraine (avril 2008). Dans la nouvelle doctrine militaire russe signée par le président Medvedev en février 2010, l’Alliance atlantique et son élargissement figurent au premier rang des menaces extérieures qui visent la Russie.
La fin du mandat de George W. Bush, l’élection de Barack Obama et l’annonce, faite en septembre 2009 par la nouvelle administration américaine, de l’abandon de la version initiale du projet de bouclier antimissile, entraînent toutefois un certain apaisement des tensions entre les deux pays. Le « redémarrage » des relations entre Washington et Moscou débouche notamment sur la signature, en avril 2010 à Prague, d’un nouveau traité de réduction et de limitation des armements stratégiques offensifs (nouveau traitéSTART, entré en vigueur en février 2011). Cette embellie n’exclut pas les mésententes comme en témoigne le non renouvellement en 2012 du programme CTR (Cooperative Threat Reduction, novembre 1991) sur le démantèlement des armes de destruction massive, remplacé par un nouveau protocole (juin 2013) davantage contrôlé par Moscou.
De plus, le lancement par l’OTAN à partir de son sommet de Lisbonne de 2010, d’un nouveau projet de défense antimissile basé en Europe et en Turquie donne lieu à de profonds désaccords d'une part entre la Russie et l’Alliance atlantique, et d'autre part entre Washington et Moscou, qui s’étaient engagés à coopérer dans ce domaine.
En 2017, une phase très incertaine s’ouvre après l’accession à la présidence des États-Unis de Donald Trump qui, après avoir appelé de ses vœux une normalisation des relations avec Moscou, est mis en porte-à-faux par les accusations d’ingérence russe en sa faveur dans la campagne électorale américaine. Son imprévisibilité et l’instabilité à la tête du gouvernement (notamment au sein du Département d’État) ajoutent à la faible visibilité de l’évolution future des relations russo-américaines, la « coopération pragmatique » prônée par V. Poutine restant assez vague et n’excluant pas les tensions diplomatiques.
3.5. Le Moyen-Orient et les « révolutions arabes »
À partir de 2003, à la faveur de la montée de l’anti-américanisme dans le monde arabo-musulman à la suite de l’intervention des États-Unis en Iraq, la Russie reprend pied au Moyen-Orient comme en témoignent notamment deux tournées internationales que V. Poutine y effectue en 2005 et 2007. Non sans contradictions d’ordre économique (intérêts gaziers et pétroliers concurrents) et politique, les relations sont en particulier resserrées à la fois avec l’Iran et avec l’Arabie saoudite, outre le Qatar et la Jordanie.
La coopération avec Téhéran dans le domaine nucléaire civil est confirmée avec la poursuite de la construction de la centrale de Bouchehr et Moscou reste hostile au régime des sanctions tout en soutenant les négociations en vue d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. De leur côté, les relations économiques voire militaires avec Riyad paraissent prometteuses à l’issue de la visite historique du président russe en 2007. Optant pour la discrétion et la conciliation concernant le conflit israélo-palestinien, Moscou améliore dans le même temps ses relations avec Israël.
L’un des principaux objectifs de la Russie, qui compte d’importantes minorités musulmanes mais n’est pas à l’abri de l’activisme salafiste ou djihadiste et qui est admise comme État observateur au sein de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) en 2005, est surtout de consolider ses liens avec le monde musulman en isolant ses composantes extrémistes et en se posant en puissance médiatrice.
La situation change après 2010 avec la survenue des « printemps arabes ». La Russie est en effet prise de court par ces révolutions qu’elle accueille avec une grande méfiance, alors que les mouvements islamistes qui tendent à les phagocyter et/ou certains groupes oppositionnels reçoivent le soutien du Qatar (Frères musulmans en Tunisie, en Égypte et en Syrie) et, concurremment, de l’Arabie saoudite dans le cas notamment de la rébellion syrienne. Les relations entre Moscou et ces deux États du Golfe se détériorent alors sérieusement.
Avec l’Iran chiite, la Russie soutient Damas (son dernier allié historique dans la région, la Syrie abritant la base navale russe de Tartous depuis 1971) contre l’insurrection et, surtout, le radicalisme sunnite qu’elle considère comme la principale menace dans la région tout comme dans ses marges caucasiennes (Daghestan notamment), voire même dans certaines républiques de la Volga (Tatarstan).
Déjà très réservée à propos de l’intervention en Libye contre M. Kadhafi, elle oppose ainsi son veto à toute pression extérieure en faveur d’un changement de régime et à d’éventuelles frappes aériennes contre l’armée syrienne – qu’elle appuie et fournit depuis longtemps – à la suite de l’utilisation par cette dernière d’armes chimiques. En accord avec les États-Unis, la Russie contribue directement à résorber les tensions durant l’été 2013.
Son intervention militaire directe à partir de septembre 2015 marque un tournant dans la guerre en Syrie. Par des frappes aériennes massives et indiscriminées (mais aussi un engagement discret au sol) les forces russes donnent l’avantage au régime d’Asad (reprise de la totalité de la ville d’Alep en décembre 2016), tandis que Moscou reprend la main sur le plan diplomatique. En dépit de la conférence d’Astana réunie en janvier 2017 et après l’échec du sommet de Sotchi en janvier 2018, suivi du sommet d’Ankara en avril, une issue politique au conflit peine toutefois à se dessiner.
|
| |
|
| |
|
 |
|
ÉQUATEUR |
|
|
| |
|
| |

ÉQUATEUR
PLAN
* ÉQUATEUR
* GÉOGRAPHIE
* 1. Le milieu naturel
* 2. Une population indienne
* 3. L'économie modernisée, mais sous-développée
* 3.1. Un pays à deux « capitales »
* 3.2. Agriculture, mines et industrie
* 3.3. Commerce et échanges
* HISTOIRE
* 1. De l'Empire inca à la République
* 1.1. La période coloniale
* 1.2. L'indépendance
* 2. La République de l'Équateur
* 2.1. Entre libéraux et conservateurs
* 2.2. De l'instabilité populiste à la modernisation autoritaire
* 2.3. La consolidation démocratique
* 2.4. La faillite économique et financière et ses répercussions politiques et sociales
* 2.5. La présidence de Rafael Correa et le tournant à gauche (2006-)
* La construction du nouveau régime
* 2.6. Le troisième mandat de R. Correa
* 2.7. La succession de R. Correa (2017-)
Équateur
en espagnol Ecuador
Nom officiel : République de l'Équateur
État d'Amérique du Sud baigné à l'ouest par l'océan Pacifique, l'Équateur est limité au sud et à l'est par le Pérou, au nord par la Colombie.
L'Équateur est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (O.P.E.P.).
* Superficie : 270 670 km2
* Nombre d'habitants : 15 738 000 (estimation pour 2013)
* Nom des habitants : Équatoriens
* Capitale : Quito
* Langue : espagnol
* Monnaie : dollar des États-Unis
* Chef de l'État : Lenín Moreno Garcés
* Chef du gouvernement : Lenín Moreno Garcés
* Nature de l'État : république à régime présidentiel
* Constitution :
* Entrée en vigueur : 20 octobre 2008
* Révisions : juillet 2011, décembre 2015
Pour en savoir plus : institutions de l'Équateur
GÉOGRAPHIE
Les Andes forment de hauts plateaux dominés par des volcans et séparent la plaine côtière, plus large et plus humide au nord, de la région orientale, amazonienne, recouverte par la forêt dense. La population, augmentant rapidement et urbanisée environ aux deux tiers, est composée pour 80 % de métis et d'Amérindiens. Le riz et le maïs sont les principales cultures vivrières ; le cacao, le café et, surtout, la banane représentent les plus importantes cultures commerciales. Mais le pétrole est devenu la ressource essentielle et constitue la base des exportations.
1. Le milieu naturel
Trois régions très différenciées s'opposent par leur altitude et leur climat.
Au centre se situe la région andine, ou Sierra. Les Andes se divisent en deux cordillères encadrant des bassins élevés. La Cordillère occidentale (6 272 m au Chimborazo) est la plus aisément franchissable et se prolonge vers la côte par des chaînons et des collines entaillées de nombreuses vallées. La Cordillère orientale, plus massive, rend difficiles les communications avec l'Oriente. Le volcanisme est partout très actif avec les puissants édifices du Chimborazo, du Cotopaxi, du Sangay. Les bassins, situés entre 2 200 et 2 800 m d'altitude, se sont formés à la fin du tertiaire et ont été comblés par des dépôts volcaniques. En position d'abri, la sécheresse y est importante, en particulier au sud et au centre. L'étagement de la végétation fait se succéder, sur les versants, la forêt tropicale décidue jusqu'à 2 000 m, puis plus dégradée jusqu'à 3 200 m avec des bambous. L'étage froid, au-dessus de 3 200 m, comporte une steppe à graminées au sud et une prairie humide au nord. Les cultures sont surtout dans l'étage tempéré des bassins.
La région littorale s'élargit du sud au nord et change de paysage en fonction de la latitude. Au sud, elle subit encore les influences sèches du courant du Pérou avec une brousse arbustive. Au centre, le bassin du Guayas, formé du Daule, du Vinces, du Babahoyo, est une plaine inondable, jadis malarienne, avec un delta couvert de mangrove. Le peuplement lui a longtemps préféré les collines de grès et d'argiles du Manabí, avec des sols plus légers et mieux drainés et une savane à kapokiers. Le Nord, très humide, est couvert par la forêt dense. Au large, les Galápagos, îlots volcaniques, abritent une faune variée de « fossiles vivants » (faune relicte).
On retrouve la forêt dense dans l'Oriente, partie de la plaine amazonienne, chaude et humide, à laquelle on accède par les vallées étroites du Napo, du Pastaza, du Zamora.
2. Une population indienne
L'Équateur, avec une population estimée à 13,6 millions d'habitants en 2009, possède la plus forte densité de peuplement de d’Amérique du Sud (45 habitants par km2). Il comprend une importante population de souche indienne qui demeure, généralement, en marge de la communauté nationale. En 1998, 63 % des Équatoriens vivaient en milieu urbain, notamment dans les principales villes, Quito, Guayaquil et Cuenca. Au milieu des années 1990, 25 % de la population urbaine et 47 % la population rurale étaient considérés comme pauvres, 10 % des citadins et 22 % des ruraux vivant en dessous du seuil de pauvreté. La croissance de la population, estimée à 1,7 % par an pour la période 2000-2005, est en baisse. La Colombie accuse une diminution du taux de natalité, passé de 42,8 ‰ (1965-1970) à 25,6 ‰ (1995-2000). La mortalité infantile est passée de 106,8 ‰ (1965-1970) à 32 ‰ (2000-2005). La population est jeune (34 % des habitants sont âgés de moins de 15 ans) et l'espérance de vie est de 70 ans.
3. L'économie modernisée, mais sous-développée
L'Équateur, qui fut longtemps un grand producteur mondial de cacao, a vu son économie transformée, dans les années 1970, par la découverte et l'exploitation d'importantes réserves pétrolières. Devenu membre de l'O.P.E.P., il est alors le deuxième exportateur de pétrole de l'Amérique latine. À partir des années 1980, la baisse des cours pétroliers sur le marché mondial entraîne une grave crise économique, alliée à l'augmentation de la dette extérieure, que le tremblement de terre de 1987 ne fait qu'accroître. Le pays cesse ses exportations d'hydrocarbures pendant six mois tandis que les taux d'inflation et de chômage connaissent une forte progression. À partir des années 1990, son économie retrouve un nouvel élan, grâce notamment aux exportations agricoles. Il quitte l'O.P.E.P. en 1992 et procède à des privatisations et à une libéralisation de ses échanges. L'essor pétrolier a modernisé le pays, sans pour autant le sortir de son sous-développement. L'Équateur redevient membre de l'O.P.E.P. en 2007.
3.1. Un pays à deux « capitales »
Traversé du nord au sud par la cordillère des Andes, l'Équateur possède trois régions bien distinctes : la côte pacifique, les Andes et l'Oriente. C'est sur les Andes, région de polyculture vivrière, que se trouve Quito, la capitale, qui a largement profité de la rente pétrolière. Dans le Sud, sur la côte pacifique, se situe Guayaquil, ville dont l'importance est égale, voire supérieure, à celle de la capitale. C'est la région de l'agriculture commerciale, fondée sur de grandes propriétés foncières. L'axe Quito-Guayaquil, dyarchie métropolitaine unique en Amérique latine, représente le centre économique du pays. Autour de ce centre, des espaces périphériques (les Andes autour de Cuenca, de Loja et de Tulcán) comportent quelques-unes des plus importantes poches de grande pauvreté rurale au sein du pays. L'Oriente et le Nord côtier constituent le domaine forestier. Région de colonisation (fronts pionniers), ces espaces en marge sont encore faiblement desservis par les réseaux nationaux.
À 500 milles de la côte se trouve l'archipel des îles Galápagos, qui abrite une importante industrie touristique.
3.2. Agriculture, mines et industrie
Le secteur de l'agriculture, de la pêche et des produits forestiers représentait, en 1998, 13 % du P.I.B. Les principales cultures commerciales sont la banane (2e rang mondial) et le café (15e rang). La production destinée au marché intérieur se fait sur des microfundia qui ne présentent qu'un faible degré de mécanisation et qui souffrent d'une insuffisance des infrastructures.
Le secteur mines et industrie constitue, pour sa part, 35 % du P.I.B. et 22 % des exportations. Dans les années 1970, l'essor pétrolier a permis un programme d'industrialisation dans le cadre d'une politique de substitution des importations. La fin des mesures protectionnistes et la libéralisation des échanges dans les années 1990 exposent désormais ce secteur à la concurrence des produits importés. N'étant plus compétitif sur le marché intérieur, celui-ci se tourne dès lors vers l'exportation. Les principales branches industrielles restent l'agroalimentaire (boissons, notamment), le pétrole (les hydrocarbures et les produits dérivés représentent 14 % du P.I.B.) et le tabac, mais les exportations se développent, aujourd'hui, dans d'autres secteurs (chimie, minerai, papeterie). Les entreprises industrielles se localisent essentiellement autour de Quito et de Guayaquil. L'exploitation et l'activité pétrolières se concentrent dans l'Oriente et dans le bassin amazonien tandis que les principales raffineries se situent dans la région côtière (Esmeraldas au nord, La Libertad au sud).
3.3. Commerce et échanges
Les principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis (38 % des exportations, 31,5 % des importations), suivis des membres du Pacte andin (Chili, Pérou, Bolivie, Colombie), auquel le pays appartient depuis 1969.
HISTOIRE
1. De l'Empire inca à la République
Le territoire de l'actuel Équateur est, au xe s., peuplé par des tribus formant de petits royaumes indépendants. Vers la fin du xve s., l'Inca Túpac Yupanqui annexe le pays, qui constitue, avec les territoires occupés aujourd'hui par le Pérou, la Bolivie et le nord du Chili, l'Empire inca « des quatre points cardinaux » (Tahuantinsuyu).
1.1. La période coloniale
En 1525, Huayna Capac ayant partagé ses États entre ses deux fils, Atahualpa et Huáscar, une guerre fratricide affaiblit l'Empire inca, au moment même où Pizarro commence sa conquête (1532). L'Équateur, appelé alors le royaume de Quito, voit la défaite du dernier général d'Atahualpa, Rumiñahui, battu en 1534 par Belalcázar, qui prend la même année Quito. Il suit dès lors les destinées du Pérou ; il devient en 1563 l'audienca de Quito, qui dépend d'abord du vice-roi du Pérou, puis du vice-roi de la Nouvelle-Grenade (1717) ; de nouveau sous l'autorité de Lima en 1723, il est finalement restitué à la Nouvelle-Grenade de 1739 jusqu'à la proclamation de la république. Dès cette époque se dessine la dualité de l'Équateur moderne : la côte, c'est-à-dire la vallée du Guayas, qui vit de l'agriculture moderne (au xviiie s.), la culture du cacaoyer, avec une main-d'œuvre d'esclaves noirs), s'oppose à la Sierra, hauts plateaux isolés avec leurs haciendas et leur agriculture traditionnelle, dirigée par l'aristocratie foncière et politique de Quito.
1.2. L'indépendance
L'influence des encyclopédistes français se fait sentir en Équateur grâce à la mission géodésique venue pour mesurer l'arc de méridien, et qui comprend La Condamine et Bouguer. À la fin du xviiie s., le mécontentement créole se manifeste surtout dans l'élite intellectuelle de Quito, réunie autour de Santa Cruz y Espejo. Une conspiration proclame l'indépendance le 10 août 1809, mais celle-ci est éphémère. Il faut attendre 1820, avec l'arrivée des troupes de Bolívar, l'insurrection de Guayaquil et la victoire du général Sucre sur les pentes du Pichincha (24 mai 1822), pour voir la victoire des « patriotes ». Le pays fait alors partie de la Fédération de Colombie, fondée par Bolívar. Toutefois, celle-ci ne survit pas aux guerres avec le Pérou. En 1830, suivant l'exemple du Venezuela, Quito se déclare indépendante sous le nom de República del Ecuador.
2. La République de l'Équateur
2.1. Entre libéraux et conservateurs
La vie politique de la jeune République, aux mains de militaires, héros des batailles de l'indépendance, est marquée par la rivalité entre les propriétaires fonciers de la côte, partisans du parti libéral, et ceux des Andes, militants du parti conservateur. Le général Juan José Flores (1830-1834) devient le premier président de la République. Représentant de l'oligarchie de Quito, il est renversé en 1835 par le chef de l'opposition armée de Guayaquil, Vicente Rocafuerte. Cette rivalité et les coups de force de ces caudillos perdurent durant tout le xixe s. L'État reste décentralisé jusqu'à ce que le chef des conservateurs catholiques, Gabriel García Moreno, accède à la présidence. Sous son gouvernement (1861-1865 et 1869-1875), une nouvelle Constitution (la septième depuis l'indépendance) établit le suffrage universel. Moreno fait consacrer la République au Sacré-Cœur, confie la totalité de l'enseignement à l'Église et centralise l'administration publique et les impôts. Après son assassinat, en 1875, le pouvoir reste aux mains des conservateurs jusqu'à la révolution de 1895, qui permet le retour des libéraux et la laïcisation de la société, sous la présidence d'Eloy Alfaro (1895-1912).
2.2. De l'instabilité populiste à la modernisation autoritaire
À la mort d'Eloy Alfaro, en 1912, l'Équateur sombre à nouveau dans une instabilité politique chronique, aggravée par la crise économique mondiale de 1929. Devenu le premier exportateur mondial de cacao, le pays est victime de la monoculture et de la baisse des cours de ce produit. Jusqu'en 1948, le pays voit se succéder vingt-et-un gouvernements, dont neuf seulement vont au terme de leur mandat. Le personnage central de cette période est José María Velasco Ibarra, chef charismatique qui domine la vie politique de l'Équateur pendant une trentaine d'années. Il accède au pouvoir pour la première fois lors de l'élection présidentielle de 1934, mais il est renversé dès 1935. Après le conflit avec le Pérou (1941-1942), à la suite duquel l'Équateur perd ses provinces amazoniennes, une junte militaire le porte à nouveau au pouvoir en 1944. Renversé en 1947, J. M. Velasco Ibarra, dont le populisme s'inspire du péronisme argentin, est réélu président en 1952, et parvient à se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. En 1960, candidat du Front national et comptant avec l'appui des communistes, il accède, pour la quatrième fois, à la fonction présidentielle. Sa politique nationaliste provoque le mécontentement du secteur des exportations agroalimentaires, et le conflit avec son vice-président, Carlos Julio Arosamena, précipite sa chute. Il est renversé pour la troisième fois en 1961 par une junte militaire, qui place le libéral C. J. Arosamena au poste présidentiel.
L'influence de la révolution cubaine (1959) coïncide avec la montée des revendications sociales en Équateur. Les militaires, qui accusent C. J. Arosamena de favoriser le régime de Cuba, le déposent et prennent le pouvoir en 1963 pour trois ans. Renversée sans effusion de sang, la junte laisse place à un gouvernement civil provisoire, et une Assemblée est chargée de rédiger une nouvelle Constitution, la seizième depuis l'indépendance. Lors de l'élection présidentielle de 1968, J. M. Velasco Ibarra accède pour la cinquième fois au pouvoir, à l'âge de 75 ans. Aux prises avec une crise économique profonde, le vieux caudillo, menacé par un coup d'État, dispose en 1970 de pouvoirs dictatoriaux. Mais, deux ans plus tard, les chefs militaires le déposent, et le général Guillermo Rodríguez Lara prend le pouvoir. En 1976, ce dernier doit céder sa place à un Conseil suprême de gouvernement composé des chefs d'état-major des trois armées.
Au cours des années 1970, l'exploitation intensive des hydrocarbures (découverts en 1973) conduit à un changement significatif du pays. La rente pétrolière permet en effet un développement économique ainsi que l'émergence de nouvelles élites et l'essor d'une classe moyenne urbaine. À l'instar des autres pays latino-américains producteurs de pétrole (Venezuela, Mexique), l'État équatorien se consolide dans son rôle de promoteur d'une modernisation sociale, économique et politique. Mais le miracle pétrolier laisse à l'écart presque la moitié de la population, en particulier les paysans, généralement amérindiens, aux très faibles revenus.
2.3. La consolidation démocratique
Une nouvelle Constitution, accordant des droits sociaux et le droit de vote aux analphabètes, est proposée par la junte militaire (au pouvoir depuis 1976) dirigée par l'amiral Alfredo Poveda. Elle est approuvée par référendum le 15 janvier 1978. Les élections de 1979 marquent le retour des civils au pouvoir grâce à la victoire du candidat du parti populiste Concentration de forces populaires (CFP), Jaime Roldós Aguilera. Mais le gouvernement est confronté, à partir des années 1980, à la baisse des cours mondiaux des hydrocarbures qui entraîne un tassement des ressources nationales et un accroissement de la dette extérieure. Le nationalisme se présente alors comme une porte de sortie à la crise gouvernementale : en janvier 1981, un affrontement armé éclate avec le Pérou. L'Équateur, en effet, n'a jamais renoncé à ses provinces perdues en 1942, d'autant plus qu'elles renferment de riches gisements de pétrole. À la suite du décès de J. Roldós Aguilera lors d'un accident d'avion (24 mai 1981), le vice-président Osvaldo Hurtado Larrea, leader du parti Démocratie populaire, assume le pouvoir.
L'aggravation des difficultés économiques, due à la baisse des cours de certains produits agricoles (café, cacao), oblige le gouvernement Hurtado Larrea à négocier avec le Fonds monétaire international (FMI). La mise en œuvre de politiques d'austérité accentue les tensions sociales et conduit à la victoire, lors de l'élection présidentielle de 1984, du candidat de droite du parti social chrétien (PSC), León Febres Cordero. Ce dernier, développant à la fois un discours qui attire certaines couches défavorisées et une politique de libéralisme économique qui favorise les entrepreneurs et les rentiers, ne parvient pas à mettre fin à la crise. Partisan d'une démocratie musclée, il entre en conflit avec le Parlement, et recourt fréquemment à des décrets-lois. Malgré le cortège de mécontentements, la tentative de coup d'État du général Franck Vargas, en mars 1986, est un échec. Le rejet de l'autoritarisme de droite et l'intensification des difficultés économiques permettent le succès de la Gauche démocratique à l'élection présidentielle de 1988.
Le nouveau chef de l'État, Rodrigo Borja Cevallos, se trouve confronté à un taux élevé de chômage et d'inflation, ainsi qu'à une pénurie des produits de base. Borja Cevallos reprend à son compte les orientations économiques de ses prédécesseurs et fait appel à plusieurs personnalités issues des rangs de la droite. La légitimité de cette dernière se renforce et lui permet de s'imposer sans difficulté à l'élection présidentielle de 1992, avec la victoire de Sixto Durán Ballén. Le nouveau gouvernement développe un processus de privatisation économique et réduit le taux d'inflation et le déficit public. Mais il suscite une opposition dans divers secteurs, motivée par l'accroissement de la pauvreté, et est confronté aux revendications des Amérindiens, dont le mouvement, lancé en 1990, ne cesse de s'amplifier. La corruption au sein du gouvernement conduit à une crise politique, tandis que le vieux conflit frontalier avec le Pérou dégénère, une fois de plus, en guerre ouverte entre janvier et février 1995 (la « guerre du Condor »).
Cette crise provoque un réalignement de l'électorat, notamment d'une large part des classes moyennes, qui assure la victoire, lors des élections générales de 1996, à un candidat ouvertement populiste, Abdalá Bucaram Ortiz. Ce dernier, après avoir fondé un parti « roldosiste » équatorien (du nom de l'ex-président J. Roldós Aguilera, PRE), arrive au pouvoir grâce à un discours promettant la fin des oligarchies et la diminution de la pauvreté. Mais, au terme de six mois d'exercice, le nouveau président se montre incapable de présenter une politique de gouvernement cohérente. Après cinq semaines de mobilisation et de contestation, le Parlement destitue Bucaram Ortiz, le 6 février 1996, pour « incapacité mentale à gouverner ». Le président du Parlement, Fabian Alarcón, assure l'intérim du pouvoir jusqu'au 10 août 1998, date à laquelle Jamil Mahuad Witt, candidat de la Gauche démocratique et ancien maire de Quito, prend ses fonctions, après sa victoire à l'élection présidentielle.
Au niveau régional, après trois années de négociations intenses, qui ont débuté au lendemain de la guerre de 1995, un accord de paix (acte de Brasília) est signé par l'Équateur et le Pérou en octobre 1998 (entériné solennellement en mai 1999), mettant fin à plus d'un demi-siècle de querelles frontalières entre les deux pays. Le Pérou conserve la souveraineté sur les 200 000 km2 de l'Amazonie péruvienne, mais cède à son voisin une enclave de 1 km2 à Tiwinza, dans la cordillère du Condor.
2.4. La faillite économique et financière et ses répercussions politiques et sociales
Depuis 1998, l'Équateur est touché par une profonde récession, qui a pour origine – outre les problèmes structurels propres au pays – les effets dévastateurs d'El Niño (1997-1998), la chute du cours du pétrole et les répercussions des crises asiatique (baisse des exportations), puis brésilienne (fuite des capitaux). En 1999, la situation se détériore – dévaluation de la monnaie, inflation galopante, fermeture des banques faute de liquidités –, entraînant une dégradation du climat social – grèves générales, état d'urgence, marche des Indiens vers la capitale. En janvier 2000, en réaction à la corruption et à la politique néo-libérale du président (son projet qui vise à remplacer la monnaie nationale, le sucre, par le dollar, provoque une hausse très importante des prix), différents syndicats et mouvements politiques multiplient les mouvements de protestation et réclament la démission de Jamil Mahuad. Cette situation explosive aboutit à une grave crise politique provoquée par un nouveau soulèvement indigène : le 21, les Indiens envahissent le Congrès et destituent le président avec l'aide d'une faction de l'armée emmenée par Lucio Gutiérrez. Après quelques heures de confusion, le haut commandement de l'armée parvient à contrôler la rébellion par l'intermédiaire du général Carlos Mendoza, qui décide de faire marche arrière et impose le vice-président, Gustavo Noboa, à la tête de l'État. Celui-ci affirme aussitôt sa volonté de parachever les réformes lancées par son prédécesseur, allant à l'encontre de la principale revendication des instigateurs de la révolte. Ce coup d'État avorté contribue à une radicalisation des deux camps : alors que les autorités procèdent à une série d'arrestations parmi les officiers rebelles, les syndicalistes et les militants des mouvements de protestation, les Indiens se promettent de poursuivre la mobilisation.
En septembre 2000, le dollar remplace officiellement le sucre – ultime tentative pour redresser l'économie du pays, après la chute vertigineuse du sucre en 1999 –, en dépit des réticences d'une partie de l'opinion qui considère que cette mesure revient à un abandon de souveraineté. D'autre part, cette décision fait craindre une hausse du chômage, une perte du pouvoir d'achat et surtout une aggravation des inégalités sociales.
L'élection présidentielle du 25 novembre 2002 est remportée par le colonel et ancien putschiste L. Gutiérrez, grâce au soutien du Mouvement populaire démocratique (MDP, gauche) et du Pachakutik, bras politique du mouvement indigène, à qui il propose de participer au sein d'un gouvernement de coalition. Toutefois sa politique néolibérale, sa soumission aux règles du FMI et son rapprochement avec les États-Unis provoquent le départ de deux ministres indigènes (juillet 2003) et les manifestations d'Indiens et de la gauche exigeant, dès juin 2004, sa démission. Confronté à une forte opposition parlementaire, il évince les membres les plus à gauche de son gouvernement en août 2004 et essuie un sévère échec aux élections locales d'octobre. Désireux de consolider son pouvoir, il tente en décembre de placer des fidèles à la Cour suprême, organe judiciaire normalement indépendant, mais, ce faisant, il suscite de vifs mouvements de protestation populaire qui s'amplifient en avril 2005 et aboutissent à sa destitution par le parlement. Son vice-président, Alfredo Palacio, lui succède alors, avec pour mission de terminer le mandat en cours. Il n'en propose pas moins une série de réformes institutionnelles visant à « refonder l'État », que les parlementaires, décriés dans l'opinion publique et menacés par ces projets, s'emploient à enterrer.
2.5. La présidence de Rafael Correa et le tournant à gauche (2006-)
Au second tour de l'élection présidentielle de novembre 2006, Rafael Correa, économiste de gauche (quasiment) nouveau venu en politique, l'emporte facilement (56,5 % des voix) sur son adversaire de droite, l'ultralibéral et milliardaire Álvaro Noboa. Pour mettre en application son programme d'inspiration bolivarienne, qui prévoit, outre un large volet social et la lutte contre la corruption, la renégociation de la dette, le passage à terme au socialisme, le renforcement de la souveraineté nationale et une prise de distance vis-à-vis des États-Unis, il annonce, ne disposant d'aucun député au Congrès, la tenue d'un référendum sur la création d'une Assemblée nationale constituante chargée de rédiger de nouvelles institutions.
Malgré l'opposition initiale du Parlement, la consultation populaire a lieu en avril et donne près de 82 % de « oui ». En septembre 2007, la nouvelle formation politique, l'Alliance PAÍS (« Pays » et acronyme de « Patria altiva y soberana », Patrie orgueilleuse et souveraine), qui soutient le projet du président, remporte 70 % des suffrages et une très large majorité dans l'Assemblée constituante – suspectée par certains de vouloir mettre en place un régime chaviste. Après avoir révoqué le Congrès et repris à son compte l'activité législative, cette assemblée adopte, en juillet 2008, le projet constitutionnel qui est approuvé par référendum, avec environ 64 % de votes favorables, le 28 septembre, et qui entre en vigueur le 20 octobre.
Présentée par ses plus fermes partisans comme une étape supplémentaire dans la construction du « socialisme du xxie siècle », la nouvelle loi fondamentale renforce les prérogatives financières et économiques de l'État en vue d'une politique axée sur le développement, à la fois planifié et déconcentré, au service du « bien vivre » (sumak kawsay en quechua) et dans le cadre d'une économie « sociale et solidaire ». La souveraineté nationale est également affirmée au plan international, priorité étant donnée à l'intégration de la région andine et de l'Amérique latine. Par ailleurs, parmi les innovations du texte, une « fonction de transparence et de contrôle social », confiée notamment à un « Conseil de participation citoyenne et de contrôle social » et à des « médiateurs du peuple » (defensores del Pueblo), est désormais inscrite dans la nouvelle organisation du pouvoir.
En prévoyant expressément la protection de la nature (la Pacha Mama ou « Terre Mère ») dans plusieurs de ses articles, la Constitution impose également des limites à l’exploitation des ressources minières du pays. Un ambitieux projet écologique voit ainsi le jour visant à préserver la réserve de biosphère Yasuní de toute extraction pétrolière contre une compensation financière apportée par la communauté internationale. Cette initiative Yasuní-ITT (pour Isphingo-Tambococha-Tiputini, la zone amazonienne où se trouve un important gisement), reçoit le soutien d’un certain nombre de pays.
La construction du nouveau régime
Un « régime de transition » est instauré avant les élections générales d'avril 2009, à l'issue desquelles R. Correa est réélu dès le premier tour avec près de 52 % des suffrages devant Lucio Gutierrez, candidat du PSP (parti Société patriotique, 28,2 % des voix) et Alvaro Noboa, du PRIAN (parti rénovateur institutionnel Action nationale, 11,4 % des suffrages). L'alliance progouvernementale PAÍS remporte près de 46 % des voix et 59 sièges sur 124 devant 17 partis et mouvements dont le PSP (19 sièges), le parti social-chrétien (11 sièges) et le PRIAN (7 sièges). Ne disposant pas d'une majorité absolue, le président – qui annonce l'adhésion de son pays à l'Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) en juin – peut compter sur l'appui du Mouvement démocratique populaire (MPD, 5 sièges) et de divers petits partis également représentés à l'Assemblée nationale. Celle-ci tient sa session inaugurale le 31 juillet et élit à sa présidence Fernando Cordero, du mouvement PAÍS, avec une majorité de 74 députés. S'engageant à accélérer la « révolution citoyenne » jugée « irréversible », R. Correa est officiellement investi pour son second mandat le 10 août.
Les relations avec l’opposition et certains organes de presse se détériorent cependant rapidement. Après avoir dû faire face à la rébellion d’une partie des forces de l’ordre en septembre 2010 – déjà présentée par le pouvoir comme une tentative de déstabilisation – R. Correa affronte ouvertement les médias qu’il poursuit devant la justice et tente de réguler à l’occasion d’un référendum organisé en mai 2011 visant aussi à réformer le système judiciaire. Cette consultation, qui se transforme en affrontement entre majorité et opposition, le « oui » l’emportant avec moins de 50 % des voix, révèle les tensions entre un régime aux tendances plébiscitaires et une partie de la population, alors que R. Correa doit également répondre à l’hostilité de ses alliés des communautés indiennes représentées par la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (CONAIE) à plusieurs projets miniers du gouvernement dans un secteur clé de l’économie du pays.
2.6. Le troisième mandat de R. Correa
En février 2013, R. Correa est réélu dès le premier tour avec 57,17 % des suffrages devant sept autres candidats dont Guillermo Lasso, du mouvement CREO fondé en 2010, qui obtient 22,68 % des voix. Le parti présidentiel, l’alliance PAÍS, s’impose également massivement à l’Assemblée nationale avec 52,3 % des suffrages et 100 sièges sur 137. Le président peut désormais compter sur une majorité absolue et les relations avec l’opposition se détériorent encore d’un cran après l’adoption d’un projet de loi sur les médias très controversé en juin. Parmi les mesures prévues, la nouvelle répartition des fréquences entre médias audiovisuels privés, publics et communautaires au détriment des premiers et la répression du délit de « lynchage médiatique » sont les plus contestées.
La réélection de R. Correa s’explique en partie par la bonne situation économique du pays : la croissance soutenue – plus de 7 % en 2011 et 5 % en 2012 –, s’est accompagnée depuis 2007 d’une réduction notable de la pauvreté, mais elle est largement due au commerce extérieur et aux exportations de pétrole. Faute d’avoir récolté les sommes espérées pour compenser le manque à gagner, le gouvernement doit ainsi abandonner le projet de sanctuarisation du parc Yasuní et ouvrir la porte à l’exploitation pétrolière (qui n’affecterait toutefois que 1 % de la réserve) dans cette région amazonienne, une décision très mal accueillie par les communautés amérindiennes et par certaines organisations écologiques qui tentent de s’y opposer et demandent un référendum.
Après sept années de succès ininterrompus, le gouvernement subit, à sa grande surprise, son premier revers lors des élections municipales et locales de février 2014, à l’issue desquelles l'Alliance PAÍS conserve certes son implantation nationale, mais perd les principales villes du pays dont Quito, Guayaquil et Cuenca, et sur 23 préfectures, n'en remporte que 10.
2.7. La succession de R. Correa (2017-)
Le président sortant ayant écarté l’idée de se représenter à la faveur d’un projet de réforme constitutionnelle qui est finalement reporté, c’est Lenín Moreno (vice-président en 2007-2013) qui est choisi comme candidat à l’élection présidentielle de février et avril 2017 par l’alliance PAÍS, qui conserve sa majorité à l’Assemblée nationale mais recule face à l’opposition en ne remportant que 74 sièges. Le principal adversaire du camp progouvernemental est de nouveau Guillermo Lasso, candidat de la coalition libérale « Alliance pour le changement ».
L’augmentation de la corruption, révélée notamment en 2016 par les pratiques de l’entreprise brésilienne de travaux publics Odebrecht dans plusieurs États d’Amérique latine, et le gouvernement économique du pays, dont la gestion du secteur pétrolier, sont parmi les principaux thèmes débattus à l’occasion de cette échéance électorale.
S’inscrivant dans la continuité du gouvernement sortant et prônant en priorité la poursuite des programmes sociaux, L. Moreno frôle la victoire au premier tour (39,36 % des voix) avant de l’emporter de justesse au second avec 51,16 % des suffrages. Entré en fonctions le 24 mai, il doit faire face à une situation économique directement affectée depuis 2016 par la baisse du prix du pétrole et à une société de plus en plus polarisée.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|