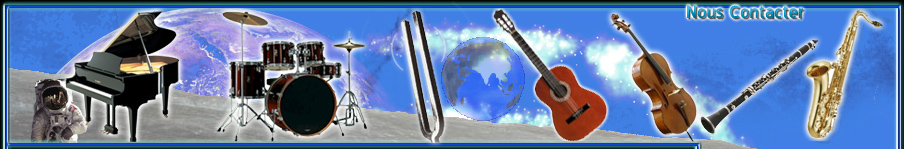|
|
|
|
 |
|
LE VIÊT NAM |
|
|
| |
|
| |
DOCUMENT larousse.fr LIEN
PLAN
VIÊT NAM : HISTOIRE
1. Les origines
1.1. Le royaume du Nam Viêt
1.2. Sinisation
2. Les premières dynasties (939-1428)
2.1. Fondation de l'État vietnamien
2.2. Les Trân
3. L'apogée des Lê postérieurs (1428-1527)
4. Le Dai Viêt du xvie au xviiie siècle
4.1. Les Trinh, seigneurs du Nord
4.2. Au Sud, les Nguyên
5. L'élimination des Tây Son (1789-1802)
6. L'empire du Viêt Nam de 1802 à 1859
6.1. L'œuvre de Gia Long (1802-1820)
6.2. Les derniers Nguyên
7. Le Viêt Nam et son intégration à l'Indochine française (1859-1927)
7.1. L'établissement des protectorats français sur l'Annam et le Tonkin
7.2. La colonisation française
8. De l'éveil du nationalisme vietnamien à la première République du Viêt Nam (1927-1945)
8.1. Premières revendications vietnamiennes
8.2. Naissance parti communiste indochinois
8.3. La République démocratique indépendante du Viêt Nam
9. Le Viêt Nam et la guerre d'Indochine (1946-1954)
9.1. L'échec de la conférence de Fontainebleau
9.2. La guerre
9.3. La conférence de Genève
10. La partition du Viêt Nam
10.1. La République démocratique du Viêt Nam
10.2. La République du Viêt Nam
Le régime dictatorial de Ngô Dinh Diêm
Nguyên Van Thiêu
11. La difficile réunification
12. Le conflit khméro-vietnamien
13. Le conflit sino-vietnamien et les priorités économiques
14. Sur la voie du « renouveau » (doi moi)
15. Le Viêt Nam du xxie siècle
16. La politique étrangère depuis 1989
Voir plus
Viêt Nam : histoire
Le Viêt Nam
1. Les origines
1.1. Le royaume du Nam Viêt
L'actuel Viêt Nam a été peuplé d'abord par des Australoïdes, des Mélanésiens et des Indonésiens (civilisations paléolithiques de Hoa Binh et de Bac Son). Au néolithique, le brassage dans le bassin du fleuve Rouge des Muongs, des Viêts et d'apports chinois a donné naissance à l'actuel peuple vietnamien. Ces riziculteurs, influencés par les Chinois, puis soumis, sont regroupés dans un royaume du Nam Viêt (208 avant J.-C.), avant d'être incorporés au domaine des Han par l'empereur Wudi (111 avant J.-C.).
1.2. Sinisation
Wudi divise ce pays en trois commanderies impériales : celles de Qué Lâm, de Nam Hai et de Tuong Quân. Il en résulte une sinisation profonde du pays (pénétration du taoïsme et confucianisme).
Après plusieurs tentatives de révoltes, notamment celle des sœurs Trung (40 après J.-C.), les Vietnamiens, dont le pays est profondément pénétré par le bouddhisme à partir du iie siècle, sont attaqués par le Champa (vers 780), qui occupe Hue, le Quang Tri et le Quang Binh, puis par le Nanzhao (Yunnan), qui pille Hanoi (863).
2. Les premières dynasties (939-1428)
2.1. Fondation de l'État vietnamien
Le Viêt NamLe Viêt Nam
Profitant de la chute des Tang (907), les Vietnamiens, dirigés par Ngô Quyên, rejettent la domination chinoise (939) et créent, sous la dynastie des Ngô (939-968), un État annamite qui englobe le Tonkin, le Thanh Hoa, le Nghê An et le Ha Tinh.
En 968, Dinh Bô Linh, fondateur de la dynastie des Dinh (968-980), en fait le royaume du Dai Cô Viêt, à la fois indépendant et vassal de la Chine.
Dès lors, et sous les dynasties successives des Lê antérieurs (980-1009) et surtout des Ly (1010-1225), l'État vietnamien assoit ses institutions : Thang Long (sur le site actuel de Hanoi) devient la capitale (1010) ; le royaume est divisé en vingt-quatre provinces, gouvernées par des princes du sang et administrées par des lettrés, dont la multiplication est favorisée par la généralisation de l'instruction ; la mise en place d'un important réseau routier et la création d'un système fiscal général (1013) permettent d'entretenir une puissante armée de paysans animée d'un profond esprit national, qui entame une lente progression vers le sud ; celle-ci, de delta en delta, mènera les Annamites jusqu'en Cochinchine.
Dès 1070, le Quang Binh et le nord du Quang Tri sont réoccupés, tandis que l'invasion chinoise des Song est repoussée (1077) et que la paix intérieure est rétablie, ce qui permet de reprendre la mise en valeur économique du Delta (constructions de digues pour retenir les crues du fleuve Rouge, 1108).
2.2. Les Trân
La dynastie des Trân (1225-1413) repousse les invasions des Mongols (1257, 1285 et 1287), dont elle reconnaît pourtant la suzeraineté (1258 et 1288) ; parallèlement, elle accentue la progression vietnamienne, occupant en 1306 le sud du Quang Tri et le Thua Thien (région de Huê).
Mais la multiplicité des conflits affaiblit la dynastie, favorise, au xive siècle, l'émancipation des paysans, l'appropriation des terres par les mandarins et, par contrecoup, les révoltes paysannes et les coups d'État, dont l'un aboutit à la prise du pouvoir par Hô Qui Ly (1400), qui ordonne aussitôt une réforme agraire. À la faveur de ces troubles, les Chinois occupent le Dai Viêt (1406-1407), éliminent le dernier prétendant Trân (1413) et reprennent la sinisation du pays.
3. L'apogée des Lê postérieurs (1428-1527)
L'indépendance est reconquise par un paysan vietnamien, Lê Loi, qui chasse les Chinois (1428) et fonde la dynastie des Lê postérieurs (1428-1527 et 1533-1789). S'appuyant sur les masses paysannes qui ont résisté aux Chinois, et auxquelles Lê Loi a redistribué les terres des propriétaires qui ont collaboré avec les Chinois, la nouvelle dynastie atteint son apogée sous Lê Thanh Tông (1460-1497), qui donne au pays son organisation définitive (adoption du Code de lois Hôngduc), accélère la mise en valeur du centre et du sud du Viêt Nam (colonies militaires ou dôn diên), dont il repousse la frontière méridionale jusqu'au cap Varella, après une victoire décisive sur le Champa (1471), tandis qu'il impose sa suzeraineté aux royaumes Lao du Mékong.
4. Le Dai Viêt du xvie au xviiie siècle
4.1. Les Trinh, seigneurs du Nord
Mais l'incompétence des successeurs de Lê Thanh Tông entraîne l'usurpation des Mac (1527-1592) combattue par la dynastie des Lê, soutenue par Nguyên Kim et Nguyên Hoang et par le gendre de ce dernier, Trinh Kiêm.
En 1592, les Trinh, qui occupent le pays entre la Chine et le Ha Tinh, chassent les Mac, qui se maintiendront jusqu'en 1677 à Cao Bang, et restaurent les Lê, mais entrent en conflit avec les Nguyên établis au sud de la porte d'Annam. Ces derniers, compensant leur infériorité numérique par un armement plus puissant fourni par les Portugais, qui ont établi un comptoir à Fai Fo (aujourd'hui Hôi An) dès 1535, reprennent à leur compte la marche vers le sud. Ils occupent successivement le Phu Yên (1611), le Thanh Hoa (1653), le Binh Thuan (1693), Saigon (1698) et la région de Chau Doc (1724), atteignant ainsi le delta du Mékong et entrant en contact avec les Khmers, qu'ils écartent de la région du golfe de Siam.
Parallèlement, les Trinh, seigneurs du Nord, qui ont mis en tutelle les rois Lê, occupent le territoire entre le fleuve Rouge et le Mékong. La fiscalité accrue, les interventions de l'administration Trinh dans la vie privée des paysans et des commerçants, désireux de pouvoir négocier librement avec les marchands européens qui s'établissent à Hung Yên et à Hanoi (Hollandais entre 1637 et 1700 ; Anglais de 1672 à 1697), favorisent des révoltes agraires, dont la plus importante est celle de 1737-1750.
4.2. Au Sud, les Nguyên
C'est pourtant dans le Sud qu'éclate une révolte populaire décisive, celle des trois frères Tây Son (1773), qui, favorisés par la corruption des Nguyên, établissent leur base de départ à Qui Nhon. Soutenus par les Trinh, qui occupent Huê (1775), ils s'emparent eux-mêmes de Saigon (1776), puis de l'Annam, et se retournent contre les Trinh du Tonkin (prise de Hanoi, 1786), qui appellent en vain les Chinois au secours des rois Lê, définitivement éliminés en 1789. Les trois frères Tây Son se partagent alors le Dai Viêt, l'aîné devenant souverain de l'Annam, le deuxième s'attribuant la Cochinchine, et le troisième le Tonkin.
Mais, faute d'avoir promulgué une réforme agraire en faveur des paysans qui les ont portés au pouvoir, les Tây Son seront facilement éliminés par un héritier de la famille des Nguyên, Nguyên Anh, qui va recevoir l'appui inespéré de forces occidentales grâce à un Français, Monseigneur Pigneau de Béhaine, qui débarque à Ha Tiên comme vicaire apostolique de la Cochinchine en 1774. Depuis près de deux siècles, en effet, l'Église et la France s'intéressent au Dai Viêt, dont l'évangélisation, entreprise par les Portugais, a été reprise par des Français de la Société de Jésus, tel Alexandre de Rhodes, qui, avant d'être expulsé en 1646, a eu le temps de romaniser l'écriture vietnamienne en mettant au point le quôc-ngu (langue nationale), ou par des membres de la Société des missions étrangères. Derrière les missionnaires arrivent les marchands, mais les efforts des uns et des autres échouent, car le catholicisme, jugé dangereux pour la société traditionnelle, est désormais persécuté.
5. L'élimination des Tây Son (1789-1802)
La situation politique est renversée par l'appel que Nguyên Anh et ses conseillers lancent à la France. Monseigneur Pigneau de Béhaine obtient du gouvernement royal la promesse d'une intervention militaire (traité de Versailles, 1787), à laquelle les autorités officielles renoncent très vite. Monseigneur Pigneau de Béhaine reprend alors l'expédition pour son compte personnel, recrute de nombreux volontaires parmi les officiers et les techniciens français d'Extrême-Orient.
Disposant dès lors de moyens militaires importants, Nguyên Anh occupe la Cochinchine (1788), fait construire les forteresses de Saigon et de Nha Trang, détruit la flotte des Tây Son (1792), occupe Huê (1801), Hanoi (1802), devenant l'empereur Gia Long, restaurateur de la dynastie des Nguyên, et premier souverain vietnamien à régner sur toute la côte, de la frontière chinoise au golfe de Siam.
6. L'empire du Viêt Nam de 1802 à 1859
6.1. L'œuvre de Gia Long (1802-1820)
L'État vietnamien est alors réorganisé. Instituant une monarchie absolue et centralisée (six ministères, deux hiérarchies de fonctionnaires civils et militaires), respectant les particularismes provinciaux (maintien de la division en trois ky [pays] : Tonkin, Annam et Cochinchine), Gia Long gagne, en outre, l'appui populaire grâce à d'habiles mesures : amnistie, réforme agraire, surveillance des mandarins, construction de digues, de routes (route Mandarine) et de citadelles.
Ami de la France, il lui refuse pourtant toute concession territoriale ; en revanche, et quoique jaloux de son indépendance, il sollicite de la Chine l'investiture de son empire (1803), et c'est elle qui lui donne le nom de Viêt Nam.
C'est un État fortement sinisé (adoption du Code des Qing de 1811 à 1815, culte des ancêtres, confucianisme, taoïsme, écriture chinoise, société dominée par un mandarinat théoriquement accessible à tous et reposant sur une paysannerie nombreuse).
6.2. Les derniers Nguyên
Mais, après Gia Long, les Nguyên refusent les réformes indispensables (impôts trop lourds, abus des notables). Les paysans, miséreux et mécontents, se révoltent souvent, surtout dans le Tonkin surpeuplé, où le souvenir des Lê reste vivant. En outre, Minh Mang (1820-1841) persécute les chrétiens, qui se soulèvent en Cochinchine (1833-1836) ; enfin, il impose pour la première fois au Cambodge un protectorat vietnamien (1834).
Cette politique, poursuivie par Thiêu Tri (1841-1847) et par Tu Duc (1848-1883), provoque l'intervention de la France, qui désire protéger les missions catholiques tout en s'assurant des points d'appui et des débouchés en Indochine.
7. Le Viêt Nam et son intégration à l'Indochine française (1859-1927)
7.1. L'établissement des protectorats français sur l'Annam et le Tonkin
Prise des forts de Huê, guerre du TonkinPrise des forts de Huê, guerre du Tonkin
Prenant Saigon (1859), des amiraux français occupent la Cochinchine (1859-1867) ; les démêlés des commerçants français au Tonkin (Jean Dupuis) provoquent des interventions militaires (→ Francis Garnier, 1873 ; Henri Rivière, 1882) qui aboutissent à l'établissement des protectorats français sur l'Annam et le Tonkin (1883), confirmés après un conflit armé avec la Chine (second traité de Tianjin, 1885).
7.2. La colonisation française
Après les deux règnes éphémères de Hiep Hoa et de Kien Phuoc (1883-1884), l'empereur Ham Nghi (1884-1888) dirige un soulèvement nationaliste (1885-1888), qui continue, après sa déportation en Algérie, jusqu'en 1896.
Résident général en Annam et au Tonkin (1886), Paul Bert fait de ce dernier ky une vice-royauté séparée.
Les grandes manœuvres en IndochineLes grandes manœuvres en Indochine
Après la création de l'Union indochinoise (→ Indochine française, 1887), les gouverneurs généraux (en particulier Lanessan, 1891-1894) respectent d'abord les particularismes locaux, avant que Paul Doumer impose une administration directe, efficace mais mal supportée (1897-1902) ; ainsi s'explique en partie la révolte de Dê Tham au Tonkin (1908).
Albert Sarraut (1911-1914) calme les esprits par sa souplesse et sa compréhension, annonçant même dans un discours la possibilité du retour progressif du Viêt Nam à l'indépendance. Alexandre Varenne (1925-1928) institue une Chambre des représentants du peuple au Tonkin et en Annam, et, pour protéger les masses contre l'usure ou les mauvais employeurs, il crée le Crédit populaire agricole et l'Inspection générale du travail (1927).
La Cochinchine au TrocadéroLa Cochinchine au Trocadéro
Mais ces mesures, qui viennent compléter une remarquable œuvre économique (rizières, plantations d'hévéas, houillères du Tonkin, etc.) et intellectuelle (création de l'université de Hanoi [1907] et de l'École française d'Extrême-Orient [EFEO]), ne suffisent pas à rallier à la présence française l'opinion vietnamienne.
8. De l'éveil du nationalisme vietnamien à la première République du Viêt Nam (1927-1945)
8.1. Premières revendications vietnamiennes
L'opposition des mandarins du xixe siècle a été relayée, après 1918, par celle d'une bourgeoisie enrichie par le progrès économique, et qui veut désormais participer à la gestion des affaires publiques, et surtout par celle des jeunes intellectuels formés dans les universités françaises et qui se sentent étrangers dans leur propre pays ; certains demandent l'instauration d'une République vietnamienne (→ Nguyên Van Vinh) ; d'autres, tel le parti national du Viêt Nam, fondé en 1927 à Hanoi par des instituteurs, dont Nguyên Thai Hoc, vont jusqu'à réclamer l'expulsion des Français avec l'aide de la Chine du Guomindang.
8.2. Naissance parti communiste indochinois
Si ce parti est brisé à la suite de l'échec de la révolte de la garnison de Yên Bai, qu'il a provoquée (10 février 1930), l'opposition est aussitôt reprise en main par Nguyên Ai Quôc (plus tard Hô Chi Minh), qui, avec les éléments de l'Association de la jeunesse révolutionnaire vietnamienne (Thanh Niên) constituée à Canton en 1925, fonde à Hongkong le parti communiste indochinois (PCI, février 1930), qui provoque des émeutes agraires (mai 1930-septembre 1931).
Ayant rétabli l'ordre par une répression rapide qui disloque le PCI, le gouvernement français décide, à la faveur des débuts du règne de Bao Dai (1932), de promouvoir une politique de réformes en constituant une Commission des réformes, animée par un mandarin catholique, Ngô Dinh Diêm (1933) : la double opposition des notables traditionalistes et des partisans européens de l'administration directe la fait échouer. L'ordre est pourtant maintenu jusqu'à l'intervention du Japon en Indochine (1940).
8.3. La République démocratique indépendante du Viêt Nam
Affiche de propagandeAffiche de propagande
Le Front pour l'indépendance du Viêt Nam (Viêt-minh), fondé par Hô Chi Minh (mai 1941), profite de l'élimination de l'autorité française par les Japonais (9 mars 1945) pour faire abdiquer Bao Dai et pour constituer une République démocratique indépendante (septembre), qui remplace aussitôt dans les villages les conseils de notables par des conseils du peuple .
9. Le Viêt Nam et la guerre d'Indochine (1946-1954)
9.1. L'échec de la conférence de Fontainebleau
Le 2 mars 1946, Hô Chi Minh est proclamé président du nouvel État avant de signer avec la France les accords du 6 mars. Mais, si la France reconnaît l'État libre du Viêt Nam, elle refuse d'y inclure la Cochinchine et ne promet, lors de la conférence de Fontainebleau (juillet-septembre 1946), qu'un référendum sur cette question (modus vivendi du 14 septembre 1946).
9.2. La guerre
Le bombardement français de Haiphong (23 novembre 1946) et le coup de force du Viêt-minh à Hanoi (19 décembre 1946) déclenchent alors une guerre qui sera longue et difficile. Rappelant Bao Dai, la France reconnaît l'unité et l'indépendance du Viêt Nam au sein de l'Union française (accords du 5 juin 1948 et du 8 mars 1949), accepte le rattachement de la Cochinchine au nouvel État et renonce à sa souveraineté.
Le Viêt Nam, dont Bao Dai devient le chef (décembre 1949), doit faire face à l'opposition du Viêt-minh ; la position de ce mouvement se trouve renforcée par la victoire de Mao Zedong en Chine (décembre 1949), qui reconnaît aussitôt le gouvernement de Hô Chi Minh (16 janvier 1950) et aide à la constitution de la puissante armée du général Vô Nguyên Giap, qui surprend les Français à Cao Bang (1950).
La contre-offensive dirigée par le haut-commissaire de Lattre de Tassigny (1951) rétablit la situation, de nouveau compromise après la mort de ce dernier (1952).
9.3. La conférence de Genève
John Foster Dulles, secrétaire d'État américain, le 7 mai 1954John Foster Dulles, secrétaire d'État américain, le 7 mai 1954
Pour reprendre l'initiative, le gouvernement Hô Chi Minh modifie sa structure politique en remplaçant le Viêt-minh par le Liên Viêt (Front national uni), qui accueille les nationalistes non marxistes (mars 1951) ; parallèlement, il renforce son potentiel militaire, et peut reprendre l'offensive au printemps 1953. Celle-ci se termine par la prise de Diên Biên Phu (7 mai 1954), qui met fin à la guerre d'Indochine.
La conférence de Genève (20 juillet 1954) coupe le pays en deux, de part et d'autre du 17e parallèle, en attendant des élections qui doivent définir le régime du Viêt Nam réunifié avant juillet 1956. En fait, la ligne de démarcation suivant la rivière Ben Hôi, à proximité du mur de Dông Hoi construit en 1631 pour séparer les Nguyên des Trinh, ressuscite une vieille séparation politique, qui se concrétise par la formation de deux États nouveaux : la République démocratique du Viêt Nam (Nord Viêt Nam) et la République du Viêt Nam (Sud Viêt Nam).
Pour en savoir plus, voir l'article guerre d'Indochine.
10. La partition du Viêt Nam
10.1. La République démocratique du Viêt Nam
Pham Van DôngPham Van Dông
Le Nord, qui comprend une région autonome (des Thaïs et des Miaos), se constitue en République démocratique du Viêt Nam, dont le président est Hô Chi Minh et le chef du gouvernement Pham Van Dông.
Après l'évacuation de Hanoi par les forces françaises (9 octobre 1954), le gouvernement s'installe dans cette ville, dont il fait sa capitale. Il se heurte aussitôt à l'opposition des populations catholiques, dont une partie seulement peut être évacuée dans le Sud Viêt Nam avec l'aide des forces françaises.
Animé par les communistes, qui contrôlent le Lao Dông ou parti des Travailleurs, le nouveau régime, qui instaure au Nord Viêt Nam une démocratie populaire, met en application un plan de trois ans (1954-1957), qui doit réaliser la réforme agraire, la collectivisation des biens et des moyens de production, et l'industrialisation du pays, avec l'aide de l'URSS, de la Chine et des autres démocraties populaires.
L'échec de la réforme agraire, dû en partie au surpeuplement, à la précipitation et au radicalisme des méthodes, l'arrêt des importations de riz en provenance des deltas du Sud et le rationnement qui en est le résultat provoquent des difficultés dont la responsabilité est rejetée sur Truong Chinh, le premier secrétaire du parti des Travailleurs ; celui-ci est, de ce fait, limogé temporairement au profit de Hô Chi Minh, qui cumule cette fonction avec celle de chef de l'État (29 octobre 1956). Dès lors, la République démocratique du Viêt Nam va poursuivre son évolution politique, et surtout soutenir la lutte, au Sud Viêt Nam, du Front national de libération (FNL).
Yankees, rentrez chez vousYankees, rentrez chez vous
Malgré la mort du président Hô Chi Minh, survenue le 3 septembre 1969, la stabilité politique du pays n'est pas menacée. Si deux remaniements ministériels ont lieu en avril 1974, c'est, semble-t-il, afin de renforcer l'administration pour la reconstruction du pays, désormais objectif principal du gouvernement. Tôn Duc Thang a succédé à Hô Chi Minh. Le pouvoir est partagé entre ceux qui, depuis 1969, assurent collégialement la direction du pays : Lê Duân, premier secrétaire du parti des Travailleurs ; Truong Chinh, président du Comité permanent de l'Assemblée nationale ; Pham Van Dông, Premier ministre ; et le général Vô Nguyên Giap, ministre de la Défense.
10.2. La République du Viêt Nam
Le régime dictatorial de Ngô Dinh Diêm
Au lendemain des accords de Genève (20 juillet 1954), le chef du gouvernement de Saigon, Ngô Dinh Diêm, reprend en main le Sud Viêt Nam. En conflit avec Bao Dai, il organise un référendum, qui dépose l'empereur (octobre 1955) et lui permet de se proclamer chef d'État d'une République nationale du Viêt Nam (octobre 1955), qui se retire de l'Union française (1956). Une Assemblée constituante, élue le 4 mars 1956, adopte une Constitution, définitive le 7 juillet 1956, instaurant un régime autoritaire soutenu par les États-Unis. Avec l'aide de l'armée vietnamienne réorganisée sous la direction d'instructeurs américains, il liquide les sectes politico-religieuses (caodaïsme, Hoa Hao, Binh Xuyên) et tente de réinstaller 850 000 réfugiés qui ont fui le régime de Hô Chi Minh.
Mais le nouveau régime rencontre de nombreuses difficultés, tant sur le plan économique que sur le plan politique, où se manifestent plusieurs oppositions : celle des nationalistes non communistes, hostiles soit à l'influence des États-Unis, soit au catholicisme et à l'autoritarisme de Ngô Dinh Diêm (coups d'État nationaliste et militaire des 11 novembre 1960 et 27 février 1962) ; celle des bouddhistes, qui prend un caractère de grande violence en 1963 ; celle, enfin, des communistes (Viêt-cong) et de leurs alliés, regroupés au sein du Front national de libération (FNL), qui anime une guérilla particulièrement active dans le delta du Mékong et la péninsule de Ca Mau.
Le 1er novembre 1963, un coup d'État militaire aboutit à la chute et à l'assassinat de Ngô Dinh Diêm. Dès lors, le pays est la proie d'une grave anarchie politique, et de très nombreux gouvernements se succèdent jusqu'en 1965, dominés surtout par les militaires. La période est également marquée par les luttes d'influence entre bouddhistes et catholiques.
Nguyên Van Thiêu
En juin 1965, un Conseil directeur national est formé sous la présidence du général Nguyên Van Thiêu, qui fait fonction de chef de l'État, le général Nguyên Cao Ky étant chef du gouvernement. La nouvelle équipe dirigeante rompt les relations diplomatiques avec la France, tente, sans succès, d'accroître la participation de l'armée sud-vietnamienne aux combats et essaie de lutter contre la corruption. Elle se heurte aux bouddhistes (avril-juin 1966), met en place des institutions parlementaires : élection d'une Assemblée constituante (septembre 1966), promulgation d'une Constitution (1er avril 1967). Nguyên Van Thiêu et Nguyên Cao Ky sont élus (3 septembre 1967) président et vice-président de la République. L'ouverture des pourparlers de Paris (mai 1968) contribue à la chute du chef du gouvernement, Nguyên Van Lôc, qui est remplacé par Trân Van Huong, et à la mise à l'écart de Ky. L'instabilité politique et la désagrégation économique et sociale ont amené la prise en charge progressive du pays par les Américains qui soutiennent ouvertement le général Thiêu.
Richard Nixon, fin de la guerre du Viêt NamRichard Nixon, fin de la guerre du Viêt Nam
De 1968 à 1971, le général Thiêu consolide progressivement son régime ; en 1969, il confie le gouvernement à son allié, le général Trân Thiên Khiêm. Dans le domaine social, en réponse à la politique de redistribution des terres du Gouvernement révolutionnaire provisoire (GRP) [formé en 1969], le gouvernement sud-vietnamien lance, en 1970, un programme de réforme agraire visant avant tout à s'assurer le ralliement de la masse paysanne. Thiêu s'est imposé au président Richard Nixon comme l'élément de stabilité indispensable pour mener à bien sa politique de vietnamisation. C'est donc fort de l'appui de Washington que, candidat unique, il est réélu, en septembre 1971, avec 94 % des suffrages exprimés.
Mais l'offensive générale de 1972 consacre l'échec de la politique de vietnamisation. Thiêu est contraint d'assouplir sa politique dans la négociation. Il accepte donc la teneur des accords de Paris mais il en bloque par la suite l'application. Le conseil tripartite de réconciliation et de concorde chargé, sur les bases de l'article 11 des accords de Paris, d'organiser les élections nationales ne voit pas le jour. Le régime Thiêu poursuit une sévère répression contre la « troisième force », considérée comme capable de réaliser l'unité, et dont le GRP ne cesse de rappeler l'existence.
En fait la guerre, qui n'a pratiquement jamais cessé, reprend en mars 1975. Les forces saigonaises n'offrent guère de résistance et, très rapidement, la totalité des Ire et IIe régions militaires passe sous le contrôle du GRP.
Le 21 avril 1975, Nguyên Van Thiêu, acculé par l'avance foudroyante des troupes du GRP et des unités nord-vietnamiennes, démissionne et quitte Saigon. Le 30 avril 1975, les troupes du GRP entrent dans Saigon.
Pour en savoir plus, voir l'article guerre du Viêt Nam.
11. La difficile réunification
Dans les premières semaines de son installation, le nouveau pouvoir révolutionnaire apparaît ouvert aux espoirs d'une population exsangue et profondément meurtrie : faisant appel à l'union nationale, il s'efforce de multiplier les mesures d'apaisement. Sur le plan diplomatique, le GRP négocie sa reconnaissance auprès de Paris, et il semble que les autorités aient envisagé, tout au moins dans une première étape, de ne pas précipiter ni d'imposer la réunification politique du pays. C'est ainsi que le Sud Viêt Nam demande officiellement son admission à l'ONU (15 juillet) sous l'image apparente d'un pays non-aligné. Cette initiative se heurte à un veto américain (août), Washington s'opposant à l'entrée du Sud Viêt Nam au sein de l'ONU si la Corée du Sud ne peut y siéger également.
Cependant une révolution culturelle s'instaure rapidement au Sud Viêt Nam, balayant l'héritage néocolonialiste : une littérature d'inspiration marxiste, de nouveaux manuels scolaires, font leur apparition « pour répondre à l'appel des lecteurs sud-vietnamiens », car « à temps nouveaux livres nouveaux ». La fonction publique est graduellement purgée et des milliers de fonctionnaires civils et militaires doivent rejoindre des camps de rééducation. Des incertitudes pèsent par ailleurs sur plusieurs centaines de milliers de Chinois et de Sino-Vietnamiens qui font l'objet de mesures coercitives de rejet ou d'assimilation. Le nombre des boat people, s'accroît sans cesse.
Il est vrai que la situation sociale et économique dont héritent les communistes est catastrophique : il y a 3 millions de chômeurs, 1 million de soldats démobilisés qu'il faut nourrir, 5 millions de personnes déplacées à charge de leur famille (infirmes, orphelins, déclassés, réfugiés).
Le problème majeur qui se pose aux autorités est celui du redémarrage de l'économie et de l'ajustement de deux systèmes antagonistes : planification socialiste du Nord, longue inféodation au néocapitalisme au Sud. En outre, l'économie est marquée par un état de délabrement dû à la concussion, au marché noir chronique et aux expédients de toutes sortes. Le IIe plan quinquennal (1976-1980), correspondant à la planification de l'Europe de l'Est, s'avère difficilement réalisable.
En janvier 1976, le pouvoir militaire laisse la place à une administration civile. En mars, un nouveau système judiciaire est mis en place : le Code pénal met désormais fin aux juridictions d'exception en vigueur depuis mai 1975. Le 25 avril, la première Assemblée nationale d'un Viêt Nam réunifié est élue : ses 492 députés (249 pour le Nord, 243 pour le Sud) sont élus par environ 25 millions d'électeurs.
Au Sud, les listes du GRP obtiennent les suffrages les plus importants. La nouvelle Assemblée, qui siège à Hanoi, la capitale, marque la première étape de la réunification de jure du pays, de l'adoption d'une Constitution et de l'instauration de la dictature du prolétariat. Le 2 juillet, le Viêt Nam est officiellement réunifié et Hanoi proclame l'installation de la République socialiste sous la présidence suprême de Tôn Duc Thang, ancien président de la République démocratique (Nord Viêt Nam). Pham Van Dông est chef du gouvernement ; Nguyên Luong Bang et Nguyên Huu Tho vice-présidents ; Truong Chinh, président du Comité permanent de l'Assemblée ; et six « sudistes » sont au gouvernement.
Les lacunes de l'économie sont rapidement mises en lumière, et Lê Thanh Nghi, ministre du Plan, annonce en janvier 1977 la nécessité de procéder à d'importants transferts de population permettant de restructurer le travail : c'est ainsi que 1,2 million de Saigonais devront quitter la métropole pour s'installer dans les « nouvelles zones économiques » et que quelque 900 000 Vietnamiens du Nord devront trouver un emploi dans le Centre ou le Sud.
Des contrats de coopération ou d'aide sont signés avec divers pays occidentaux, notamment avec la France (visite de Pham Van Dông en avril 1977). Pourtant (fin 1977), Hanoi admet que la situation économique est au seuil de la catastrophe. Des calamités naturelles ont affecté 30 % des cultures au Nord (300 000 ha), tandis qu'au Sud 25 % des terres n'ont pas été mises en culture faute de moyens techniques et humains
12. Le conflit khméro-vietnamien
C'est dans ces conditions que se développe une tension diplomatique entre Hanoi et le Cambodge voisin (Kampuchéa démocratique), dirigé par les Khmers rouges depuis 1975. Accusant le Viêt Nam de vouloir contrôler le mouvement communiste au Cambodge, les partisans de Pol Pot ont trouvé à Pékin un appui, d'autant que la capitale chinoise accepte l'idée cambodgienne d'une rectification de frontières qui rendrait à Phnom Penh des provinces perdues du bas Mékong. Le Viêt Nam signe un traité d'amitié et de coopération avec Moscou (3 novembre 1978) et les incidents frontaliers se multiplient entre le Viêt Nam et le Cambodge.
Le 25 décembre 1978, le Viêt Nam entreprend une offensive d'envergure contre son voisin, après avoir annoncé la formation d'un Front uni de salut national du Kampuchéa (FUNSK). Les troupes de Pol Pot reculent un peu partout, tandis qu'un comité révolutionnaire populaire s'installe à Phnom Penh (janvier 1979). Mais les divisions vietnamiennes engagées au Cambodge se heurtent à des opérations de guérilla, qui obligent l'état-major de Hanoi à occuper massivement le pays. Progressivement repoussés, les partisans de Pol Pot se replient sur des zones jouxtant la frontière thaïlandaise. Toutefois, le nouveau gouvernement cambodgien n'est reconnu que par une poignée de pays socialistes alliés de Hanoi ; il n'en reste pas moins que la défaite des Khmers rouges est un incontestable succès pour le Viêt Nam, qui, soit par les armes, soit par la diplomatie, s'est assuré le soutien ferme de ses voisins cambodgiens et laotiens.
13. Le conflit sino-vietnamien et les priorités économiques
La Chine considère les pays d'Asie du Sud-Est comme un glacis sur son flanc sud et comme sa zone d'influence. Elle ne peut donc accepter l'« impérialisme régional » du Viêt Nam d'autant plus qu'il ouvre la porte à l'URSS (facilités portuaires à la flotte soviétique). En effet, privé de l'aide chinoise, Hanoi a adhéré au Comecon (juin 1978) et signé avec Moscou un traité d'amitié et de coopération (novembre 1978). Les rapports entre la Chine et le Viêt Nam ne cessent de se détériorer.
Au lendemain de l'invasion vietnamienne au Cambodge, le 17 février 1979, la Chine lance une attaque sur la frontière nord du Viêt Nam pour lui « donner une leçon », mais, après de durs combats, elle doit se retirer le 6 mars et négocier. Le conflit va tourner à l'épreuve d'usure, Pékin armant les Khmers rouges. Les conditions de vie deviennent alors si difficiles, notamment pour la minorité chinoise, que quelque 400 000 personnes quitteront le pays par mer ou par terre vers la Chine. La conférence de Genève (juillet 1979) décide une aide des pays occidentaux pour les réfugiés.
La situation en Indochine étant « stabilisée », Hanoi – isolé par l'embargo occidental mais aidé par l'URSS –, remédie aux mauvais résultats du plan quinquennal (1976-1980) et surtout à une grave pénurie alimentaire en adoptant en 1979, contre l'avis des conservateurs, une libéralisation du marché de la production agricole et artisanale qui donne des résultats positifs. Une nouvelle Constitution est adoptée en décembre 1980 après quatre ans de débats, qui souligne le rôle principal du marxisme-léninisme. En mars 1982, le Ve Congrès du PCV approuve la nouvelle ligne économique dont les effets bénéfiques sont momentanément compromis par une réforme monétaire hâtive (septembre 1985), suivie d'une forte inflation.
14. Sur la voie du « renouveau » (doi moi)
En juillet 1986, Lê Duân meurt, et Truong Chinh, déjà président du Conseil d'État, lui succède à la tête du parti. Mais, au VIe Congrès du PCV (décembre 1986), ce dernier se retire du bureau politique ainsi que Pham Van Dông (Premier ministre) et Lê Duc Tho, ouvrant alors la voie au renouvellement de la direction. Nguyên Van Linh, dont le programme de réformes dénommé (doi moi) (littéralement « nouveau changement » est approuvé, prend la tête du parti. Calqué sur le modèle chinois, le doi moi combine maintien du parti unique, fermeté du contrôle politique et libéralisation économique : autonomie des entreprises, économie de marché, encouragement au secteur privé et appel aux capitaux étrangers. En juillet 1987, Vo Chi Cong devient président du Conseil d'État, et Pham Hung, Premier ministre. Tous deux sont des vétérans du Sud, comme Vô Van Kiet, le réformateur chargé du plan.
En juin 1988, après la mort de Pham Hung, le conservateur Do Muoi est nommé Premier ministre, Lê Duc Tho conservant lui aussi de l'influence jusqu'à sa mort, en 1990. L'effondrement du socialisme en Europe de l'Est effraie les dirigeants vietnamiens. En mars 1990, le Comité central se prononce contre la « libéralisation bourgeoise » et le multipartisme, mais pour la poursuite des réformes économiques, voie réaffirmée au VIIe Congrès du parti (juin 1991), où Do Muoi devient secrétaire général. La nécessité d'une modernisation politique est cependant reconnue. Vô Van Kiet devient Premier ministre (août 1991). La résistance des adversaires du changement se marque par l'accession du général Lê Duc Anh à la présidence, après l'adoption d'une nouvelle Constitution en 1992. Le régime reste sévère à l'égard des dissidents politiques, garde le contrôle des secteurs clés de l'économie et s'inquiète de la pauvreté persistante, de l'augmentation de la corruption, de la prostitution, de la drogue et du crime.
Le VIIIe Congrès du parti (juin 1996) – sur fond de lutte d'influence entre conservateurs et réformistes – maintient la même équipe au pouvoir. Le bureau politique s'élargit au bénéfice de l'armée. Les élections de juillet 1997 enregistrent la victoire du parti unique, mais en septembre la nouvelle équipe dirigeante s'ouvre à des « experts » : le président Trân Duc Luong est géologue, et le Premier ministre Phan Van Khai, économiste. L'ouverture économique doit se poursuivre dans l'ordre pourtant, en novembre, des révoltes au Nord et au Sud traduisent le mécontentement populaire contre la corruption des cadres locaux. Une lettre du général Tran Do, vétéran respecté, appelle à la démocratie et à la transparence – ce qui lui vaudra d'être exclu du parti.
15. Le Viêt Nam du xxie siècle
Au IXe Congrès du PCV (avril 2001), le général Lê Kha Phieu, devenu secrétaire général en 1997, est désavoué au terme d'un long débat interne opposant réformistes et conservateurs. Il est remplacé par un modéré, Nong Duc Manh, qui, fait inédit, vient d'un groupe ethnique minoritaire (thai). Le Comité central est rajeuni ; le Sud, pôle du développement économique, mieux représenté. Bien que la crise asiatique de 1997 ait plutôt épargné le Viêt Nam, la croissance et les investissements étrangers ralentissent, car les réformes structurelles (administration, secteur bancaire et entreprises publiques) se heurtent à de nombreux obstacles et marquent le pas. La montée d'un capitalisme « sauvage » dans une bureaucratie d'État suscite conflits d'intérêts, escroqueries et scandales. Le régime maintient sa volonté de modernisation, se prononce pour une « économie de marché à orientation socialiste » (ouverture d'une Bourse à Hô Chi Minh-Ville en 2001 et à Hanoi en 2005) tout en s'efforçant de se protéger.
Bousculé par les mutations sociales devenues plus âpres au fur et à mesure que la croissance économique se confirme, le pays est également confronté à des épidémies de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003 et de grippe aviaire à partir de 2004. S'il parvient à les traiter avec une relative transparence, il se voit reprocher, en revanche, de sérieux manquements en matière de respect des droits de l'homme et de la liberté de religion (les manifestations des « montagnards » des hauts plateaux du Sud, marginalisés par le développement des plantations de café, sont violemment réprimées).
À l'issue du Xe Congrès du PCV (avril 2006), seul le numéro un du pouvoir, Nông Duc Manh, secrétaire général du parti, est reconduit pour un second et dernier mandat ; en revanche, l'ensemble de l'exécutif – le président Trân Duc Luong, le Premier ministre Phan Van Khai et le président de l'Assemblée nationale Nguyên Van An – est soumis à renouvellement.
Leurs successeurs – Nguyên Minh Triet et Nguyên Tan Dung –, réputés réformateurs, maintiennent cependant un niveau élevé de répression à l'encontre des dissidents et ne tolèrent qu'une timide libéralisation du processus politique : à l'issue des élections législatives de mai 2007, seuls 43 sièges (sur 500) reviennent à des non-membres du PCV.
Les nouveaux dirigeants se trouvent confrontés à plusieurs défis urgents à résoudre. Touché par la crise économique et financière de 2007-2008, le Viêtnam voit sa croissance sérieusement ébranlée, ses exportations vers les marchés américain et européen brutalement chuter, sa monnaie se déprécier. Conséquence de l'accélération de l'inflation (23 % en 2008), la baisse du pouvoir d'achat provoque des mouvements de grèves au sein d'une population impatiente d'un changement mais peu confiante dans ses dirigeants.
Ceux-ci réagissent en lançant un plan de relance en 2009, qui permet une reprise progressive de la croissance, mais la crise a montré la dépendance forte du pays envers l'étranger (ses exportations représentent plus de 70 % de son PIB) et révélé les hésitations au sein du PCV. Unis sur la poursuite des objectifs de la politique sociale et économique – renouer avec la croissance, garder la maîtrise politique du développement, réduire les inégalités, développer la protection sociale, les membres du parti se divisent sur l'ordre de priorité de leur mise en œuvre. Lors de son XIe Congrès (janvier 2011), le PCV désigne à sa tête un idéologue conservateur, Nguyên Phu Trong, et confirme la montée en puissance du Premier ministre, Nguyên Tan Dung, réélu au sein du comité central puis au poste de chef du gouvernement tandis que Truong Tân Sang accède à la présidence de la République.
16. La politique étrangère depuis 1989
Le retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge conditionne la fin de l'isolement du Viêt Nam et, donc, son accès à l'aide occidentale. Sa sécurité dépend toutefois de la solidité du régime de Phnom Penh. Malgré la menace que représentent les Khmers rouges, aidés jusqu'en 1991 par la Chine et la Thaïlande, celui-ci se renforce. Hanoi, soumis aux pressions de l'URSS qui souhaite améliorer ses relations avec Pékin, avance son retrait du Cambodge à septembre 1989. Il faudra attendre la signature de l'accord de paix sur le Cambodge (octobre 1991) pour voir se réaliser la normalisation des relations sino-vietnamiennes et l'amorce d'une levée partielle de l'embargo américain.
L'effondrement du socialisme en Europe de l'Est pousse le Viêt Nam à se rapprocher de la Chine (sommet de Pékin en novembre 1991). Mais les conflits territoriaux (frontières et concessions pétrolières en mer de Chine méridionale) demeurent une pomme de discorde. Les visites du Premier ministre Li Peng, puis du président chinois Jiang Zemin à Hanoi (1992 et 1994) permettent des négociations malgré des tensions parfois vives. En décembre 1999, le Viêt Nam et la Chine signent un traité délimitant leur frontière terrestre, puis, un an plus tard, un accord sur la délimitation de leur frontière maritime dans le golfe du Tonkin, accompagné d'un accord de coopération sur la pêche. Malgré le contentieux qui les oppose concernant les îles Paracel et les îles Spratly en mer de Chine méridionale, les relations entre les deux pays sont étroites (la Chine étant son premier fournisseur et quatrième client) et les échanges diplomatiques, soutenus (visite du président chinois Jiang Zemin en 2002, accord de coopération de défense en avril 2005).
L'implosion de l'Union soviétique contraint le Viêt Nam à réajuster sa politique étrangère, bien qu'il se soit efforcé de développer de bonnes relations avec les États issus de l'ex-URSS. En mars 2001, Vladimir Poutine se rend à Hanoi. Le 4 mai 2002, la Russie quitte la base de Cam Ranh. Décidé à être « l'ami de tout le monde », le Viêt Nam refuse désormais d'avoir sur son sol une base étrangère (livre blanc de la Défense de décembre 2004). La visite du président vietnamien à Moscou en juillet 2012 est l’occasion de rappeler le caractère stratégique des relations avec la Russie, notamment dans le secteur énergétique (pétrole, gaz et nucléaire).
Après 1991, le Viêt Nam se rapproche des pays de l'ASEAN. Commerce et investissements connaissent alors un développement rapide. En juillet 1992, il signe le traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN, et, après avoir eu le statut d'observateur, devient le septième membre de l'Association en juillet 1995. Des négociations sont ouvertes sur les limites des eaux territoriales. L'AFTA (ASEAN Free Trade Area) entrant en vigueur le 1er janvier 2002, le Viêt Nam obtient un report d'échéance jusqu'en 2006. Il devient membre de l'APEC en 1998. Après 1991, de bonnes relations économiques se sont aussi développées avec la Corée du Sud. Avec le Japon, premier donneur d'aide, longtemps premier partenaire commercial et troisième investisseur, les relations se resserrent (visite du Premier ministre Junichiro Koizumi en avril 2002, visite du Premier ministre Phan Van Khai en avril 2003, accord sur les investissements en novembre 2003).
Bill Clinton et Trân Duc Luong, Hanoi, 2000Bill Clinton et Trân Duc Luong, Hanoi, 2000
Les relations avec les États-Unis demeurent longtemps bloquées par la question des soldats américains disparus au combat ; le Viêt Nam s'efforce de faciliter les recherches. En juillet 1993, Washington autorise le FMI, la Banque mondiale et l'ADB (Asian Development Bank) à consentir des prêts au Viêt Nam, mais l'embargo américain n'est levé qu'en février 1994 et les relations diplomatiques ne sont rétablies qu'en juillet 1995. Après quatre ans d'intenses négociations, les deux pays signent en juillet 2000 un accord de normalisation des relations économiques, à la satisfaction d'Hanoi qui voit s'ouvrir le chemin de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) En novembre, Bill Clinton est le premier président américain à se rendre au Viêt Nam. Devenus le deuxième client du Viêt Nam après le Japon en 2002, les États-Unis sont leur premier client en 2005.
Des tensions subsistent : Hanoi est opposé à l'intervention américaine en Iraq et, en mars 2005, une Cour américaine déclare irrecevable la plainte des victimes vietnamiennes de l'« agent orange », défoliant contenant d'importantes quantités de dioxine utilisé massivement par l'armée américaine pendant la guerre du Viêt Nam.
L'entrée du Viêt Nam dans l'OMC – acquise le 7 novembre 2006 et officialisée le 1er janvier 2007 – symbolise sur le plan économique le succès de la politique vietnamienne et son insertion dans la région comme dans le monde. À peine admis dans l'OMC, le Viêt Nam réunit à Hanoi, pour la première fois, le sommet annuel de l'APEC et reçoit, à cette occasion, en novembre 2006, le président George Walker Bush. Le président Triet lui rend visite moins d'un an plus tard, en juin 2007.
Plusieurs rencontres internationales à haut niveau entre 2002 et 2012, impliquant notamment la France, la République tchèque ou la Pologne, témoignent de la volonté d'ouverture du Viêt Nam en Europe alors que l’Union européenne est son deuxième client derrière les États-Unis et devant le Japon, avec lequel les liens sont également resserrés en 2012. |
| |
|
| |
|
 |
|
L'INDE |
|
|
| |
|
| |
Inde : histoire
La civilisation de l'Indus
1. Préhistoire et protohistoire
Le sous-continent indien dans son ensemble, donc l'Inde actuelle, le Pakistan et le Bangladesh, est extrêmement riche en gisements préhistoriques. Malheureusement, faute encore de pouvoir rattacher à un cadre chronologique suffisamment précis les trouvailles faites sur de très nombreux sites disséminés sur la presque totalité de cet immense territoire, on se contente jusqu'à présent de classer les outils de pierre, seuls vestiges d'une activité protohumaine, puis humaine, en trois grands groupes correspondant à trois périodes successives du paléolithique, qui doivent coïncider, en termes d'évolution humaine, avec le passage de l'archanthropien au néanthropien, c'est-à-dire à l'homme actuel, dont on situe l'apparition entre −35000 et −15000 environ. Les industries microlithiques sont donc entièrement son œuvre puisqu'en Inde celles-ci ne paraissent pas antérieures à l'holocène, soit à −10000 environ.
Il est actuellement impossible de dire avec certitude si les premiers hominiens ont pénétré dans le sous-continent par le Nord-Ouest, comme on l'imagine parfois, ou si cette évolution s'est faite dans l'Inde même, ou encore si la péninsule a été colonisée dès ces temps reculés par des populations venues d'outre-mer.
1. 1. La civilisation de l'Indus
La civilisation de l'IndusLa civilisation de l'Indus
La « révolution néolithique », définie par l'apparition d'une économie de production, dont on situe les débuts, dans l'Ancien Monde, dans le Croissant fertile au Proche-Orient, entre les IXe et VIIe millénaires avant J.-C., apparaît, depuis la découverte de sites tels que celui de Mehragarh au Pakistan, pratiquement aussi ancienne dans le sous-continent indien. Il est vraisemblable que la présence dès cette époque de villages dans cette partie du Baloutchistan qui domine le bassin de l'Indus explique en partie que la première civilisation indienne, celle dite « de l'Indus » (ou « de Harappa », ou encore « harappéenne »), soit née dans cette région du sous-continent, alors que partout ailleurs dans le reste de l'Inde les populations en sont encore à un stade de civilisation bien moins avancé.
Avec la civilisation de l'Indus, qui dut commencer à se développer au IVe millénaire avant notre ère, commencent l'âge du bronze et, en fait, la protohistoire de l'Inde puisque cette civilisation, à son apogée, entre environ 2500 et 1750 avant J.-C., connaît l'écriture. Mais l'écriture harappéenne non plus que la langue qu'elle note ne sont encore déchiffrées. Ainsi, cette civilisation, par ailleurs assez bien connue sous ses aspects matériels, constitue une énigme.
1.2. La question aryenne
Le millénaire qui suit la disparition de la phase brillante de la civilisation de l'Indus et qui se prolonge jusqu'aux débuts de l'histoire proprement dite (traditionnellement le vie s. avant J.-C., à l'époque du Bouddha) est, lui aussi, énigmatique. Il est en effet presque tout entier concerné par la fameuse question « aryenne », qui, très succinctement, se pose de la façon suivante. D'une part, le corpus littéraire indien le plus ancien : le Rigveda, puis les recueils suivants, ensemble composé en sanskrit védique, langue indo-européenne, sont supposés avoir été élaborés à partir de la seconde moitié du Ier millénaire avant notre ère dans l'Inde du Nord-Ouest.
D'autre part, les archéologues n'ont, pour cette période et dans ces régions, jusqu'à présent, guère trouvé de traces nettes de migrations de populations. On ne retrouve dans le Pendjab, pakistanais aussi bien qu'indien, que des vestiges de cultures harappéennes tardives auxquels font suite, mais après une période d'abandon qui peut avoir duré plusieurs siècles, des vestiges d'une culture qui paraît nouvelle, caractérisée par d'autres types de céramique (en particulier par une poterie grise peinte), et qui, surtout, se développe dans le Doab (l'interfluve entre le Gange et la Yamuna) et dans la haute vallée du Gange.
À cette culture qui doit commencer vers le début du Ier millénaire avant J.-C. fait suite, cette fois sans interruption, une autre culture définie par une forme évoluée de la poterie grise et centrée sur la moyenne vallée du Gange. Cette dernière culture appartient déjà à l'histoire puisqu'elle se prolonge dans la seconde moitié de ce Ier millénaire avant notre ère. À moins de nouvelles découvertes, la pénétration aryenne en Inde n'est donc encore imaginable qu'en termes de langue et de civilisation, les tribus véhiculant langue et idéologie indo-européennes ayant été d'ailleurs, on le sait, nomades et, pour cette raison, n'ayant peut-être pas laissé de traces durables de leurs mouvements.
Il faut enfin ajouter que cette question de la pénétration indo-européenne en Inde devrait être réexaminée si l'une des grandes hypothèses sur la nature de la langue harappéenne se révélait exacte, c'est-à-dire s'il s'agissait déjà d'une langue indo-européenne.
2. La formation de l'Inde ancienne
2.1. Les sources
Les limites chronologiques que l'on assigne habituellement à l'histoire de l'Inde ancienne sont l'époque du Bouddha d'une part, et l'instauration du premier pouvoir musulman à Delhi, en 1206 après J.-C., d'autre part. Les raisons de ce choix sont, avant tout, qu'à chaque fois, avec l'apparition d'une nouvelle religion, un changement se produit dans les sources littéraires qui servent à écrire l'histoire de ce pays (et non un changement radical, politique ou social : pour importants qu'aient été en Inde le bouddhisme et l'islam, l'Inde a toujours été et est toujours majoritairement hindoue).
L'historicité des sources est ici seule en cause. Celle des sources bouddhiques est donc plus nette que celle de la littérature védique (Veda), dont l'élaboration, d'ailleurs, paraît s'achever au milieu du Ier millénaire avant notre ère. D'autre part, près de 2000 ans plus tard, l'histoire en tant que discipline intellectuelle est introduite en Inde par l'islam.
On touche ici à l'un des plus graves problèmes auxquels se heurtent les historiens de l'Inde ancienne. Les sources littéraires, qui restent les sources principales, qu'elles soient bouddhiques, jaïna ou brahmaniques – ces dernières étant de loin les plus considérables –, sont des œuvres religieuses (au sens large) ou purement littéraires. Cela explique que l'histoire proprement dite de l'Inde ancienne, en des temps où fleurit l'une des plus grandes civilisations du monde, soit si schématique en face d'une histoire des idéologies beaucoup plus consistante, sans qu'on ait guère pu, jusqu'à présent, intégrer l'une à l'autre. En d'autres termes, une chronologie, élaborée difficilement pour les temps les plus anciens, puis plus facilement lorsque apparaissent monnaies et surtout inscriptions, ne fournit que des listes de rois dont les activités principales sont l'attaque et la défense, cependant que l'histoire sociale se réduit pratiquement à l'image, figée et certainement passablement idéalisée, que les brahmanes donnent d'une société où ils réclament la première place.
Il est une évolution, toutefois, qui semble s'esquisser dès la fin de l'époque des Gupta (550 après J.-C. environ) et qui conduit, dans les siècles qui suivent, à ce que l'on appelle, assez improprement, le Moyen Âge indien : celui-ci commence à partir du moment où l'on a la preuve qu'aux donations royales de terres, qui, jusque-là, n'étaient que des donations pieuses faites à des brahmanes, à des communautés religieuses diverses ou à des temples, s'ajoutent des donations à des officiers du roi en rétribution de leurs services. Et, peu à peu, lorsque ces donations entraînent, en contrepartie, l'obligation d'entretenir des troupes pour les mettre au service du souverain, lorsque, surtout, d'abord limitées dans le temps, elles deviennent héréditaires, une sorte de noblesse féodale se constitue.
L'histoire de bien des royaumes indiens médiévaux est ainsi celle de dynasties qui ont su profiter de ces attributions de terres pour devenir indépendantes jusqu'à ce qu'à leur tour d'autres profitent de leur faiblesse. Telle est sans doute la raison de l'étonnante « plasticité » de nombre de dynasties qui, tantôt suzeraines, tantôt vassales, durèrent des siècles.
2.2. Les premiers royaumes
L'empire d'Ashoka et son démembrementL'empire d'Ashoka et son démembrement
À l'époque du Bouddha (vers 560-480 avant J.-C.), qui est celle aussi de Mahivara, le fondateur du jaïnisme, subsistent encore des sociétés tribales diverses, indigènes ou « aryanisées ». De telles sociétés persisteront d'ailleurs longtemps : il en existe même aujourd'hui et certaines avaient conservé, il y a moins d'un siècle, des modes de vie qui devaient être ceux du néolithique.
Ainsi, le Bouddha appartenait-il à une famille dirigeante de la tribu ou du clan des Shakya (d'où son nom de Shakyamuni, « Sage des Shakya »). Mais déjà des royaumes sont nés dans la vallée du Gange. La mise en valeur de cette vallée, qui a commencé après l'introduction de la métallurgie du fer dès la première moitié du Ier millénaire avant notre ère, a permis, vers le milieu de ce millénaire, la construction, le long du fleuve, des premières cités. Les sources bouddhiques mentionnent un certain nombre de ces royaumes, tous situés dans la moitié nord du sous-continent.
Parmi ces royaumes, celui du Magadha (sud du Bihar actuel), dont l’essor est probablement dû à ses très riches gisements de cuivre et de fer, tient un rôle central. Ses premiers rois connus sont Bimbisara, contemporain du Bouddha, et son fils Ajatashatru. Leur descendant Udayin transfère la capitale de Rajagrha à Pataliputra (Patna) sur le Gange. Vers 413 avant J.-C., la dynastie Nanda leur succède et Pataliputra deviendra, environ deux siècles plus tard, le centre du premier Empire indien sous la dynastie maurya.
Dans la moitié Sud, la préhistoire a duré plus longtemps, sans doute jusque vers 1500 avant J.-C., et la première mention de peuples méridionaux ne date que du règne d'Ashoka (vers 269-233 avant J.-C.).
2.3. Les Perses et Alexandre le Grand
Dans la seconde moitié du vie siècle avant J.-C., Cyrus puis Darius Ier annexent à l'Empire perse la Bactriane et une partie du bassin de l'Indus. Si les textes indiens n’ont pas laissé de trace directe de cette domination, celle-ci a notamment introduit l'écriture araméo-indienne (kharosthi) en usage dans le Nord-Ouest de l’Inde pendant plusieurs siècles et par l’intermédiaire de l'empire achéménide, les premiers échanges commerciaux et intellectuels avec le monde méditerranéen (et grec) eurent ainsi lieu avant l’expédition d’Alexandre le Grand.
Entre 327 et 325 avant J.-C., Alexandre est aux confins de l'Inde du Nord-Ouest. Il franchit l'Indus, mais ne dépasse pas l'Hyphase (la moderne Bias, l'un des cinq grands fleuves du Pendjab). Aucune mention n'a été retrouvée de cette expédition dans les sources indiennes, mais les sources classiques permettent d'entrevoir que sa venue a précédé de très peu, si elle ne l'a pas favorisée, la prise du pouvoir par Chandragupta, le premier des Maurya, vers 320 avant J.-C.
Le souverain le plus célèbre de toute l'histoire de l'Inde ancienne est le fils de Chandragupta, connu sous le nom de Ashoka (v. 269-v. 233). Il fur le premier à faire graver, sur des colonnes et sur des rochers, à la manière des Achéménides de la Perse, des édits, uniques en leur genre dans l'histoire de l'Inde et qui sont les premières inscriptions indiennes. Ces édits renseignent sur l'étendue de son empire et sur sa politique, dite du dhamma (sanskrit dharma), qui est une exhortation à se conformer à l'« ordre » au sens le plus large, l'ordre cosmique, dont les formes concrètes sont l'ordre religieux et l'ordre politique, celui-ci se devant d'être le garant de celui-là. Cette notion, centrale dans le brahmanisme comme dans le bouddhisme, fonde en partie la politique de tolérance de cet empereur, lui-même bouddhiste.
Mais la cohésion de l'empire ne survit que peu de temps à Ashoka. L'histoire de son déclin est obscure, comme celle des pouvoirs des Shunga 'ou Sunga) et des Kanva qui succèdent aux Maurya à la tête d'un royaume certainement de plus en plus petit (sans que l'on sache le situer avec précision) jusque vers le milieu du ier s. avant J.-C. Ashoka est le seul souverain de l'Inde ancienne qui soit aussi concrètement connu.
3. L'Inde « classique » et médiévale
Après une période assez obscure marquée par des invasions de Scythes puis de Kouchans, autres nomades issus du Turkestan – qui donnent naissance à l’empire de Kanishka, à cheval sur l’Inde et l’Iran, et de ses successeurs –, on voit apparaître, vers la fin du iiie siècle après J.-C., la brillante dynastie des Gupta, que l’on connaît toutefois aussi très mal faute de documents précis.
3.1. L'empire Gupta (v. 320-v. 550)
C’est également la moyenne vallée du Gange qui constitue le cœur du nouvel empire constitué au ive siècle par la dynastie Gupta, fondée par Chandragupta Ier (v. 320-330). Son fils Samudragupta est le vrai fondateur de l’empire, qui s’étendit sous le règne de Chandragupta II (v.375-v. 414) pour comprendre à son apogée l’ensemble de l'Inde au nord de la Narmada. C’est à cette époque dite « classique », que l’hindouisme, encouragé par les souverains de cette lignée, prend tout son essor parallèlement au bouddhisme et au jaïnisme également florissants.
Au milieu du ve siècle, Skandagupta parvient à repousser les Huns hephtalites qui s’imposent cependant jusqu’au milieu du vie siècle et ont raison de l'Empire gupta, qui s'émiette alors en principautés locales. Parmi ces dernières, celle fondée par Harsha (Harsavardhana) — connue grâce à l'un des très rares romans écrits en sanskrit, la Geste de Harsha du poète Bana et par les Mémoires du pèlerin chinois Xuanzang – restaure l’unité de l’Inde du Nord de 606 à 647 à partir de Kanyakubja (Kanauj, dans le Doab). Mais à la mort du souverain, l’Inde du Nord se morcelle de nouveau pendant six siècles.
3.2. L'essor de l'Inde dravidienne
Dans le nord du Deccan, sur les ruines de l’empire maurya, les Andhra avaient déjà constitué un nouveau centre de pouvoir régional à partir de ce qui deviendra l’actuel Andhra Pradesh, qui devait se maintenir jusqu’au iiie siècle, favorisant la pénétration du brahmanisme vers le sud.
À la fin des Gupta, se détachent quatre grands royaumes : dans le Deccan occidental celui des Chalukya au vie siècle, auxquels succèdent les Rashtrakuta aux viiie-xe siècles, et, plus au sud, ceux des Pallava et des Chola qui marquent l’âge d’or de la civilisation tamoule.
Mal connue à ses débuts, c’est à partir du vie siècle que la dynastie des Pallava (d’anciens vassaux des Andhra) étend son influence de la côte sud-orientale autour de Kanchipuram vers le sud de la péninsule. Sous leur règne, un commerce prospère avec l’Asie du Sud-Est commence à se développer. En guerre, dans le nord contre les Chalukya puis contre leurs successeurs, les Rashtrakuta, mais devant aussi affronter au sud les Pandya, les Pallava cèdent finalement devant les Chola, d’anciens vassaux héritiers d’une principauté fondée au iiie siècle.
Ces derniers, à partir de leur capitale Tanjore, s’imposent dans l’ensemble de la péninsule méridionale de la fin du ixe siècle jusqu’au milieu du xiiie siècle, prenant le contrôle de toute la côte orientale après des incursions jusqu’au Bengale et l’Orissa dans le Nord-est, de l’île de Ceylan — qui passe sous la domination des Tamouls au xie siècle pendant quelques décennies – et menant des expéditions maritimes jusqu’en Malaisie et dans le nord de Sumatra. Le règne de Rajendra Ier (1012-1044) en constitue l’apogée. À partir de la fin du xiie siècle, leur puissance s’atténue et les Pandya s’imposent comme la première principauté d’une Inde du Sud de nouveau morcelée.
4. Les premiers pouvoirs musulmans (1206-1526)
Le sultanat de DelhiLe sultanat de Delhi
La première région indienne conquise par une armée musulmane est celle du Sind, en 712. Elle est l'œuvre d'Arabes commandés par Muhammad ibn al-Qasim, neveu et gendre de Hadjdjadj, gouverneur de l'Iraq. Auparavant, des commerçants arabes et iraniens s’étaient déjà établis sur les côtes orientales.
4.1. Le sultanat de Delhi
Mais l'islam ne sera en fait introduit qu'un demi-millénaire plus tard, par des Turcs établis en Afghanistan, lorsque, en 1206, Qutb al-Din Aybak, lieutenant esclave du sultan Muhammad de Ghur, fonda le sultanat de Delhi. Les conquêtes de Muhammad de Ghur (prise de Lahore en 1186, de Delhi en 1193, du Bengale en 1202) seront précédées, entre 1000 et 1027, des raids, mais sans lendemain, du sultan turc Mahmud de Ghazni contre les plus grandes cités de l'Inde du Nord.
Le sultanat de Delhi devient vite la première puissance de l'Inde du Nord et, après s'être étendu au détriment des royaumes hindous, il va donner naissance à des régimes semblables à lui. Il reste cependant largement étranger à la société indienne sur laquelle il est surimposé et dont subsistent les autorités locales. Sans légitimité et règle précise de succession, si ce n’est la force du clan, il se retrouve à la merci des rébellions internes et des changements de dynasties. Sur ses ruines, en 1526, commencera de s'édifier l'Empire moghol (→ Grands Moghols).
Cinq dynasties, toutes turques, au moins d'origine, sauf la dernière, occupent le trône de Delhi de 1206 à 1526 : celle dite des Esclaves (1206-1290), celle des Khaldji (1290-1320), celle des Tughluq (1320-1414), celle des Sayyid (1414-1450), celle enfin des Lodi, qui appartenaient à un clan afghan établi en Inde, de 1451 à 1526. Iltutmich (1211-1236) et Balban (1265-1286) donnent au sultanat des assises solides et Ala al-Din (1296-1315), pour un temps, des dimensions impériales, grâce aux conquêtes de son général, Malik Kafür, aux dépens des derniers grands royaumes hindous du Deccan et du Sud : Yadava de Devagiri (conquis en 1307), Hoysala de Dvarasamudra au Mysore (1310), Kakatiya de Warangal au Telingana (1309), Pandya de Madurai, tout au sud (1311). Comme ses prédécesseurs, Ala al-Din contient les Mongols toujours menaçants au nord-ouest.
4.2. Le sultanat des Bahmanides et l'empire de Vijayanagar
Sous le règne de Muhammad Tughluq (1325-1351), des gouverneurs s’émancipent du pouvoir de Delhi, dans le Sud (sultanat de Madurai, 1334-1378) comme dans le Nord (Bengale en 1339 où le sultanat des Ilyas Chah se maintiendra jusqu’en 1487). Mais ce sont surtout deux grands royaumes qui se distinguent alors. L’un, musulman, est le sultanat bahmanide fondé en 1347 dans le Deccan occidental par Hasan Gangu, avec pour capitale Goulbarga (nord du Karnataka) ; l’autre hindou, est le royaume de Vijayanagar formé en 1336 par Hariha ra Ier au centre du Karnataka (Hampi) qui parvient à s’étendre sur l’ensemble du territoire méridional autrefois contrôlé par les Chola. Si ce nouvel empire, qui trouve son apogée sous le règne de Krishnadeva Raya (1509-1529), se présente comme le foyer d’une renaissance hindoue, il n’est inspiré par aucune volonté de « reconquête » et, tout en se maintenant pendant plus de deux siècles grâce notamment à un système efficace d’administration, il est finalement défait en 1565 par une coalition de sultans successeurs des Bahmanides.
4.3. La fin du sultanat de Delhi
Firuz Tughluq (1351-1388) saura conserver les territoires qui lui restent, mais il sera le dernier grand sultan de Delhi. En 1398, Timur Lang (Tamerlan) vient piller la ville et massacrer ses habitants. Cette invasion accélère la désintégration du sultanat : le Malwa, en 1401, le Gujerat, en 1403, deviennent des sultanats indépendants, les Rajputs du Rajasthan reconstituent leurs principautés au milieu du XVe siècle et le dernier des Lodi, Ibrahim (1517-1526), doit faire face à d'autres rébellions avant de trouver la mort face au premier souverain moghol, Baber, à Panipat.
5. L'arrivée des Européens (1498-1669)
Les Portugais, qui, avec les Espagnols, s'étaient partagé les mers en 1494 (→ traité de Tordesillas), sont les premiers Européens à atteindre l'Inde et à y établir des bases commerciales. Vasco de Gama touche Calicut en 1498 et Pedro Álvarez Cabral y commerce dès 1500. Cette installation, qui est loin d'être pacifique, devient définitive avec la prise de Goa au sultan de Bijapur par Albuquerque (1510).
Tant que durera l'empire de Vijayanagar (jusqu'en 1565), son allié et partenaire, le commerce portugais sera plus que florissant. Les Portugais restent, en tout cas, les maîtres de l'océan Indien pendant presque tout le xvie siècle.
L'échec de l'Invincible Armada (1588), la publication (1595) par les Hollandais (indépendants de la cration des Provinces unies en 1579) des cartes portugaises, jusque-là gardées secrètes, encouragent les puissances protestantes à briser le monopole hispanique sur le commerce des épices. Les Compagnies des Indes orientales anglaise (East India Company) et hollandaise (Vereenigde Oost-Indische Compagnie ou VOC) sont fondées, respectivement, en 1600 et en 1602. Les Anglais abordent à Surat (1608), alors principal port de l'empire moghol. C'est là qu'après de longues négociations ils obtiennent d'édifier leur première factorerie (1612).
Pour en savoir plus, voir les articles Compagnie anglaise des Indes orientales, Compagnie hollandaise des Indes orientales,
Le développement ultérieur des comptoirs anglais sera, en grande partie, la conséquence des heurts violents de 1623 avec les Hollandais en Asie du Sud-Est. La Compagnie anglaise se replie donc vers l'Inde et, pour y pratiquer le commerce « triangulaire » qui enrichissait tant ses concurrents, s'établit sur la côte de Coromandel : elle construit (1639), près de la future Madras, un fort qui sera baptisé Saint George. En 1658, elle occupe une ancienne factorerie portugaise sur l'Hooghly, principal affluent du Gange, à plus de 160 km au nord du golfe du Bengale. Son troisième point d'ancrage sera Bombay, cédée aux Anglais par la dot de la princesse portugaise Catherine de Bragance à l’occasion de son mariage avec le roi d’Angleterre Charles II, et confiée par la Couronne à la compagnie en 1668. Surat est alors abandonnée et Bombay fortifiée dès 1669. En Angleterre même, la Compagnie, qui avait failli disparaître sous Charles Ier mais que Cromwell avait sauvée (charte de 1657), obtient désormais des privilèges de plus en plus grands.
La France n'apparaît en Inde que dans la seconde moitié du xviie siècle. Colbert crée la Compagnie française des Indes orientales en 1664. Les premières occupations françaises dans le golfe du Bengale en 1671 à Surat et à Sao Tomé sont éphémères avant que François Martin puisse acquérir le droit auprès du sultan de Bijapur de s'installer à Pondichéry (1674) et du nabab du Bengale à Chandernagor (1688). Pondichéry sera pris par les Hollandais pendant la guerre de la ligue d'Augsbourg, puis restitué en 1699 après la signature du traité de Ryswick (1697). Les autres comptoirs français ne seront acquis qu'au xviiie siècle : Masulipatam, Calicut, Mahé et Yanaon (1721-1723), et Karikal en 1739.
Pour en savoir plus, voir l'article Inde Française.
6. L'Empire moghol
6.1. Les premiers conquérants (1526-1556)
BaberBaber
L'établissement de la dynastie moghole en Inde fut l'œuvre du Timuride Baber (ou Babur), qui, parce que ses espoirs de conquêtes en Asie centrale avaient été contrecarrés par la montée des Ouzbeks en ce début du xvie siècle, avait dû se tourner vers Kaboul et, de là, avait su profiter du déclin du sultanat de Delhi. Trois victoires – sur Ibrahim, le dernier des Lodi, à Panipat, en 1526, sur une confédération rajpute, à Khanua, en 1527, et sur une coalition afghane, près de la Gogra, en 1529 – lui assurent la maîtrise de l'Inde du Nord.
L'histoire de la dynastie moghole, officiellement fondée sur le sol indien en 1527, est alors, et pour près de deux siècles, jusqu'à la mort d'Aurangzeb, en 1707, avant tout celle des luttes et des guerres qui assureront son maintien et sa grandeur, guerres civiles pour des successions toujours férocement disputées, guerres de conquêtes (parfois de reconquêtes) lorsque les premières sont achevées. Cette sorte de sélection naturelle, qui tenait au fait qu'il n'existait pas de droit précis en matière de succession chez les Turcs Djaghataïdes, amena au pouvoir des conquérants remarquablement habiles et implacables.
Le fils de Baber, Humayun (1530-1556), n'aura pas assez de dix ans pour asseoir suffisamment son autorité face aux siens. Il perd en 1540 son royaume au profit d'un Afghan, Chir Chah, à bien des égards meilleur que lui, mais dont, à son tour, la descendance ne peut conserver le pouvoir. Humayun recouvre alors son héritage, quelques mois seulement avant de mourir.
6.2. Akbar et la construction de l’Empire moghol (1556-1605)
L'Empire mogholL'Empire moghol
Les extraordinaires capacités d'Akbar (1556-1605), tant militaires qu'administratives, jointes à une personnalité hors pair, font du royaume si fragile d'Humayun, son père, un empire solide et véritablement indien.
Une à une, les différentes puissances et les différentes régions, de l'Afghanistan au Bengale et de la bordure himalayenne au nord du Deccan, sont soumises et intégrées dans une structure impériale dont nombre d'aspects administratifs dureront au moins jusqu'aux premiers temps de la domination britannique. L'un des plus grands mérites de l'empereur est, en même temps, de reconnaître la diversité de son peuple et d'en tenir compte pour gouverner. Dans ce sens sont à comprendre des mesures comme la suppression de la capitation (qui, en territoire conquis par l'islam, frappe les infidèles) et la participation, jusqu'au plus haut niveau, d'hindous au gouvernement.
Des considérations politiques aussi, en même temps qu'une forte tendance au mysticisme et que la fréquentation curieuse d'hommes de religions diverses, le pousseront même à tenter d'instituer une forme de syncrétisme religieux lorsqu'il se voudra chef spirituel de ses sujets. L'art du nouvel empire, l'architecture notamment, témoignera de la même ouverture d'esprit.
6.3. Les successeurs d’Akbar et l’apogée de l’Empire (1605-1707)
Les règnes de Djahangir, de 1605 à 1627, puis de Chah Djahan, de 1628 à 1658, sont ceux de la plus grande splendeur moghole, à la cour du moins (à Agra puis, à partir de 1648, à Delhi) et dans les capitales provinciales.
Le règne de Djahangir, en fait celui de sa femme, la princesse persane Nur Djahan, voit Agra, alors deux fois plus grande qu'Ispahan, devenir un modèle d'élégance séfévide. Quant à Chah Djahan, il a laissé avant tout le souvenir du bâtisseur le plus magnifique que l'Inde ait connu. Le Tadj Mahall et la mosquée de la Perle, tous deux à Agra, et la septième cité de Delhi, Chah Djahanabad, sont son œuvre.
Mais, déjà sous ce dernier empereur, l'esprit de tolérance d'Akbar et de Djahangir a cédé la place à une réaction musulmane qui, avec Aurangzeb (1658-1707), deviendra fanatisme et contribuera sûrement au déclin de l'empire, en lui aliénant, entre autres supports, les Rajputs loyaux depuis le temps d'Akbar.
Déjà aussi sous Chah Djahan, le piège s'entrouvre où s'enlisera Aurangzeb. Ce piège c'est le Deccan, précisément les sultanats de Bijapur et de Golconde. Les campagnes successives, coûteuses et dévastatrices, pour annexer ces deux royaumes commencent dès 1631. Elles occuperont Aurangzeb de 1681 à sa mort.
Les guerres de succession, les guerres dans le Deccan, d'autres encore ont finalement ravagé de vastes territoires. L'Empire moghol n'a jamais été aussi étendu qu'à la fin du règne d'Aurangzeb, mais l'Inde est plus misérable qu'au temps d'Akbar. Des révoltes éclatent dans la seconde moitié du xviie siècle, auxquelles le fanatisme de l'empereur donne une coloration religieuse : les sikhs du Pendjab se soulèvent, ainsi que les Rajputs du Rajasthan et surtout les Marathes du Deccan (Sivaji commence sa carrière en 1647 et fonde le royaume marathe en 1674).
7. Le xviiie siècle
Les traits marquants de ce siècle sont le déclin de l'empire moghol, la montée de la puissance marathe, les débuts de l'ingérence des Anglais dans les affaires indiennes et la défaite des Français face aux Britanniques dans l'Inde du Sud.
7.1. Le déclin et l’éclatement de l’empire moghol
Dans un premier temps, malgré bien des vicissitudes – luttes intestines à la cour, manifestations d'indépendance de la part de gouverneurs, attaques venues de la Perse (1739) puis de l'Afghanistan (à cinq reprises, de 1747 à 1761) –, l'Empire moghol reste la première des puissances indiennes jusqu'à la bataille de Panipat (1761), donc pendant plus de cinquante ans après la mort d'Aurangzeb.
Le principal responsable de la défaite de Panipat (militairement, celle de l'armée marathe face aux Afghans de Ahmad Chah) est, en fait, le vizir de l'empire, Imad al-Mulk. Sa gestion, de 1753 à 1761, a été si désastreuse qu'elle a affaibli Delhi au point de susciter une quatrième intervention afghane en 1757, puis une cinquième en 1759, l'obligeant à appeler encore les Marathes à son secours.
Après la défaite de Panipat, l'Empire moghol n'est plus qu'un royaume, celui de Delhi, qui, grâce d'abord au gouvernement du représentant du souverain afghan (1761-1772), puis grâce à celui de Nadjaf Khan (1772-1782), pour le compte du plus talentueux des derniers Moghols, Chah Alam (restauré en 1772), réussit à rester indépendant. Il cesse de l'être lorsque, faute d'une personnalité capable de succéder au khan, le général marathe, Mahadaji Sindhia, se voit offrir le titre de régent de l'empire en 1785.
Les Anglais, ensuite, occuperont Delhi en 1803 lors de leurs campagnes contre Sindhia et la dynastie moghole disparaîtra définitivement quand, après la « mutinerie » (→ révolte des cipayes) de 1857, ils enverront mourir en exil en Birmanie son dernier représentant, Bahadur Chah.
7.2. Les Marathes
La plus grande puissance indienne du xviiie siècle, lorsque décline l'Empire moghol, est celle des Marathes de Pune. Tant que les peshva (Premiers ministres) conservent tout le pouvoir entre leurs mains (de 1714 à 1772), tenant à distance les quatre grandes familles de chefs de guerre qui forment avec eux une sorte de confédération, les Marathes règnent en maîtres, directement ou indirectement, sur l'Inde entière, à l'exception du Bengale. Mais l'affaiblissement de leur pouvoir central, en un temps où les Anglais viennent d'apprendre au Bengale et dans le sud de l'Inde à user de leur influence, conduit à trois guerres (1775-1782, 1803-1805, 1817-1818) qui finissent par anéantir les Marathes et par donner à leurs adversaires britanniques l'empire de l'Inde.
7.3. La rivalité franco-britannique
La guerre de la succession d'Autriche (1740-1748) dans laquelle s’opposent la France, l’Angleterre et leurs alliés respectifs, se double d’un conflit d’ordre colonial entre les deux puissances, notamment en Inde. Il a pour théâtre le Deccan oriental, plus précisément le Carnatic, portion sud-est de la péninsule entre les Ghât orientaux et la côte du Coromandel, et, plus au nord dans le centre, l’État de Hyderabad.
Si Pondichéry est défendue en 1748 avec succès par son gouverneur Dupleix , Madras, qui avait été prise en 1746 par la flotte de Mahé de La Bourdonnais, est rendue aux Anglais par le traité d'Aix-la-Chapelle (1748) en échange de la restitution de Louisbourg au Canada. Dupleix reprend alors la lutte contre les Anglais par princes indiens interposés. Il rencontre un certain succès (prise de Hyderabad en 1751) mais se heurte aux Anglais et à leurs alliés indiens au Carnatic (échec devant Trichinopoly, 1753) avant d’être rappelé par la Compagnie française des Indes et le gouvernement en 1754.
La guerre de Sept Ans (1756-1763) est l’occasion pour l’Angleterre d’écarter définitivement la concurrence de la France. Chandernagor tombe en 1757 ; Masulipatam en 1759 ; les troupes de Lally-Tollendal sont défaites par celles de sir Eyre Coote à Vandavachy (Wandiwash) en janvier 1760 et Pondichéry capitule l’année suivante avant d’être restitué par le traité de Paris (1763) mais le rôle de la France en Inde est désormais insignifiant.
8. La formation de l'Empire britannique des Indes
L'Inde à l'époque colonialeL'Inde à l'époque coloniale
Les menées agressives d'un jeune nabab du Bengale, Siradj al-Dawla, en 1756, face à une compagnie de marchands qui entend défendre ses droits, sont le choc initial qui déclenche un processus d'expansion qui, de la simple canonnade de Plassey (juin 1757), commandée par Robert Clive contre le nabab, conduit à la victoire de Buxar, en octobre 1764, cette fois face à une coalition indienne où figure l'empereur moghol.
8.1. L’East India Company, nouvelle puissance territoriale
En 1765, l’East India Company, dont la principale « présidence » est Fort William (à Calcutta) se voit confier par le traité d’Allahabad la perception des impôts et l’administration des Finances dans les trois provinces du nord-est (Bengale, Bihar et Orissa). La même année, elle prend en main les fonctions de défense et de maintien de l’ordre au Bengale. Ce pouvoir ne tardera pas à s’étendre pour devenir sans partage et la Compagnie devient de fait l’une des principales puissances territoriales du sous-continent, dotée d’une puissante armée recrutée parmi les brahmanes et Rajputs du Nord sous le commandement d’officiers britanniques et dont l’entretien absorbera près de la moitié de ses dépenses.
Mais loin d’être le fruit d’une politique délibérée, l'expansion britannique dans toute l'Inde (à partir des présidences de Calcutta, de Madras et de Bombay, avec une nette prééminence de la première à partir de 1793) apparaît plutôt comme un mouvement irréversible, dans lequel la Compagnie, obéissant à une logique à la fois mercantiliste et militaire, est entraînée pour augmenter ses revenus, mais aussi parfois seulement pour les conserver face à des États indiens encore puissants. Ainsi, pour Warren Hastings, gouverneur général du Bengale en 1772-1785, il s’agit avant tout de préserver les possessions britanniques déjà établies dans le Nord comme dans le Sud, en signant notamment un traité avec les Marathes (1782) tandis que son successeur, le général lord Cornwallis (1786-1793), n’entend qu’affaiblir le sultan Tippoo Sahib (troisième guerre du Mysore, 1790-1792) et non annexer son territoire. Sous le gouvernorat de Sir John Shore (1793-1798) la Compagnie privilégie de nouveau la diplomatie.
8.2. L’extension du Raj britannique
C’est à partir de l’arrivée au pouvoir de lord Richard Wellesley, gouverneur général de 1798 à 1805, que la compagnie se lance dans une politique systématique d’annexions territoriales. Tippoo Sahib est battu et trouve la mort en 1799 à l’issue de la quatrième et dernière guerre du Mysore. La majeure partie de ses territoires est annexée de même que le Carnatic en 1801, tandis que Tanjore est placée sous la protection de la compagnie.
Cette politique d’annexion est poursuivie dans le Nord et commence à inquiéter Londres et la direction de la compagnie. Le gouvernorat de lord Minto (1807-1813) marque ainsi une pause dans les conquêtes avant leur reprise sous celui de lord Hastings (1813-1823) : le royaume du Népal, transformé en État tampon, doit céder des territoires (1816) et, surtout, après trois guerres, les Marathes s’inclinent en 1818. À cette date, la Compagnie n’a plus de véritable rival dans le sous-continent à l’exception du plus lointain Pendjab et avec lequel les relations sont encore bonnes.
Elle est cependant engagée dans de nouveaux conflits dont certains en dehors du territoire indien au cours des années suivantes. Sous Amherst (1823-1828), la Birmanie perd la plus grande partie de sa façade maritime. Après un intervalle de sept années de paix sous lord William Bentinck (1828-1835), lord Auckland (1836-1842) cautionne la désastreuse expédition d'Afghanistan. Cette expédition devait s'assurer de ce pays face au péril russe. En 1841, l'armée anglaise de Macnaughten est totalement exterminée.
Lord Ellenborough (1842-1844) venge cette défaite en faisant la conquête (sanglante) du Sind (1842). Lord Hardinge (1844-1848) attaque la dernière grande puissance indienne indépendante, le royaume sikh du Pendjab, jusque-là ami mais en en proie à des troubles depuis la mort de son souverain, Ranjit Singh, en 1839.
La première guerre sikh s'achève (1846) par l'annexion de territoires, entre autres le Cachemire, qui est donné au Rajput Gulab Singh dont la famille régnera jusqu'après l'indépendance de l'Inde (1947). Lord Dalhousie (1848-1856), enfin, achève l'œuvre de son prédécesseur. La seconde guerre sikh aboutit (1849) à l'annexion du Pendjab.
En 1850, l'Empire britannique des Indes s'étend du Bengale à l'Indus, du Cachemire au cap Comorin. D'ultimes expéditions auront lieu contre la Birmanie (1852 et 1885) et contre l'Afghanistan en 1878-1880, sans plus de succès qu'en 1841. Les territoires conquis seront, dans leur grande majorité, administrés directement, mais des centaines d'États autonomes, protectorats en fait liés par traité à la Couronne, gouvernés par des maharaja, subsisteront jusqu'en 1947. Parmi les plus grands figurent le Cachemire et l'État de Hyderabad.
8.3. L'évolution institutionnelle
L'expansion territoriale britannique provoque des mesures destinées à l'administration du nouvel empire et qui touchent au statut de la compagnie des Indes elle-même. La centralisation de l'autorité à Calcutta (confiée au « gouverneur général et conseil de la présidence de Fort William ») s'accompagne du passage progressif de la compagnie sous le contrôle du gouvernement de Londres. La première loi témoignant de cette évolution est le Regulating Act de 1773. L’India Act de 1784, transfère le pouvoir de décision de la Cour des directeurs de la Compagnie à un Conseil de contrôle (Board of Control) relevant de la Couronne.
Puis, par le Charter Act de 1813, la Compagnie perd son monopole commercial. L'Inde est ouverte à l'entreprise privée. Par celui de 1833, elle perd ses activités commerciales pour ne plus être qu'un organisme de gouvernement et le gouverneur général du Bengale devient gouverneur général de l'Inde. Enfin, le Government of India Act de 1858, signant le démantèlement de la compagnie, en transfère toutes les fonctions et propriétés à la Couronne, qui par l’intermédiaire du vice-roi, gouvernera désormais le pays.
Les mesures administratives, pendant cette période, sont nombreuses. Il convient de mentionner le Code que laisse Cornwallis en 1793 et qui définit les règles selon lesquelles s'exercera l'autorité anglaise. La plus célèbre d'entre elles, le Permanent Zamindari Settlement, définit les modalités de la levée de l'impôt foncier au Bengale et fait des zamindar les propriétaires intermédiaires entre les paysans et l'Administration. Dans le Sud, la perception de cet impôt sera différente, dans son principe. L'impôt, aux termes du Ryotwari Settlement mis en place par Thomas Munro, gouverneur de Madras de 1820 à 1827, sera exigé directement des paysans par l'Administration. Dans le premier cas, l'Angleterre tente de substituer une sorte de « gentry » à l'ancienne noblesse moghole ; dans le second, elle tente de faire des paysans les seuls propriétaires des terres qu'ils cultivent, ce qui revient à vouloir changer les structures sociales traditionnelles…
D'une manière générale, toutes les mesures que les Anglais prennent, dans la première moitié du xixe siècle, amènent des transformations partielles de la société indienne. Par exemple, la levée (1833) de l'interdiction faite jusque-là aux missionnaires de venir exercer leurs activités en Inde ainsi que l'introduction, vers la même époque, de l'éducation anglaise font naître une culture anglo-indienne, illustrée d'abord par le mouvement dit de la « renaissance hindoue » au sein de l’intelligentsia bengali. Et les Britanniques tentent des réformes sociales (interdiction, par exemple, du suicide des veuves en 1829). En matière économique, de même, l'abolition du monopole commercial de la Compagnie rend l'Inde dépendante de l'étranger (c'est-à-dire de l'Angleterre). Mais cette mesure fait aussi naître un capitalisme indien…
8.4. La « mutinerie »
L'œuvre du gouverneur général Dalhousie (1848-1856) résume assez bien les bouleversements que l'Angleterre impose à l'Inde pendant la première moitié du xixe siècle. Bouleversements techniques par le lancement de la construction du réseau ferré, et celle du réseau télégraphique, ainsi que par la mise en place d'un réseau postal uniforme. Bouleversements politiques par l'application de la doctrine dite du « lapse », selon laquelle, en l'absence d'héritier direct, un royaume revient à son suzerain, donc à la compagnie. Cette doctrine, contraire à la loi hindoue et à la loi musulmane, qui reconnaissent les droits des héritiers par adoption, permet à Dalhousie des annexions pacifiques et des économies substantielles, car le principe est également appliqué aux pensions.
Cette politique impérialiste culmine avec l'annexion de l'Aoudh, en 1856, non parce que son souverain n'a pas d'héritier, mais sous le prétexte de mauvais gouvernement. L'Aoudh est, en fait, l'une des régions les plus riches de l'Inde. Cette annexion est une erreur à laquelle viennent s'en ajouter d'autres commises par lord Canning (1856-1862), dernier gouverneur général de l'Inde et premier vice-roi.
Révolte des cipayesRévolte des cipayes
Le 9 mai 1857, à Meerut (à environ 50 km au nord de Delhi), éclate dans l'armée du Bengale ce que les Anglais appelleront une « mutinerie », mais qui sera plus qu'une simple révolte de soldats, sans cependant atteindre les dimensions d'une révolte nationale, faute d'une direction et d'un idéal communs. C'est, sans doute, le « dernier sursaut d'un ordre condamné », dont certains éléments supportaient mal les spoliations et la pacification énergique de la puissance étrangère. Cette révolte qui, pendant l'été de 1857, ne fait vraiment perdre aux Anglais que le contrôle du cœur de la vallée du Gange, est rapidement matée, souvent avec une extrême cruauté.
La « mutinerie » (ou révolte des cipayes) aura de multiples conséquences. Un mur de défiance opposera désormais les deux communautés, et l'Angleterre, qui se voulait éducatrice et civilisatrice, n'essaiera plus de légiférer dans des domaines touchant à la religion et aux mœurs. L'évolution de l'Inde au siècle suivant sera bien davantage due au rôle économique que lui fera jouer la puissance coloniale, initiatrice, partenaire et rivale, et à la prise de conscience des Indiens de leur identité.
9. L'Inde coloniale
9.1. Le gouvernement de l'Inde
L'Inde britannique, résultat de cette politique de conquêtes et d'annexions, est devenue, au fil des années, un immense empire comprenant deux sortes de territoires : des territoires administrés directement et des territoires princiers (plus de 600 au début du xxe siècle) soumis au régime de l'administration indirecte, autonomes, mais sans aucune indépendance réelle.
L'Empire est, depuis Calcutta (depuis Delhi à partir de 1911), dirigé par un vice-roi (successeur du gouverneur général depuis 1858) nommé par le gouvernement anglais et dépendant du secrétaire d'État à l'Inde, ce dernier, membre du gouvernement de la Couronne. Le vice-roi est assisté d'un Conseil exécutif, purement consultatif, d'abord de six membres nommés par Londres. Son Conseil législatif est le même, mais augmenté de seize membres nommés par lui. L'administration impériale est absolument centralisée dans la mesure où les gouverneurs de province, assistés de leurs conseils, ne sont que des délégués du vice-roi qui les nomme. Cette centralisation autoritaire est pesante. Elle prend la forme, le temps passant, d'une machine bureaucratique énorme et conservatrice.
L'administration quotidienne repose, elle, presque entièrement sur la personne du collecteur de district, au début homme de terrain, homme à tout faire, aux fonctions à la fois exécutives et judiciaires. Puis, ses tâches ne cessant de croître, ce personnage devient un bureaucrate qui supervise, à la tête d'une administration indigène.
Les administrateurs britanniques appartiennent au corps de l'ICS (Indian Civil Service), dont les Indiens, longtemps, ne pourront faire partie puisque, jusqu'en 1922, le concours d'entrée se passera obligatoirement en Angleterre. Ce corps est resté célèbre pour l'esprit victorien qui l'animait, mais qui le rendait anachronique et incapable d'innover. Toutes les initiatives rendues nécessaires par la poussée nationaliste et par les grands événements mondiaux (les deux guerres mondiales, la crise de 1929) viendront toujours de Londres et se heurteront au conservatisme de ces fonctionnaires coloniaux.
9.2. L'Inde rurale
L'Inde sur laquelle les Britanniques étendent leur empire est un pays rural (le pourcentage de la population urbaine est de 10 % en 1901 et ne sera que de 13 % en 1941) peuplé de villages (730 000 en 1901) isolés, pratiquement autarciques, aux structures sociales héritées d'un très long passé.
La société y est divisée en castes hiérarchisées et cette structure conditionne tous les aspects de la vie rurale. Si le nombre des castes, à considérer l'Inde dans son ensemble, apparaît presque infini, à l'intérieur d'un même village, trois groupes peuvent être, du point de vue économique, définis. Au sommet de la hiérarchie, la caste dominante possède la plus grande partie des droits sur la terre, sans la travailler elle-même. En dessous, et dépendant largement de la classe précédente, viennent les petits propriétaires, les tenanciers et les artisans ruraux. Les exploitations à ce niveau sont petites, guère plus du minimum vital, parfois moins. En bas, enfin, se tiennent les plus pauvres et les plus méprisés, les paysans sans terre et les castes de service impures, en général intouchables. C'est dans ce prolétariat que figurent les paysans non libres endettés dans des conditions qui ne leur permettent pas de racheter leurs dettes.
Dans ce monde, les Anglais introduisent un certain nombre de nouveautés qui, directement ou indirectement, transforment les structures agraires. Il s'agit d'abord de l'établissement de nouveaux systèmes fonciers (dès 1793) qui, en instituant le droit de propriété, bouleversent les droits traditionnels sur la terre, rompant par là l'équilibre de l'économie villageoise. Il s'agit ensuite de l'introduction des cultures industrielles et de la commercialisation croissante de l'économie agricole, phénomènes qui, joints à la concentration de la propriété foncière qui avait suivi l'institution de la propriété, vont déséquilibrer la production agricole et l'assujettir aux fluctuations des cours mondiaux. Enfin, aux facteurs de déséquilibre touchant une société bloquée, s'ajoute, à partir de 1921, le facteur démographique. À partir de 1921, en effet, le taux de mortalité chute de façon continue (il passe de 40 à 50 ‰ avant cette date à 31,2 ‰ en 1941) en face d'un taux de natalité stationnaire aux environs de 45 ‰.
9.3. L'industrie pendant la période coloniale
Le secteur moderne de l'économie indienne, de type capitaliste, est d'abord aux mains d'hommes d'affaires britanniques qui qui peuvent exercer leur activité fortement monopolistique grâce au système des agences de gestion (managing agency system) créé entre 1834 et 1847 à Calcutta puis généralisé à l’ensemble du territoire : les sociétés londoniennes, ignorantes du milieu indien, confient la gestion de leurs capitaux à de vieilles firmes implantées depuis longtemps en Inde.
Ces agences, qui détiennent, en le concentrant aux mains de quelques-uns, le pouvoir économique, fleurissent jusque dans les années 1920. Après quoi commence à se développer un capitalisme indigène, calqué sur le modèle anglais, œuvre de communautés précises (et d'abord celle des parsis, qui avaient commencé, au siècle précédent, à faire des affaires en tant qu'intermédiaires [compradores] dans le commerce du coton et de l'opium). Ce développement se produit à la faveur, notamment, d'une protection douanière (mais sélective) de l'industrie indienne, des difficultés auxquelles se heurte l'industrie en métropole dans les années 1930, et des succès que remporte le nationalisme indien. Les deux guerres mondiales, en isolant l'Inde et en augmentant la demande anglaise, favoriseront aussi l'essor de l'industrie indienne.
Cela étant, le bilan industriel de l'Inde au moment de l'indépendance ne sera nullement en rapport avec les besoins du pays. La raison principale en est que l'industrie indienne est longtemps restée de type colonial, c'est-à-dire déséquilibrée. Certains secteurs seulement ont été développés : fabrication du thé, industrie du coton dans l'Inde de l'Ouest, du jute au Bengale, extraction de la houille au Bihar et en Orissa, au détriment des industries de base que le gouvernement n'a pas aidées, laissant par ailleurs les frontières ouvertes aux importations de la métropole. L'une des conséquences de cette politique est que longtemps subsistera un vaste secteur inorganisé et archaïque. Enfin, l'industrie coloniale, centrée sur les ports, ne contribue pas au développement du reste du pays.
Pour en savoir plus, voir l'article Inde : vie politique depuis 1947.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
SUR LES TRACES DES CARAVANES DE SEL |
|
|
| |
|
| |
Mongolie · Pascal-Lluch
Les caravanes de sel… Elles ont toujours fait rêver les voyageurs modernes, tels des vestiges d’un temps passé qui porteraient un sens particulier, essentiel. Les plus célèbres sont en Afrique saharienne où elles existent toujours comme au Mali et en Mauritanie, en Amérique latine et en Himalaya. Effectivement le sel a toujours été une bonne monnaie d’échange, car indispensable aux hommes comme aux animaux d’élevage, facile à transporter, et en général gratuit ou quasiment pour celui qui a les moyens de le transporter. C’est donc aussi un vecteur d’échange, celui qui rend viable un commerce au long cours, celui qui amorce une chaine d’échanges de biens.
Mes nombreuses années de pérégrinations au Sahara, et quelques belles traversées
chamelières, m’ont amené à croiser leurs routes à diverses reprises. Mais il est aujourd’hui difficile de se balader dans le désert entre l’Atlantique et la mer Rouge, et je cherchais une idée originale de traversée au long cours avec des chameaux.
Puisque c’était devenu difficile avec des chameaux à une bosse, pourquoi ne pas essayer avec deux ? La carte de l’aire de répartition du chameau de Bactriane est largement traversée par les antiques routes de la soie, dont il fut le principal vaisseau de transport. Aujourd’hui ces territoires sont les anciennes républiques satellites de l’ex-URSS, dont le nom fini invariablement par « stan ».
Ce ne sont pas forcément les plus faciles d’accès, ni les plus simples pour organiser une longue randonnée.
Mais un peu plus à l’Est, coincée entre la Chine et la Russie, la Mongolie abrite encore une petite population de chameaux de Bactriane, et le souvenir de ces caravanes de jadis. Lors de mes voyages précédents j’avais parcouru au pays du cheval le Khenty et l’Arkhangay, et noué de solides contacts. Mais tout l’Ouest me restait inconnu, l’Altaï et la région des grands lacs. Ca tombait bien…
Les grands lacs salés fournissaient le sel avec lequel les caravaniers complétaient leur chargement, qu’ils aillent vers l’Est ou l’Ouest, le sel ayant partout une forte valeur ajoutée.
Fin 2009 je soumets cette idée à Joel Rauzy (Wind of Mongolia), installé en Mongolie depuis bientôt 10 ans, où il organise, entre autres, d’étonnantes virées avec des chiens de traineau dans le nord du pays. Il a une
bonne connaissance du pays, et un sens aiguisé de la logistique d’expédition. Reste à faire le transfert de savoir-faire entre le Sahara et l’Asie centrale : sensibiliser et former une équipe possédant de bons chameaux, du côté d’Olgii, la principale ville de l’Ouest, fabriquer le matériel (selles, sacoches, tente cuisine/mess, etc.), se documenter sur les voies caravanières et imaginer un bel itinéraire, qui ait aussi sa pertinence historique, résoudre les problèmes de ravitaillement, d’évacuation éventuelle, etc. Bref des centaines de mails et discussions par ordinateur.
Le voyage ira de l’Ouest vers l’Est, entre les villes d’Olgii et Uliastay, la ville au pied du versant ouest de l’Arkhangay, le massif situé au centre du pays. Nous espérons parcourir plus de 500 Km, « au rythme lent du chameau ».
Le découpage des étapes est prêt, et nous rêvons des bords de lacs, des cordons de dunes et des vastes steppes d’altitude, plus ou moins arides, plus ou moins fleuries.
Fin 2012 – début 2013 un groupe de participants se met en place, et l’aventure va enfin prendre corps !
Les chameliers sont aussi fébriles que nous à la perspective de ce départ, une première depuis près de cent ans, car les grandes caravanes ont disparu avec la soviétisation de la Mongolie, à partir de 1921 : l’état communiste s’occupe de tous, fourni tout, gère tout, bref vassalise la Mongolie qui devient un satellite de l’URSS. Accessoirement il interdit le nomadisme…
Mais fin juillet 2013 tombe une nouvelle atterrante : des épizooties dans l’Ouest de la Mongolie ont obligé les services vétérinaires à déclarer confinées dans la province toutes les têtes de bétails.
Nos chameaux sont donc coincés, pas question qu’ils quittent leurs pâturages officiellement avant le 04 septembre, jour de notre arrivée, mais plus probablement fin septembre !!!!
C’est l’abattement ; comment refaire en si peu de temps ce qui nous a pris deux années ? Où trouver des chameaux dans une autre région, imaginer un nouvel itinéraire, repenser la logistique ?
Mais il faut croire que Tengri ou «le Grand Ciel», auteur du visible et de l’invisible, esprit protecteur des hommes et de ces grands espaces, gardait un œil bienveillant sur nous…
Après avoir envoyé deux personnes battre la campagne en express mais sans succès, c’est un simple numéro de téléphone portable qui nous est parvenu directement à Ulan Bator : Odkhuu devait être notre homme.
Eleveur du côté d’Ulaangom, 45 ans, il a déjà travaillé deux ou trois fois avec des touristes, et il croit au projet ! Une confiance mutuelle s’établie en quelques conversations téléphoniques ; et il faut aller vite : il rassemble quatre chameliers qui viendront avec leurs chameaux, et pas grand-chose d’autre…si ce n’est leur goût de l’aventure, à une période où leurs collègues et amis préparent l’hiver, engrangent le foin et le crottin, stockent les produits laitiers, engraissent le plus possible le bétail pour affronter l’hiver qui ne va pas tarder à s’annoncer, et qui est long, parfois dévastateur.
C’est vrai aussi qu’ils ont su faire grimper les prix, et que le voyage vaut l’aventure…
05 septembre, nous atterrissons à Olgii ; trois petits minibus 4x4 de fabrication russe, les célèbres Purgon rustiques mais si efficaces, nous emmènent à la frontière de la province, à 3 heures de piste, au bord d’un petit lac. Au bord, idyllique, une yourte qui fume, de l’herbe verte et des chameaux au pâturage… Nos chameaux ! Je retrouve Joel, et nous nous tombons dans les bras : « ca existe ! » lui dis-je. Ces dernières semaines ce voyage paraissait irréel, relever de l’impossible. Mais non, ou plutôt mais si, il existe bel et bien et il est devant nous. Départ demain matin.
Prise de contact avec les chameliers ; ca ne sera pas simple de se souvenir des prénoms, encore moins de les prononcer
correctement. Odkhuu nous fait un petit discours de bienvenue, nous remercie d’être venus jusque là, dit qu’ils sont fiers de participer à cette première, qu’il y a pour eux beaucoup d’inconnues. Ils ont d’ailleurs fait venir le lama du village voisin, lequel a donc apporté sa bénédiction au voyage, et demander aux cieux la « route blanche » pour toute notre équipée. Soit 23 personnes, 22 chameaux, 5 chevaux et un Purgon d’assistance et ravitaillement. Les Franco-suisso-belges sont bien encadrés !
06 septembre, départ. L’activité au camp est importante, foisonnante même. Il n’y a pas eu de répétition générale, et les marques à trouver sont nombreuses. Nous partons donc à pied, plein Est, en espérant être rejoint par les chameaux un peu plus tard.
Comme au Sahara en fait. Impression de légèreté ; nous avançons dans l’espace infini, avec un sac léger. Si nous pouvions parcourir ces vingt jours de marche sans autre matérialité…
Mais nous sommes un groupe de randonneurs chevronnés, et nous avançons bon train, pas franchement moins vite que les chameaux, et qui plus est dispersés, car chacun aime à tracer sa route. Une drôle de surprise pour les Mongols, qui eux ne mettent jamais un pied devant l’autre plus loin qu’un rayon de 20 mètres autour de la yourte, la distance maximale qui les sépare d’un cheval à l’attache, et toujours prêt à partir. Ce sera d’ailleurs leur plus grande surprise de ce voyage, découvrir que l’on peut se déplacer à pied…
Et qui surprendra tout autant les familles croisées près de leur yourte, qui nous verront toutes arriver puis repartir un peu comme des extra-terrestres. Car finalement nous marcherons beaucoup au cours de cette méharée, nos randonneurs ayant des fourmis dans les pattes de derrière dès le petit déjeuner avalé. Et nos chameliers ne prendront jamais le rythme saharien. C’est vrai que tout est moins simple ; comme nous ils doivent s’habiller chaudement, prendre un vrai petit déjeuner, plier leur tente, préparer les chameaux pour nous et les bagages, ainsi que leur chevaux de monte qu’ils enfourchent, pour guider les chameaux. Et comme nous, la veille ils ont fait honneur à la vodka, ce qui n’aide pas à se lever avant l’aube !
Mais la caravane se rôde, les rôles se définissent, et la maitrise des horaires s’affirme au fil des jours.
Les paysages sont au rendez-vous, et l’étonnement premier, le plus, ce sont tous ces massifs de montagne qui nous entourent au nord et au sud, certes à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, mais imposants car culminants à plus de 3000 m pour certains. Bien que datant de l’ère primaire ces montagnes paraissent jeunes, car elles ont subies d’intenses pressions, fracturations et leurs crêtes sont acérées, marquées de nombreux pics. La plupart ne sont absolument pas fréquentées par les européens et ne servent de refuge au Mongols qu’en hiver, où l’on met bêtes et gens à l’abri des vents froids du nord qui
balayent insupportablement les plaines d’altitude, où ils ne passent donc que l’été. Ces pâturages ne sont donc pas exploités à la bonne saison, et si la couche de neige n’est pas trop épaisse, les animaux pourront profiter de cette belle herbe en grattant la neige. La complémentarité des espèces du cheptel joue à plein dans la survie de tout le troupeau : les moutons grattent la neige, ce qui profite aux chèvres qui sont moins habiles à cet exercice. Le problème pour les animaux l’hiver, c’est l’eau libre, quand la température ambiance ne monte pas au dessus de – 20 / - 10°…
Nous parcourons donc un couloir naturel entre les montagnes, une voie naturelle de circulation, empruntée par les rivières venant de l’est, pour mourir dans les lacs immenses, la plupart salés et d’un bleu azur. Là-même où se fournissaient les caravanes qui suivaient cet itinéraire évident, entre les confins du Kazakhstan et la lointaine Manchourie à l’est.
Ces références historiques ne font qu’ajouter de l’intérêt à un voyage qui n’en manque pas. Dès les premiers jours, les arrêts dans les yourtes, on ne peut plus improvisés, dont les occupants nous réservèrent des accueils franchement chaleureux furent des moments forts. Hélas, abordant des zones plus sèches, en perdant de l’altitude, les yourtes se firent plus espacées jusqu’à disparaître du paysage. Les nomades avaient déjà rejoint leurs camps d’automne ou de transit vers les camps d’hiver.
C’est seulement les derniers jours, reprenant de l’altitude mais surtout nous rapprochant des montagnes du centre de la Mongolie que les coupoles blanches refirent surface à l’horizon, ces nomades ayant justement rejoints leurs camps d’automne, à quelques kilomètres de leur camp d’hiver qu’ils rejoindront au dernier moment, quand le froid et la neige seront installés.
Ce nomadisme est codifié par le climat et la
succession des saisons, et la nécessaire dispersion, car presque partout en Mongolie les sols sont pauvres, constitués essentiellement de sable, où pousse une herbe maigre, même quand elle est bien verte.
Au bout de 8 jours les chameliers demandent un jour de repos pour leurs animaux ; une surprise et une nouveauté pour un saharien : le chameau fonctionnaire ? Allons donc, les chameliers se moqueraient-ils de nous ? Discussion, argumentation, négociation, rien n’y fait. L’endroit est très beau, au bord d’un lac d’eau douce ourlé de plantes rouge vif. Nous en prenons notre parti ; chacun pourra faire un peu de toilette, voire une petite lessive. Et nous achetons une chèvre, à cette saison moins grasse que le mouton, et ma foi excellente. Le soir même l’essentiel de la bête partira en brochette au cours d’une veillée enchantée autour du feu. Nos amis spontanément se mettent à chanter, comme ils le font aussi sur leur cheval dans la journée. Les bouteilles de vodka tournent.
Belle ambiance chaleureuse dans ce bout du monde, ce bout d’humanité.
En fait ces chameaux n’ont jamais travaillé. Retirés du pâturage, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sur les pistes, ne pouvant brouter qu’un peu le matin et le soir, car les chameliers, au contraire de leurs confrères sahariens, ne les laissent pas divaguer la nuit.
Il la passe entravés baraqués à proximité des tentes. Et nos chameliers sont inquiets du trajet retour, qui sera aussi long que l’aller, et qui va les ramener au bercail très tard dans la saison.
Ils vont revenir avec des animaux fatigués, peu engraissés, qui pourraient avoir des difficultés à passer l’hiver. Ils exigeront d’ailleurs un second jour de repos pendant le trajet.
Après un passage épique de rivière, où les chevaux avaient l’eau à la selle, et les chameaux aux cuisses, nous abordons bientôt un secteur très attendu par nombre de participants : les dunes !
Seront-elles à la hauteur de l'espérance des
Sahariens venus là tenter d’autres horizons, plus près du levant ?
Cet erg bordé au sud par une belle rivière, et au nord par des lacs, nous pensions, comme au Sahara, pouvoir nous y promener avec nos chameaux. Tant que les dunes étaient couvertes d’une végétation rase, et donc que le sable portait bien, tout alla bien, même si nous progressions doucement. Puis le sable vif remplaça les dunes fixées ; à nos yeux il prenait de jolies teintes or ou orangées. Mais nos chameliers notaient surtout la différence de consistance sous la sole de leurs animaux, chevaux et chameaux. Absolument pas habitués à ce genre de terrain, ils demandèrent de sortir de l’erg ! J’avais apporté deux films de nos aventures au Sahara, mais nous n’avons eu aucune occasion de les leur visionner. Ils auraient été bien surpris de voir ce que les dromadaires peuvent effectuer !
Nous décidâmes donc de suivre la bordure sud de l’erg. Cela nous permit de reprendre un rythme un peu plus rapide, et surtout de profiter des belles lumières sur ce massif de dunes, bordé par les reflets de la rivière. Quelques bivouacs exceptionnels, inhabituels en Mongolie, resteront gravés dans les mémoires.
Ce périple de 19 jours traçant sur la carte une belle trajectoire hors des sentiers battus, fut un beau défi d’abord, et une belle réalisation sur le terrain. Nul doute que les chameliers en parleront entre eux, et que le bruit courra dans la steppe que des Européens prennent un plaisir étrange à traverser leurs paysages, à pied et à chameaux…
Nous repartons en août et septembre 2014 ! Qu’on se le dise…
Texte et images : Pascal Lluch
DOCUMENT randopays.com LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
PRÉHISTOIRE |
|
|
| |
|
| |
Texte de la 11ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 11 janvier 2000 par Claudine Cohen
De l'homme (et de la femme) préhistorique
En 1883, l'anthropologue français Gabriel de Mortillet publie Le Préhistorique, une somme du savoir accumulé de son temps sur la préhistoire. Savoir tout neuf encore : seulement deux décennies plus tôt, Boucher de Perthes avait produit, aux yeux de ses contemporains d'abord sceptiques, puis émerveillés, les preuves de l'ancienneté de l'Homme, et démontré que des êtres humains avaient cohabité, en des temps dont aucune écriture n'a conservé la mémoire, avec des animaux aujourd'hui éteints - le Mammouth, l'Ours des Cavernes, le Rhinocéros laineux survivant par des froids glaciaires dans la profondeur des grottes, et armé de frustes "casse-têtes" de silex taillés.
Mortillet s'était employé à donner plus de rigueur à la science commençante, et avait classé selon un ordre typologique et évolutif les cultures humaines de cet homme, que déjà on n'appelait plus "antédiluvien". En 1865 John Lubbock avait forgé les termes de "Paléolithique" pour désigner les cultures de la pierre taillée, les plus anciennes, celles des chasseurs-cueilleurs, et "Néolithique" pour nommer les plus récentes, de la pierre polie et de la terre cuite propres aux premiers temps de la sédentarisation, de l'agriculture et de l'élevage.
L'étude de l'Homme préhistorique de Mortillet se nourrissait des recherches de Boucher de Perthes dans la basse vallée de la Somme, et des magnifiques découvertes de Lartet et Christy dans la vallée de la Vézère et de la Dordogne. S'inspirant de l'évolutionnisme darwinien (ou de ce qu'il croyait en savoir) il avait décrit le devenir linéaire et progressif de l'Homme et de ses cultures, depuis les primitifs bifaces de l'Acheuléen et du Chelléen, jusqu'aux industries de l'Homme de Néandertal (le Moustiérien) et aux cultures solutréennes et magdaléniennes, caractéristiques d'Homo sapiens. Cette progression de la lignée humaine culminait avec l'Homme de Cro-Magnon, un Homme semblable à nous, au front haut et à la stature robuste, découvert en 1868 dans la vallée de la Vézère. Aux racines de cette brillante lignée, Mortillet avait forgé la fiction d'un ancêtre mi-singe mi-homme, l'Anthropopithèque, auquel on attribua une petite industrie de silex éclatés trouvés à Thenay, dans le Loir et Cher, qui devaient bientôt se révéler être de vulgaires cailloux aux cassures naturelles.
Aujourd'hui, en l'an 2000, l'image de l'Homme préhistorique a beaucoup changé. Les idées sur l'évolution se sont modifiées, la Nouvelle Synthèse depuis les années 1930 a récusé l'image d'une évolution comprise comme progrès linéaire, mettant l'accent sur la variation, le buissonnement des formes, et la notion d'une histoire contingente, et imprévisible. D'innombrables découvertes ont enrichi notre vision du passé préhistorique de l'Homme, et ce n'est plus seulement dans le Loir-et-Cher, la vallée de la Somme et de la Vézère, que l'on va chercher ses origines, mais au Moyen Orient et en Europe centrale, aux confins de l'Afrique, de l'Indonésie, de la Chine...
Le regard sur la préhistoire est devenu plus directement ethnologique, et la volonté de mieux connaître dans leur réalité les premières sociétés humaines s'est marquée par de nouvelles exigences de rigueur dans les recherches de laboratoire et de terrain. Celles-ci font appel à un arsenal méthodologique nouveau - fouilles très fines, décapage horizontal des sites, remontages d'outils, méthodes quantitatives pour reconstituer la vie. La préhistoire expérimentale, par la taille et l'utilisation d'outils, en reproduisant les gestes du sculpteur ou du peintre, s'emploie à retrouver les pensées et les démarches opératoires des Hommes de ce lointain passé. Cette approche expérimentale et cognitive vise à livrer une vision plus vivante, plus vraie, plus humaine du passé lointain de notre espèce. Enfin, la vision de l'Homme préhistorique s'est diversifiée, complexifiée, et laisse aujourd'hui la place à une réflexion sur le rôle, les rôles possibles de la femme dans la préhistoire.
Généalogie d'Homo sapiens
"L'Homme descend du Singe", affirmait Darwin, et déjà Lamarck avant lui. La théorie de l'évolution, née au XIXème siècle, a conduit à penser l'origine de l'Homme, non comme création, mais comme filiation, qui enracine notre espèce dans l'ensemble du règne animal. Dès lors, reconstituer la généalogie de l'Homme, c'est réunir et tenter de donner un sens évolutif à tous ces vestiges osseux, baptisés Ardipithecus Ramidus, Australopithecus, Homo habilis, ergaster, rudolphensis, erectus, neandertalensis, sapiens... - qui dessinent, depuis le lointain de la préhistoire africaine, la constellation de nos ancêtres ; c'est interroger la configuration des événements complexes - biologiques, culturels, environnementaux - qui ont eu lieu depuis plus de 5 millions d'années.
La multiplicité des espèces d'Hominidés fossiles connues dès les époques les plus anciennes rend désormais impossible toute conception finaliste et linéaire de ce devenir. C'est un schéma arborescent, buissonnant même, qui rend le mieux compte de la profusion des espèces d'hominidés, parfois contemporaines entre elles, qui nous ont précédés. A lidée dune progression graduelle, on a pu opposer la possibilité de processus évolutifs plus soudains et contingents : ainsi Stephen Jay Gould a pu réaffirmer, après les embryologistes du début du siècle, l'importance pour l'évolution humaine de la néoténie : celle-ci consiste dans la rétention, à lâge adulte, de caractéristiques infantiles ou même fStales, qui peut faire apparaître dans une lignée des formes peu spécialisées qui seront à lorigine de groupes nouveaux. LHomme pourrait bien être un animal néoténique, et dériver dun ancêtre du Chimpanzé qui aurait conservé à lâge adulte les traits du jeune... Un des caractères particuliers de lHomme est en effet le retard de la maturation et la rétention des caractères juvéniles : ce retard se manifeste par certains traits anatomiques : régression de la pilosité, bras courts, tête volumineuse par rapport au reste du corps, gros cerveau, front redressé, régression de la face... - , mais aussi dans sa psychologie et son comportement : longue durée de léducation, goût du jeu, plasticité du système nerveux et capacité de lapprentissage jusque tard dans la vie.... L'acquisition chez l'homme de ces traits, et leur corrélation même, pourrait être explicable par un processus simple (et accidentel) du développement.
A la quête des origines de l'Homme s'est longtemps associée celle du "berceau" de l'humanité, dont Teilhard de Chardin se plaisait à dire qu'il était "à roulettes". On l'a recherché en Asie, en Europe, mais cest l'Afrique qui aujourd'hui s'impose comme le lieu d'enracinement le plus probable de la famille des Hominidés et du genre Homo. Les découvertes des hominidés les plus primitifs connus, les Australopithèques, faites d'abord en Afrique du Sud, puis en Afrique de l'Est conduisent à penser que le berceau de la famille des Hominidés se situe dans ces régions.
La Vallée du grand Rift africain doit elle être considérée comme le lieu d'origine le plus probable de la famille des Hominidés ? Cette thèse est débattue aujourd'hui. Il se peut en effet que les découvertes nombreuses et spectaculaires dans ces sites - ainsi, celle de "Lucy", une Australopithèque très primitive datée de 3 millions d'années, dont les restes presque complets ont été découverts dans le site de Hadar, en Éthiopie en 1974 - s'expliquent plutôt par d'extraordinaires conditions de préservation des fossiles, et des conditions géologiques particulièrement favorables à ce genre de trouvailles. Aujourd'hui, le schéma de "L'East Side Story" selon lequel les premiers Hominidés seraient d'abord apparus à l'est de la Rift Valley, après le creusement de cette faille il y a 7 millions d'années, semble devoir être révisé : une mandibule d'Australopithèque découverte par le paléontologue français Michel Brunet à quelque 2500 km à l'ouest la Rift Valley, au Tchad et contemporaine de Lucy, suggère que l'histoire humaine à cette époque très reculée met en jeu des facteurs environnementaux et comportementaux plus complexes que ceux supposés jusqu'alors. Cette découverte a fait rebondir la question du berceau de l'humanité : elle oblige à penser très tôt en termes de dispersions et de migrations, et à considérer que dès ces époques lointaines du Pliocène, il y a quelque 3 millions d'années, les Hominidés étaient déjà répandus dans une grande partie du continent africain.
Selon les constructions de la biologie moléculaire, c'est entre 5 et 7 millions d'années avant le présent qu'il faut situer l'enracinement commun des Hominidés et des Grands Singes. Les restes d'Ardipithecus ramidus, découverts en Éthiopie, ont été classés en 1994 dans un genre nouveau, que son ancienneté (4,4 millions d'années) semble situer tout près de l'origine commune des grands Singes africains et des premiers Hominidés.
Le tableau de lévolution de la famille humaine inclut de nombreuses espèces d' Australopithèques, ces Hominidés dallure primitive, au front bas, à la démarche bipède, qui ont coexisté en Afrique pendant de longues périodes et dont les vestiges sont datés entre 3,5 et 1 million d'années avant le présent.
Quant aux premiers représentants du genre Homo, ils sont reconnus à des périodes fort anciennes : à Olduvai (Tanzanie) Homo habilis, à partir de - 2,5 millions d'années, a été désigné comme le plus ancien représentant du genre auquel nous appartenons, mais il coexiste peut-être en Afrique avec une deuxième espèce du genre Homo, Homo ergaster.
A partir de -1,7 millions d'années Homo erectus apparaît en Afrique, puis va se répandre dans tout l'Ancien monde : Homo erectus est un Homme de taille plus élevée, au squelette plus lourd et dont le crâne, plus volumineux et plus robuste, a une capacité d'environ 800 cm3. Il va bientôt se répandre dans les zones tempérées du globe, dans le Sud-Est asiatique, en Asie orientale, dans le continent indien et en Europe. Culturellement, il s'achemine vers des sociétés de plus en plus complexes : il développe les techniques de la chasse, domestique le feu, et autour d'1,5 millions d'années invente le biface, qui pour la première fois dans l'histoire humaine manifeste le sens de la symétrie et de l'esthétique.
Les Néandertaliens (Homo neandertalensis) semblent apparaître il y a environ 400 000 ans en Europe occidentale, mais on les trouve aussi au Proche Orient, en Israël et en Irak, entre 100 000 et 40 000 avant le présent. Ces Hominidés au front bas, à la face fuyant en museau, à la carrure massive, mais au crâne dont la capacité cérébrale est proche de la nôtre, parfois même supérieure ont prospéré en Europe de l'Ouest, au Paléolithique moyen (jusqu'il y a 35 000 ans environ), avant d'être brusquement, et de façon encore mal comprise, remplacés par des hommes de type moderne au Paléolithique supérieur. Au Proche-Orient, les choses paraissent plus complexes. Au Paléolithique moyen, les Néandertaliens semblent bien avoir été les contemporains, dans les mêmes lieux, des sapiens archaïques. Pendant plusieurs dizaines de millénaires, ils ont partagé avec eux leurs cultures. Dans ces sites du Proche-Orient, la culture "moustérienne" est associée, non pas comme en Europe aux seuls Néandertaliens, mais à tous les représentants de la famille humaine. En particulier, la pratique de la sépulture est associée non à tel type biologique d'hominidé mais à ce qu'on peut appeler la culture moustérienne, qui leur est commune.
Histoire d'amour, de guerre ou... de simple cohabitation? Sapiens et Néandertaliens ont-ils pu coexister dans les mêmes lieux, avoir, à quelques variantes près, la même culture et les mêmes rituels funéraires, sans qu'il y ait eu d'échanges sexuels entre eux ? Pour certains, il pourrait s'agir de deux races d'une même espèce, donc fécondes entre elles, et les Néandertaliens auraient pu participer au patrimoine génétique de l'homme moderne. D'autres refusent cette hypothèse, sur la foi de l'étude récente d'un fragment d'ADN de Néandertalien, qui paraît confirmer - mais de manière encore fragile - la séparation des deux espèces, et donc l'impossibilité de leur interfécondité.
Les avancées de la génétique et de la biologie moléculaire ont conduit à poser en termes nouveaux la question de l'origine d'Homo sapiens et de la diversité humaine actuelle. Au milieu du XXème siècle, Franz Weidenreich, se fondant sur l'étude des Hominidés fossiles de Chine, les "Sinanthropes", considérait qu'"il doit y avoir eu non un seul, mais plusieurs centres où l'homme s'est développé ". Selon lui, la part trop importante faite aux fossiles européens avait masqué l'existence d'importantes particularités locales chez les Hominidés du Paléolithique inférieur (par exemple entre les Sinanthropes et les Pithécanthropes de Java). Au cours de l'évolution parallèle de ces groupes isolés les uns des autres par des barrières géographiques, les différences déjà présentes à ce stade ont pu se perpétuer jusqu'aux formes actuelles. Ces idées restent aujourd'hui à la source des approches "polycentristes" qui tentent de reconstituer le réseau complexe des origines des populations humaines actuelles, héritières selon eux de formes locales d'Homo erectus, remontant à 500 000 ans, voire 1 million d'années. Cette approche, qui privilégie l'étude des fossiles asiatiques, se donne pour une critique des mythes "édéniques" en même temps que de l'eurocentrisme qui a longtemps prévalu dans l'étude de la diversité au sein de l'humanité actuelle et fossile.
Face à ces positions "polycentristes", les tenants du "monocentrisme" défendent la thèse d'un remplacement rapide des formes d'hominidés primitifs par des Homo sapiens anatomiquement modernes : ils s'efforcent, à partir de l'étude des différences morphologiques, mais aussi des données de la biologie moléculaire, de reconstituer l'origine unique de toutes les populations humaines. Ces études ont abouti à un calcul des "distances génétiques" entre les populations actuelles, et avancé l'hypothèse d'une "Ève africaine" qui serait la "mère" commune de toute l'humanité
La thèse de l'origine unique et africaine de l'espèce Homo sapiens, il y a quelque 200 000 ans, irait dans le sens d'une séparation récente des populations humaines actuelles, et d'une différence très faible entre elles. Mais elle demande à être confirmée, non seulement par de nouvelles expériences et un échantillonnage rigoureux, mais aussi par les témoignages paléontologiques, rares à cette époque dans ce domaine géographique.
La mise en place de l'arbre généalogique de la famille humaine au cours de l'histoire de la paléoanthropologie et de la préhistoire reste aujourd'hui encore l'objet de discussions, qui concernent tant les schèmes évolutifs et les processus environnementaux que les critères biologiques et culturels qui y sont à l'Suvre. Lhistoire de la famille humaine apparaît fort complexe dès ses origines : aux racines de l'arbre généalogique, entre 4 millions et 1 million d'années, les Hominidés se diversifient en au moins deux genres (Australopithecus et Homo) et un véritable buissonnement d'espèces, dont certaines ont été contemporaines, parfois dans les mêmes sites. La multiplication des découvertes, l'introduction des méthodes de classification informatisées, et les bouleversements des paradigmes de savoir, ont abouti à rendre caduque la recherche d'un unique "chaînon manquant" entre l'Homme et le singe. L'espèce Homo sapiens a été resituée dans le cadre d'une famille qui a connu une grande diversification dans tout l'Ancien Monde. Que la plupart des espèces d'Hominidés se soient éteintes est un phénomène banal dans l'histoire du vivant, et ne signifie certainement pas que la nôtre fût la seule destinée à survivre. Plusieurs dizaines de milliers d'années durant, les Néandertaliens ont prospéré et parfois même cohabité avec notre espèce - et ils se sont éteints, comme d'ailleurs la plupart des espèces vivantes, il y a seulement un peu plus de 30 000 ans, pour des raisons qui restent inconnues. Mais ils auraient pu survivre, et la vision que nous avons de nous-mêmes en eût sans doute été fortement modifiée...
Le devenir des cultures humaines
"L'évolution [humaine] a commencé par les pieds"... aimait à dire par provocation André Leroi-Gourhan, insistant sur le fait que l'acquisition la bipédie précède dans l'histoire humaine le développement du cerveau.
De fait, des découvertes récentes ont montré que la bipédie a sans doute été acquise très tôt dans l'histoire de la famille humaine, il y a 3 ou 4 millions d'années. Les études menées sur la locomotion des Australopithèques ont conclu que ceux-ci marchaient déjà sur leurs deux pieds, même s'il leur arrivait parfois de se déplacer par brachiation - en se suspendant à l'aide de leurs bras. Les traces de pas découvertes en 1977 à Laetolil (Tanzanie ) et datées de 3,6 millions d'années sont bien celles de deux individus parfaitement bipèdes, marchant côte à côte... Elles ont confirmé le fait que la station redressée et la marche bipède étaient déjà acquises par ces Hominidés primitifs, - bien avant que la taille du cerveau n'atteigne son développement actuel.
Le développement du cerveau est certainement le trait le plus remarquable de la morphologie humaine. Des moulages naturels d'endocrânes fossiles - comme celui de lenfant de Taung, découvert en 1925 - ou des moulages artificiels obtenus à partir de limpression du cerveau sur la paroi interne du crâne dautres Hominidés fossiles ont permis de suivre les étapes de cette transformation du volume cérébral, de l'irrigation et de la complexification des circonvolutions cérébrales au cours de l'évolution des Hominidés. La question reste cependant posée du "Rubicon cérébral" - elle implique qu'il existerait une capacité endocrânienne au-delà de laquelle on pourrait légitimement considérer qu'on a affaire à des représentants du genre Homo, dignes d'entrer dans la galerie de nos ancêtres... La définition, longtemps discutée, d'Homo habilis comme premier représentant du genre humain, a fait reculer cette frontière à 600 cm3... et peut-être même encore moins : il faut donc bien admettre que le développement du cerveau n'a pas été l'unique "moteur" du développement humain : il s'associe à d'autres traits anatomiques propres à l'homme, station redressée, bipédie, morphologie de la main, fabrication et utilsation d'outils, usage d'un langage articulé...
La main humaine a conservé le schéma primitif, pentadactyle, de l'extrémité antérieure des Vertébrés quadrupèdes. La caractéristique humaine résiderait dans le fait que chez l'Homme le membre antérieur est totalement libéré des nécessités de la locomotion. Mise en rapport avec le développement du cerveau, la libération de la main ouvre à l'Homme les possibilités multiples de la technicité. L'avènement d'une "conscience" proprement humaine se situerait donc du côté de ses productions techniques.
L'outil est-il autant qu'on le pensait naguère porteur de la différence irréductible de l'homme ? Éthologistes, préhistoriens et anthropologues ont cherché à comparer, sur le terrain archéologique ou expérimental les "cultures" des Primates et celles des premiers Hominidés fossiles. Ils proposent des conclusions beaucoup plus nuancées que les dichotomies abruptes de jadis. Si l'outil définit l'Homme, l'apparition de l'Homme proprement dit ne coïncide plus avec celle de l'outil. Certains grands Singes savent utiliser et même fabriquer des outil. L'étude fine de la technicité des Panidés a également conduit à en observer des formes diversifiées dans différents groupes géographiquement délimités, et certains chercheurs n'hésitent pas à parler de "comportements culturels" chez ces Singes. D'autre part, les premières industries de pierre connues sont probablement l'Suvre des Australopithèques : ces hominidés au cerveau guère plus volumineux que celui d'un gorille sont-ils les auteurs des "pebble tools" ou des industries sur éclats vieilles d'environ 2,5 millions d'années - qui ont été trouvés associées à eux dans certains sites africains ? Beaucoup l'admettent aujourd'hui ... mais d'autres restent réticents à attribuer ce trait culturel à un Hominidé qui ne se situe pas dans notre ascendance ! Il a donc fallu repenser les "seuils" qui naguère semblaient infranchissables, non seulement entre grands Singes et premiers Hominidés, mais aussi entre les différents représentants de la famille humaine.
L'Homme seul serait capable de prévision, d'intention : Il sait fabriquer un outil pour assommer un animal ou découper ses chairs -et, plus encore, un outil pour faire un outil. Instrument du travail, l'outil est lui-même le produit d'un acte créateur. Si les vestiges osseux sont rares et se fossilisent mal, d'innombrables silex taillés, des primitifs "galets aménagés" aux élégantes "feuilles de laurier" solutréennes et aux pointes de flèches magdaléniennes permettent de suivre à la trace les chemins qu'ont empruntés les Hommes, d'évaluer leurs progrès dans la conquête et la maîtrise de la nature, de percevoir la complexité croissante de leurs échanges et de leurs communications.
Les "cultures" préhistoriques ont dans le passé été caractérisées, presque exclusivement, par l'outillage lithique qui les composent. Le Moustérien, le Solutréen, le Magdalénien, ce sont d'abord des types d'outils et de techniques lithiques décrits, inventoriés, étudiés dans leur distribution statistique. Cependant les approches contemporaines tendent à élargir cette notion de "cultures" en mettant en lumière d'autres traits culturels importants, inventions techniques essentielles comme celle du feu, de l'aiguille et du poinçon, de la corde, et du tissage, structures d'habitat, organisation du groupe social, division du travail...
Aux périodes les plus récents du Paléolithique supérieur, l'art, mobilier ou rupestre, traduit le fait que l'homme a désormais accès au symbolique, à la représentation. Innombrables sont les objets en ivoire, en os ou en bois de renne, sculptés ou gravés découverts sur les sites préhistoriques, et témoignant de la fécondité artistique des chasseurs cueilleurs de la préhistoire, et de ce que ces primitifs du Paléolithique avaient un talent et une sensibilité dartistes, très proches en somme de celles de lHomme daujourdhui.
Devant ces figurations animales et humaines ou ces signes abstraits, le problème se pose de leur signification : labbé Breuil nhésitait pas à prêter un sentiment religieux à ses auteurs, et à interpréter les figures et les symboles sculptés, gravés, dessinés ou peints du Paléolithique comme la manifestation de cultes animistes et de rituels chamaniques, que l'on retrouverait chez certains peuples actuels. La thèse du chamanisme a fait l'objet d'importantes critiques, elle a pourtant été récemment reprise par le préhistorien français Jean Clottes et l'anthropologue sud-africain David Lewis-Williams, qui proposent d'interpréter les symboles de l'art paléolithique en s'inspirant de ceux du chamanisme, lisibles selon eux dans l'art rupestre des Bushmen d'Afrique australe. Cette interprétation, étayée aussi par des arguments neuro-physiologiques, ne laisse pas d'être fragile, précisément par l'universalité qu'elle suppose, excluant les lectures de cet art qui viseraient à prendre en compte son contexte particulier et son symbolisme propre
La faculté symbolique dont témoigne l'art est sans aucun doute liée aux possibilités de l'échange et de la parole. On sait que certaines régions du cerveau humain sont dévolues à la parole et le développement de ces aires cérébrales a pu être observé, dès Homo habilis, voire même peut-être chez les Australopithèques. Certaines caractéristiques des organes de la phonation (larynx, apophyses de la mandibule pour linsertion de la langue, résonateurs nasaux) sont également invoquées, mais beaucoup dincertitudes subsistent : le grognement, le cri, le chant, ont-ils été les formes primitives de l'expression humaine ? Le langage "doublement articulé" - au niveau phonétique et sémantique - existe-t-il déjà aux stades anciens du genre Homo, voire dès Australopithecus, ou apparaît-il seulement avec l'Homme moderne ? Le langage humain résulte-t-il d'un "instinct" déterminé génétiquement qui dès les origines de la famille humaine nous distingue déjà des autres primates ? ou faut-il le considérer comme un produit de la société et de la culture, contemporain de la maîtrise des symboles de l'art ?
Nouveaux regards sur la femme préhistorique
Le XIXème siècle n'avait pas donné une image très glorieuse de la femme préhistorique. Le héros de la préhistoire, de Figuier à Rosny, cest l'Homme de Cro-Magnon, armé d'un gourdin, traînant sa conquête par les cheveux pour se livrer à d'inavouables orgies dans l'obscurité de la caverne& La sauvagerie des "âges farouches" est alors prétexte à des allusions à la brutalité sexuelle, au viol. Cet intérêt pour les mSurs sexuelles des origines est sans doute l'envers de la pruderie d'une époque. Il rejoint celui que l'on commence à porter aux ténèbres de l'âme, aux pulsions primitives, inconscientes, qui s'enracinent dans les époques primitives de l'humanité.
Notre regard aujourdhui semble se transformer. Notre héros de la préhistoire, c'est une héroïne, Lucy, une Australopithèque découverte en 1974 dans le site de Hadar en Ethiopie et qui vécut il y a quelque 3 millions d'années. Innombrables sont les récits qui nous retracent les bonheurs et les aléas de son existence. Signe des temps : la femme a désormais une place dans la préhistoire.
Les anthropologues ont renouvelé l'approche de la question des relations entre les sexes aux temps préhistoriques en mettant l'accent sur l'importance, dans le processus même de l'hominisation, de la perte de l'oestrus qui distingue la sexualité humaine de celle des autres mammifères. Tandis que l'activité sexuelle chez la plupart des animaux, y compris les grands Singes, est soumise à une horloge biologique et hormonale, celle qui détermine les périodes de rut - la sexualité humaine se situe sur le fond d'une disponibilité permanente. Cette disponibilité fut sans doute la condition de l'apparition des normes et des interdits qui dans toutes les sociétés limitent les usages et les pratiques de la sexualité. Peut-être a-t-on vu alors naître des sentiments de tendresse, s'ébaucher des formes de la vie familiale, de la division du travail - et s'établir les règles morales, l'interdit de l'inceste et les structures de la parenté dont les anthropologues nous ont appris quils se situent au fondement de toute culture.
Depuis environ trois décennies, des travaux conjugués d'ethnologie et de préhistoire ont remis en cause les a priori jusque là régnants sur linanité du rôle économique et culturel des femmes dans les sociétés paléolithiques. Les recherches des ethnologues sur les Bushmen dAfrique du Sud ont ouvert de nouvelles voies pour la compréhension des modes de vie et de subsistance, des structures familiales et de la division sexuelle du travail chez les peuples de chasseurs-cueilleurs. Dans ces groupes nomades, les femmes, loin d'être passives, vouées à des tâches subalternes, immobilisées par la nécessité délever les enfants, et dépendantes des hommes pour l'acquisition de leur subsistance, jouent au contraire un rôle actif à la recherche de nourriture, cueillant, chassant à loccasion, utilisant des outils, portant leurs enfants avec elles jusquà lâge de quatre ans, et pratiquant certaines techniques de contrôle des naissance (tel que l'allaitement prolongé). Ces études ont conduit les préhistoriens à repenser l'existence des Homo sapiens du Paléolithique supérieur, à récuser les modèles qui situaient la chasse (activité exclusivement masculine) à lorigine de formes de la vie sociale, et à élaborer des scénarios plus complexes et nuancés, mettant en scène la possibilité de collaborations variées entre hommes et femmes pour la survie du groupe.
La figure épique de Man the Hunter, le héros chasseur poursuivant indéfiniment le gros gibier a vécu. Il faut désormais lui adjoindre celle de Woman the gatherer, la femme collectrice (de plantes, de fruits, de coquillages). Larchéologue américain Lewis Binford est allé plus loin en insistant sur l'importance au Paléolithique des activités, non de chasse, mais de charognage, de dépeçage, de transport et de consommation de carcasses d'animaux morts, tués par d'autres prédateurs. Des preuves dactivités de ce type se trouveraient dans la nature et la distribution des outils de pierre sur certains sites de dépeçage, et dans la sélection des parties anatomiques des animaux consommés. Si tel est le cas, des femmes ont pu participer à ces activités, et être, tout autant que les hommes, pourvoyeuses de nourriture.
Il se peut aussi que, contrairement aux idées reçues, les femmes aient été très tôt techniciennes, fabricatrices d'outils quelles se soient livrées par exemple à la taille des fines industries sur éclats qui abondent à toutes les époques du Paléolithique -, qu'elles aient inventé il y a quelque 20 000 ans, la corde et l'art du tissage de fibres végétales, dont témoignent les parures et les vêtements qui ornent certaines statuettes paléolithiques : la résille qui coiffe la "dame à la capuche" de Brassempouy, le "pagne" de la Vénus de Lespugue, les ceintures des Vénus d'ivoire de Kostienki, en Russie&
Ces Vénus paléolithiques nous donnent-elles pour autant une image réaliste de la femme préhistorique ? Si tel était le cas, il faudrait croire, comme le disait avec humour Leroi-Gourhan, que la femme paléolithique était une nature simple, nue et les cheveux bouclés, qui vivait les mains jointes sur la poitrine, dominant sereinement de sa tête minuscule lépouvantable affaissement de sa poitrine et de ses hanches &Ces Vénus ont suscité une multitude d'interprétations - tour à tour anthropologiques, physiologiques, voire gynécologiques, religieuses, symboliques. Certains, s'appuyant sur l'abondance dans lart paléolithique des images sexuelles et des objets réalistes - vulves féminines ou phallus en érection, scènes d'accouplement, corps de femmes dont les seins, les fesses et le sexe sont extraordinairement soulignés, y ont vu l'expression sans détour de désirs et de pratiques sexuels, en somme l'équivalent paléolithique de notre pornographie&
Des études féministes ont mis en cause le fait, jusque là donné pour une évidence, qu'il puisse s'agir d'un art fait par des hommes et pour des hommes. Chez les Aborigènes australiens, l'art sacré est en certaines occasions réservé aux femmes. Si on admet que l'art paléolithique a pu avoir une fonction rituelle et religieuse, ses figurations et ses objets pourraient avoir été destinés, plutôt qu'à un usage exclusivement masculin, à l'usage des femmes ou à l'initiation sexuelle des adolescentes. L'ethnologue californienne Marija Gimbutas a reconnu dans ces Vénus paléolithiques des images de la "Grande Mère", figure cosmogonique, symbole universel de fécondité, qui se retrouve au Néolithique et jusqu'à l'Age du Bronze dans toute l'Europe : ces sociétés dont les religions auraient été fondées sur le culte de la "Grande Déesse" auraient connu, de manière continue jusqu'à une époque relativement récente, des formes de pouvoir matriarcales et des formes de transmission matrilinéaires, avant d'être remplacées par des structures sociales à dominance masculine et des religions patriarcales. Cette construction, qui reprend la thèse du matriarcat primitif à lappui de thèses féministes, reste pourtant fragile : lhistoire ultérieure ne nous montre-t-elle pas que le culte de la mère peut exister dans des religions à dominance masculine, et dans des sociétés comportant une bonne part de misogynie ?
Quoi quil en soit, limage de la femme du Paléolithique a changé. Sil reste souvent à peu près impossible de désigner précisément ce qui dans les rares vestiges de la préhistoire, ressortit à lactivité de lun ou lautre sexe, ces nouvelles hypothèses et ces nouveaux savoirs, qui ne sont pas sans liens avec les transformations de nos sociétés, nous livrent une image plus vivante, plus colorée, plus ressemblante peut-être, de la femme des origines.
Conclusion
Comme tous les savoirs de l'origine, la préhistoire est un lieu inépuisable de questionnements, de rêves et de fantasmes. Elle représente un monde à la limite de la rationalité et de l'imaginaire, où peut s'exprimer le lyrisme, la fantaisie, l'humour, l'érotisme, la poésie. Mais l'imagination, en ce domaine, ne saurait être réduite à une combinatoire de thèmes fixés, archétypes ou lieux communs. Elle invente, elle crée, elle se renouvelle en fonction des découvertes et des événements, mais aussi des représentations prégnantes en un moment et dans un contexte particulier.
La préhistoire est une science interdisciplinaire, qui mobilise la géologie, la biologie, l'archéologie, l'ethnologie, l'histoire de l'art& et qui s'enrichit des développement de tous ces savoirs. Mais elle est avant tout une discipline historique, dont les documents sont pourtant beaucoup plus pauvres que ceux de l'histoire : ce sont des traces, des vestiges fragmentaires et muets, auxquels il faut donner sens, et dont l'interprétation est un lieu privilégié de projection de nos propres cadres mentaux et culturels.
Cest pourquoi on peut prophétiser sans risque que l'humanité préhistorique du XXIème siècle ne ressemblera pas à celle du XIXème ou du XXème siècle. Non seulement parce que des découvertes, suscitées ou inattendues, surgiront du terrain ou du laboratoire. Mais aussi parce que nos sociétés elles-mêmes, et la conscience que nous en avons, changeront elles aussi. Car l'Homme préhistorique a une double histoire : la sienne propre, et celle de nos représentations.
VIDEO CANAL U LIEN
( si la vidéo n'est pas visible,inscrivez le titre dans le moteur de recherche de CANAL U ) |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|